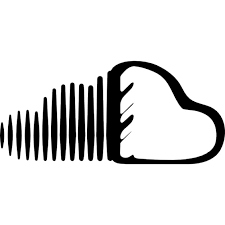DE RETOUR D’UKRAINE
Introduction
ISSN 2608-984X
Philippe Meyer :
Cette émission prend une forme un peu particulière, celle d’une conversation en duo avec Michel Eltchaninoff. Michel, nos auditeurs vous connaissent mais ne vous ont pas entendu à ce micro depuis un certain temps, et pour une bonne raison : vous étiez en Ukraine. Avant de nous raconter votre séjour, un mot sur vous et sur cet univers russe et ukrainien. Quels sont vos rapports personnels avec la Russie et l’Ukraine ?
Michel Eltchaninoff :
Je suis descendant de personnes qui ont fui la Révolution russe dans les années 1920, qui sont donc parties de Russie, mais aussi d’Ukraine, puisque l’un de mes grand-pères habitait Odessa. Je connais mieux la Russie, puisque j’ai travaillé dans les années 1990 pour l’ambassade de France à Moscou, puis à nouveau dans les années 2000. Je connaissais l’Ukraine, mais j’y allais depuis Moscou, j’étais en quelque sorte encore dans la perspective impériale … Je ne parle pas ukrainien, donc lors de mon récent voyage, je m’entretenais en russe avec presque tous mes interlocuteurs. Mais je voulais justement « dés-impérialiser » mon regard, en allant passer du temps en Ukraine, depuis la France cette fois, et m’enfoncer un peu dans ce pays en guerre.
Kontildondit ?
Philippe Meyer :
Un mot à propos des immigrés de la génération de vos grand-parents. Beaucoup d’entre eux ont « coupé les racines », refusant que leurs enfants apprennent la langue du pays d’origine. Ce n’est pas votre cas.
Michel Eltchaninoff :
On parlait russe à la maison, mes parents se parlaient russe entre eux, la confession orthodoxe était transmise … Il y avait une certaine revendication de cette origine culturelle et linguistique russe.
Philippe Meyer :
Venons-en à votre voyage en Ukraine. Quand a-t-il eu lieu et combien de temps a-t-il duré ? Et sur le plan matériel, est-ce facile d’y aller ? De s’y déplacer ? D’y organiser un séjour ?
Michel Eltchaninoff :
J’y suis resté deux semaines, de la dernière semaine d’octobre à la fin de la première semaine de novembre, c’est-à-dire quelques jours après le résultat de l‘élection présidentielle américaine. Je suis allé à plusieurs reprises en Ukraine, une dizaine de fois, et depuis le début de la guerre je me suis rendu à Odessa, bref c’est un pays que je connais un peu, mais cette fois-ci, je voulais m’immerger : il s’agissait de parcourir de l’espace et du temps. J’étais seul, sans photographe, sans interprète, je voulais côtoyer la société ukrainienne après 1.000 jours de guerre.
Matériellement parlant, l’organisation était très simple. On peut aller en Ukraine sans visa, il est donc très facile d’entrer dans le pays. Il faut d’abord aller en Pologne, puis prendre un train ou un bus pour traverser la frontière. Et dans ce bus qui m’a conduit à Lviv, tout près de la frontière occidentale de l’Ukraine, j’étais quasiment le seul homme à l’aller et au retour, car aucun homme ukrainien entre 18 et 65 ans n’a le droit de quitter le territoire. J’étais donc en compagnie de femmes ayant passé du temps à l’étranger avec leurs enfants, de vieilles dames, etc.
Philippe Meyer :
Vous venez de mentionner Lviv. La ville s’appelait d’abord Lemberg quand elle était autrichienne, puis Lwów du temps où elle était polonaise, avant sa dénomination actuelle. Comment cette ville de l’ouest du pays a-t-elle été touchée par la guerre ?
Michel Eltchaninoff :
La situation de la ville est en effet assez paradoxale. Elle a longtemps appartenu à l’empire austro-hongrois, puis à la Pologne. Les églises y sont « gréco-catholiques », c’est-à-dire catholiques mais de rite oriental, il y a d’ailleurs une forte ferveur religieuse dans la région. C’est une région qui historiquement a toujours milité en faveur de l’indépendance de la Pologne (puisque très loin de l‘empire russe), où les gens ne se sentent pas russes du tout. La ville est à la fois très loin du front (environ 1.000 kilomètres), et en même temps, elle envoie beaucoup d’hommes se battre. L’impression est donc particulière : celle d’une sécurité relative, puisque la ville est certes bombardée par l’armée russe mais pas directement menacée (un missile s’est tout de même abattu sur une maison d’habitation en septembre dernier, tuant une femme et trois enfants). J’y étais au moment des vacances scolaires, il y avait donc beaucoup de jeunes de tout le pays. Et parallèlement à cette sécurité relative, il y a tout de même la souffrance de la guerre, et peut-être aussi une pointe de culpabilité. On m’a emmené voir le cimetière militaire, avec les centaines de tombes des soldats, et pendant la messe du dimanche, on égrène les noms des hommes tombés sur le front …
Philippe Meyer :
Dans le numéro de décembre-janvier de Philosophie magazine figure votre reportage, mais ce ne sera pas tout. Comment allez-vous poursuivre votre travail ?
Michel Eltchaninoff :
Il y a effectivement ce reportage de neuf pages, avec le récit de cette traversée et des photos. J’ai par ailleurs commencé à publier sur le site du magazine, philomag.com, les entretiens presque intégraux, que j’ai réalisés avec toutes les personnes que j’ai rencontrées. J’ai interrogé principalement des intellectuels (philosophes, éditeurs, artistes), mais comme j’étais seul et russophone, j’ai aussi discuté avec pas mal de gens dans la rue, dans les trains …
Philippe Meyer :
Venons-en à la situation du pays proprement dite. Plus de 1.000 jours après le début de la guerre, l’une des questions qu’on se pose le plus fréquemment est : sont-ils vraiment aussi fatigués qu’on peut le craindre, et est-ce vraiment là l’épuisement qu’espère Poutine ?
Michel Eltchaninoff :
J’ai posé cette question à tous mes interlocuteurs, et à Kharkiv (tout à l’est du pays, donc), une dame m’a répondu, un peu en colère : « Mais c’est vous, les Occidentaux, qui êtes fatigués ! Vous en avez assez, l’Ukraine c’est loin, il y a d’autres guerres, vous situations de politique intérieure sont compliquées, etc. C’est vous qui êtes fatigués de comprendre que l’Ukraine est la sentinelle de l’Europe face au poutinisme».
Les réponses sont très diverses. Certains intellectuels m’ont dit que la fatigue en question n’était en fait que de la propagande russe : convaincre les Occidentaux et les Ukrainiens eux-mêmes que tout le monde est à bout de forces, et qu’il faut signer un papier le plus vite possible pour mettre fin à cette guerre. D’autres, notamment la philosophe Orysya Bila, m’ont dit qu’il s’agissait d’un marathon, dont on ne connaît pas le kilométrage précis, mais où on est obligé de courir. Évidemment qu’on est épuisé, puisqu’on ne peut jamais programmer de vacances, que les hommes sont au front, qu’on dépense beaucoup d’argent pour soutenir l’armée, etc. On n’a pas de vie normale, des proches meurent ou sont blessés, on est suspendus aux nouvelles. Donc oui, on est fatigué. Mais on sait qu’on doit continuer. On ne sait pas combien de temps, mais on le doit. Parce que ce n’est pas une guerre où seuls des territoires sont en jeu. C’est une guerre pour détruire l’Ukraine. Pour continuer, les Ukrainiens doivent découvrir en eux-mêmes des ressources spécifiques.
C’est ce qui m’a intéressé dans ce voyage, c’était de découvrir les affects de mes interlocuteurs. Comme on pouvait s’y attendre, beaucoup étaient négatifs : fatigue, sentiment d’abandon, angoisse, colère, etc. Mais ce qui m’a impressionné chez beaucoup de mes interlocuteurs, c’est la façon dont ils arrivaient à transformer ces affects négatifs en quelque chose de positif ; cela pouvait devenir de la résilience, un sentiment d’unité entre Ukrainiens, du courage, et aussi quelque chose de très émouvant : le soin que les gens prennent les uns pour les autres au quotidien, dans les transports, dans la rue, etc. Le pays est en danger, et pour ne pas céder aux mauvaises passions dans une situation aussi difficile, on s’entraide. C’est réellement impressionnant, et inspirant pour d’autres sociétés, comme la nôtre.
Philippe Meyer :
Dans la mémoire de la population ukrainienne, quel est le poids de ce qui s’est passé à la fin des années 1930 ? Car la grande famine délibérément organisée par Staline fut l’un des épisodes les moins publiquement discutés ou étudiés, alors qu’il a fait des millions de morts ukrainiens. Est-ce que cela remonte à la surface à l’occasion de ce conflit ?
Michel Eltchaninoff :
En réalité, il y a depuis l’indépendance de l‘Ukraine en 1991 une redécouverte de son Histoire, et notamment de son Histoire soviétique. Et cette grande famine, le Holodomor, qui permit à Staline de récupérer des céréales tout en se débarrassant de ses opposants ukrainiens, est quelque chose de désormais reconnu : il y a un musée du Holodomor à Kyiv, des commémorations, etc. Cela entre donc peu à peu dans la conscience collective, alors que c’était évidemment nié pendant la période soviétique. L’un de mes interlocuteurs, un ancien dissident, m’a dit cette chose terrible : « un ancien officier du KGB, dans les années 1970, me disait que les Ukrainiens étaient un champ de mauvaises herbes, qu’il faut faucher tous les dix ans, sans quoi ils allaient finir par se révolter ». Il y a eu la révolution et la guerre civile dans les années 1920, le Holodomor en 1933, les répressions, la seconde guerre mondiale, les répressions culturelles … Les Ukrainiens réalisent que l’Ukraine a toujours été un territoire régulièrement réprimé par Moscou, sauf entre 1991 et le Maïdan, en 2013-14. Mon interlocuteur me disait que Poutine avait sans doute commis là une erreur : il avait oublié de faucher le champ de mauvaises herbes, et que cela avait permis à la société ukrainienne de se réapproprier son histoire humiliée.
Philippe Meyer :
L’une des accusations portées par Poutine pour justifier son invasion était les « nazis » présents sur le territoire ukrainien. Mais il y a une histoire spécifique de l‘Ukraine avec le régime nazi. Pendant la seconde guerre mondiale, au début de l’invasion de la Russie par les troupes d’Hitler, une bonne partie des Ukrainiens, qui avaient subi le Holodomor, l’oppression et le totalitarisme stalinien, étaient tout à fait prêts à s’allier avec les troupes allemandes. Comme Hitler les a traités comme des Untermenschen (« sous-hommes »), cette tentation de s’allier aux Allemands a été rapidement étouffée. Mais cette mémoire-là est-elle connue et enseignée en Ukraine ?
Michel Eltchaninoff :
Cet épisode du nationalisme ukrainien, qui a un moment s’est allié avec l’Allemagne nazie avant de se faire réprimer par elle, est de plus en plus connu, fait l’objet de débats (tout à fait sereins) entre historiens, donne lieu à des polémiques , etc. C’est donc une mémoire en train de se constituer, comme à propos du Holodomor. Il y a un débat démocratique, ainsi qu’un débat entre historiens, et tout est très ouvert. Sur l’Histoire, sur la question du nationalisme, sur l’attitude à avoir par rapport à la position du président Zelensky, tout est discuté ouvertement, personne n’est d’accord, et on essaie de construire une conversation démocratique à peu près normale. Les questions relatives au nationalisme ukrainien ne sont pas réglées, et elles impliquent également la Pologne, la Hongrie, etc. La réflexion est très riche, et l’Histoire est une discipline qui passionne les Ukrainiens d’aujourd’hui : ils lisent beaucoup de livres d’histoire, il y a beaucoup de publications de vulgarisation, et tout est discuté sans tabou particulier.
Philippe Meyer :
On a parfois l’idée que la nécessité de défendre le pays pourrait conduire à un régime plus autoritaire (sans forcément devenir dictatorial), à une société dans laquelle tout le monde serait prié de marcher au même pas et de dire la même chose. Ce n’est pas du tout ce que vous décrivez.
Michel Eltchaninoff :
Non, en effet. Il y a une toute petite partie de l’opinion publique qui considère qu’on peut avoir le national sans la démocratie, mais c’est extrêmement marginal. Car l’essentiel des discussions portent sur d’autres points. Le pays est conscient de ce que la démocratie lui a apporté depuis une trentaine d’années : de la liberté de parole, la possibilité de changer de président régulièrement, etc. Chaque intellectuel avec qui j’ai discuté avait une raison particulière d’en vouloir à Zelensky. Aucun ne lui reprochait d’être un dictateur, ni d’avoir dû reporter les élections présidentielles prévues en 2024. Mais tous pensent qu’une alternance serait bienvenue, que l’ancien commandant en chef des forces armées, et actuel ambassadeur d’Ukraine au Royaume-Uni, Valeri Zaloujny, devrait pouvoir être candidat, et que Zelensky ne parle pas assez à la société civile, qu’il ne fait que des « coups » sans véritable stratégie. En fait, on exprime des critiques ou des reproches à Zelensky, et on attend le moment où on pourra faire des élections. Les Ukrainiens ont compris le bénéfice de la démocratie, et ne sont pas du tout prêts à y renoncer, fût-ce au nom de l’idée nationale.
Philippe Meyer :
De quelle façon estime-t-on que Valeri Zaloujny conduirait la guerre, par rapport à Volodymyr Zelensky ? Ou pour le dire autrement, que « contient » l’opposition à Zelensky ?
Michel Eltchaninoff :
D’après ce qu’on m’a expliqué, Zaloujny a une autre conception de la stratégie ukrainienne : il considère que l’Ukraine sacrifie beaucoup trop d’hommes sur le front, que même si les lignes de front assez figées font penser à 1914-1918, la guerre est en réalité essentiellement technologique, et qu’on pourrait éviter les pertes d’hommes massives par le recours à la haute technologie. Par ailleurs, il faudrait réorganiser la société ukrainienne sur le modèle israélien, à savoir un pays faisant face à une menace permanente : trouver un modèle qui permette une vie normale tout en permettant une défense permanente. Cela signifie un service militaire avec des jeunes femmes et hommes pendant trois ans, et bien sûr un « dôme de fer » : une protection antimissiles de pointe. Les pro-Zaloujny estiment que leur favori a un programme qui permettrait à la société ukrainienne de vivre et se développer malgré la menace de la Russie, qui est constant et qui durera longtemps.
Il y a donc des programmes en train de s’écrire, des projets politiques en train de se monter. Le président Zelensky est dans une situation difficile, mais je pense qu’il défendra son bilan.
Philippe Meyer :
A l’intérieur de cette société attachée à la démocratie, comment envisage-t-on la fin de cette guerre ? Qu’est-ce qui est négociable, et où sont les lignes rouges ?
Michel Eltchaninoff :
J’ai senti chez beaucoup de mes interlocuteurs que la question des territoires n’était plus tabou. Il y a encore quelques mois, on disait qu’il fallait tout récupérer, y compris la Crimée annexée par la Russie en 2014. Aujourd’hui, le discours a un peu changé, tout le monde réalise que reprendre les territoires occupés n’est absolument pas une option si on entend finir cette guerre rapidement, et qu’il va falloir faire des aménagements. Par exemple geler une ligne de front, pendant quelques mois, voire quelques années. Mais les points de vue sont très divers. Pour certains intellectuels, on n’a pas d’autre choix que de se battre, car la guerre n’est pas que territoriale, mais bel et bien existentielle. Poutine considère que l’Ukraine n’est pas un pays, et veut la fin de l‘Ukraine. D’autres, par exemple un gardien de prison avec qui j’ai passé des heures lors d’un voyage en train, me disaient qu’ils voulaient que ça s’arrête parce qu’ils avaient peur de mourir ou de perdre des êtres chers. Là encore, il y a une multitude d’opinions et de débats. Ce qui a changé ces derniers mois, c’est l’idée qu’on allait pouvoir récupérer par la force et rapidement les territoires annexés par la Russie.
Philippe Meyer :
Il y eu une contre-offensive ukrainienne qui a pu faire croire pendant un moment qu’une victoire ukrainienne serait possible, suivie d’une « contre-contre-offensive » russe, qui a réduit cet espoir à néant, puisque les Russes ont avancé de façon très significative. Vous étiez sur place pendant ce gain de terrain des troupes russes.
Michel Eltchaninoff :
Effectivement. Je ne suis pas allé sur le front, car le but de mon voyage était d’observer les affects de la société ukrainienne, pas l’aspect militaire du conflit, largement commenté ailleurs. J’ai traversé le pays d’ouest en est. Je suis passé de Lviv à Kyiv la capitale, puis je suis allé à Dnipro, dans le centre-est du pays, qui est un peu le « hub » de la guerre, d’où les troupes partent et reviennent du front. Ensuite, je suis allé tout à l’est, à Kharkiv. La ville est en piteux état : les vitres des immeubles sont cassées, beaucoup de gens sont partis, le métro est gratuit car il n’y presque plus personne dedans … Les gens qui y vivent encore savent pourquoi ils restent. J’ai fait cette traversée pendant cette période d’avancée russe, il y avait tous les jours des bombardements et des attaques de drones. J’ai donc constaté l’accroissement de la pression russe, et la montée de l’angoisse chez mes interlocuteurs. Quand je les interrogeais sur leur moral, ils me répondaient un mot ukrainien : « lutz », dont je crois que le meilleur équivalent est le thumos de Platon. Le thumos est un sentiment qui ne vient pas de la tête, il n’est donc pas une réflexion, ni du ventre, ce n’est pas un instinct. Le thumos vient du cœur. C’est une sorte de souffle, fait d’ardeur et d’indignation. C’est un élan, en quelque sorte. C’est ce mot de « lutz » qui revenait chez bon nombre de mes interlocuteurs. Oui on est fatigué, angoissé, mais on a encore en nous ce souffle d’indignation, qui nous empêche d’abandonner. Cela ne signifie pas forcément combattre (même si beaucoup se posent la question), mais continuer à travailler, sans vacances, sans week-ends, sans relâche, tout faire pour conserver cette unité face à la menace. Chez certains, l’épuisement est là, et on espère un cessez-le-feu le plus rapide possible, mais chez d’autres, environ 30% ou 40% d’après les sociologues que j’ai pu rencontrer, il faut continuer à se battre et à faire vivre cette société. C’est aussi la raison pour laquelle beaucoup de jeunes hommes (18-25 ans) ne sont pas envoyés au front. Il y a un débat actuellement, les Américains ont notamment recommandé qu’il y ait une mobilisation générale à partir de 18 ans. Mais beaucoup d’Ukrainiens m’ont expliqué qu’il était important que tout le monde ne soit pas au front. Le pays s’est vidé, la situation économique est très difficile, il faut qu’il y ait des gens qui travaillent et qui étudient pour que le pays continue à vivre.
Philippe Meyer :
La France est-elle perçue différemment du reste de l’Europe ? Et si oui, en quoi ?
Michel Eltchaninoff :
A Dnipro, ancienne ville industrielle que j’avais connue dans les années 1990 assez sinistre et pauvre, et qui est devenue un centre commercial et industriel très important, ainsi qu’une très belle ville, j’ai été invité, un peu par hasard, à un club d’entrepreneurs, dans un resort sur le Dniepr, ou l’on buvait du Chablis (prononcé avec l’accent). C’était une discussion passionnante. Ils me disaient : « vous savez, on ne sait pas comment parler aux Occidentaux. Doit-on leur dire la vérité ? Qu’on va très mal, qu’on est exténués et qu’il nous faut de l’aide, ou est-ce que dans une posture plus business, on doit prétendre que tout va bien et qu’il faut continuer à faire des affaires ? ». Ces gens, très intelligents, m’ont demandé de présenter un peu Philosophie magazine et la position de la France. Et je me suis copieusement fait engueuler, parce que pour eux, j’étais un représentant officiel de la France, dont ils ne comprenaient absolument pas l’attitude. Avant la guerre, Emmanuel Macron va parler avec Vladimir Poutine, puis il dit qu’il ne faut pas humilier les Russes, ensuite qu’il faut peut-être envisager d’envoyer des troupes en Ukraine, mais ne le fait pas … Bref, notre position est illisible. Ils sont évidemment très déçus par la position allemande (Berlin refuse de leur fournir des missiles longue portée), mais avec la France, les Ukrainiens ne savent pas à quoi s’en tenir. Ils aimeraient plus de clarté, et espèrent que la France pourrait jouer un rôle majeur dans l’envoi d’observateurs. J’ai senti une forme de frustration, parfois un peu de colère, et un désir de clarification. Que les actes correspondent aux paroles.
Philippe Meyer :
Le résultat de l‘élection américaine est tombé alors que vous étiez en Ukraine. Qu’est-ce que Trump et les Etats-Unis représentent dans la perspective de la fin de cette guerre ?
Michel Eltchaninoff :
C’est étrange. J’étais à Kyiv ce jour là, et des intellectuels m’ont dit : « Avec Trump, on ne sait pas. Il se peut que ce soit pire, mais il y a tout de même une toute petite chance de mieux, un coup de poker. » Ils ont ajouté qu’ils étaient si las d’attendre le soutien européen et américain, que peut-être, Trump allait faire quelque chose qui leur serait bénéfique. Évidemment, il ne s’agissait pas du tout d’un enthousiasme, c’était plutôt un espoir de désespéré …
Je continue à dialoguer à distance avec les gens que j’ai rencontrés pendant ce voyage, et quelques semaines plus tard, ils me disent que la situation est de plus en plus sombre : si les Américains se retirent, la Russie avancera d’autant plus vite et se comportera en vainqueur, essaiera de fomenter des troubles, de placer un candidat pro-russe aux prochaines élections, etc. Le jour même, ils y avait cette forme d’espoir un peu paradoxale, mais plus le temps passe, plus ils se sentent abandonnés.
Philippe Meyer :
Quid de la Pologne ? N’est-ce qu’un voisin protégeant ses propres intérêts, ou un allié ?
Michel Eltchaninoff :
La Pologne est remerciée pour l’accueil remarquable qu’elle fait aux très nombreux Ukrainiens qui s’y trouvent. Elle est aussi considérée comme l’une des voix européennes les plus lucides quant à la menace russe. Quelles que soient toutes les querelles historiques entre les deux pays, il ne fait aucun doute pour les Ukrainiens que la Pologne sait ce qu’est la menace russe, et qu’elle fait de son mieux pour aider les Ukrainiens.
Philippe Meyer :
Mais pas au point de considérer que si les Etats-Unis se désengageaient complètement, la Pologne, qui s’est sensiblement réarmée, serait une alliée efficace, et un aiguillon de l‘Europe pour prendre la place des Etats-Unis dans la défense de l’Ukraine ?
Michel Eltchaninoff :
Personne ne sait ce qui se passera, mais il paraît clair que les Etats baltes, la Pologne, la Suède, la Finlande et la France, sont disposés à faire davantage pour aider l’Ukraine : peut-être envoyer des troupes ou au moins des observateurs, en tous cas prendre le relais du parapluie américain si celui-ci venait à se refermer.