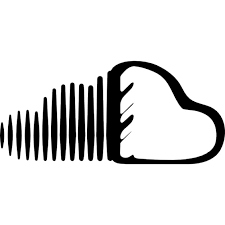DE RETOUR DU PAYS DE DONALD TRUMP
Introduction
ISSN 2608-984X
Philippe Meyer :
Richard, vous êtes un de ces journalistes nomades, ayant une affection particulière pour le terrain. Ce n’est pas une caractéristique si fréquente dans cette profession où l’on a généralement plus d’attirance pour le commentaire, l’analyse, l’éditorial, que pour aller voir le monde et le rendre intelligible aux autres.
Vous revenez des Etats-Unis, où vous êtes resté longtemps. Quelle a été la géographie de ce périple ?
Kontildondit ?
Richard Werly :
Il s’agissait de trouver une façon de raconter les Etats-Unis relativement originale pour les lecteurs de Blick.fr, le journal pour lequel je travaille. Je voulais observer les swing States, ces états « bascule », dont le vote pouvait décider le résultat de l’élection, et au-delà, raconter une certaine Amérique, et j’ai eu l’idée de louer un camping-car. Nous l’avons pris à Naperville, au sud de Chicago, Pierre Ballenegger (jeune journaliste de Blick en charge de la vidéo et de la photo) et moi. De là, nous sommes partis vers l’est, en direction de Detroit. Nous nous sommes d’abord arrêtés à Lansing, capitale de l’Etat du Michigan (l’un des swing states), puis à Springfield, dans l’Ohio. Il y a beaucoup de Springfield aux Etats-Unis, mais celle de l’Ohio a fait l’actualité pendant la campagne, puisque c’est là que la communauté haïtienne était accusée par Donald Trump de manger des chats et des chiens. Après quoi nous nous sommes rendus en Pennsylvanie, et avons sillonné cet Etat absolument crucial, partant de Butler (l’endroit où Donald Trump a failli se faire assassiner), jusqu’à Gettysburg, en passant évidemment par Pittsburgh. Puis nous avons fait escale à Washington D.C. avant de bifurquer vers le sud, le long de la côte, ce qui nous a fait traverser la Virginie, la Caroline du Nord, la Géorgie, pour arriver à West Palm Beach, en Floride (la ville où est Mar-a-Lago), le but de notre voyage. Nous avons garé le camping-car juste en face du club de golf de Donald Trump.
Philippe Meyer :
Puisque Mar-a-Lago était votre destination, vous aviez donc prévu dès le début de vous intéresser davantage à Donald Trump, plutôt qu’à la Californie de Kamala Harris, à l’autre bout du pays ?
Richard Werly :
C’est juste. Mais c’était pour deux raisons : d’abord, il n’y avait moins de swing state dans l’Ouest des Etats-Unis. Je rappelle qu’étant donné le système de l‘élection présidentielle américaine, où c’est un collège électoral qui élit le président (les fameux « grands électeurs »), il y avait sept Etats « clefs » : Le Wisconsin, le Michigan, l’Arizona, le Nevada, la Caroline du Nord, la Géorgie et la Pennsylvanie. L’itinéraire que nous avions choisi nous permettait donc de concentrer davantage d’Etats-clefs. Et puis, la partie Est que nous avons sillonnée est la rust belt (« ceinture de rouille »), ces grands territoires désindustrialisés, dont Detroit est un peu le symbole, qui allaient vraisemblablement faire cette élection. Et ça a été le cas. Notons cependant que les deux Etats-clefs du sud-ouest (Arizona et Nevada) ont aussi basculé dans l’escarcelle de Trump.
Philippe Meyer :
Cherchiez-vous quelque chose de précis, ou bien avanciez-vous « le nez au vent », recueillant les impressions et les confidences au fil du voyage, dans les lieux propices (fast-foods, restaurants, bars, églises …) ? Où avez-vous jeté votre ligne dans cette partie de pêche ?
Richard Werly :
Ce genre de road-trip est toujours un mélange entre une partie scénarisée, planifiée à l’avance (aller à tel et tel endroit pour observer ceci ou cela), et une autre qu’on laisse libre pour les surprises de l’itinéraire. J’avais une intuition, qui s’est avérée juste : le camping-car allait nous permettre de voir les Américains « à hauteur de pare-brise ». Habituellement, en tant que journaliste, on se déplace en voiture, et on dort dans des motels au bord de la route (qui sont absolument partout aux Etats-Unis), mais en réalité on ne voit pas vraiment les gens avec qui on n’a pas pris rendez-vous. En camping-car en revanche, vous êtes obligés de dormir dans un campground, l’un de ces campings qui accueillent ce genre d’engins. Et là, vous rencontrez des gens, autour de leur propre camping-car. Et c’est un tout autre rapport aux gens que de les rencontrer là, ou bien au Walmart pendant qu’ils font leurs courses … Et puis, j’en avais rajouté en m’habillant systématiquement du survêtement rutilant de Blick, d’un rouge très voyant. Plus facile pour briser la glace. Entre notre camping-car (très imposant, neuf mètres de long !), les survêtements flashy, le fait de venir de Suisse, les Etats-Unis étant un pays de « bons clients », tout de suite, on suscitait à la fois la curiosité et la sympathie, et les gens venaient nous parler. Le récit de ce road trip est une série de dix épisodes, lisibles gratuitement sur Blick.fr, et dans chacun d’entre eux, nous connaissions les destinations, mais nous n’avions rien « verrouillé », les personnages rencontrés se sont imposés d’eux-mêmes.
Philippe Meyer :
La Suisse existe-t-elle pour les Américains que vous avez rencontrés ?
Richard Werly :
Non. Sauf dans un seul endroit (et c’est d’ailleurs pour ça que nous avions décidé d’y aller), à New Bern, en Caroline du Nord, « la nouvelle Berne », fondée au XVIIIème siècle par un membre d’une famille aristocratique assez connue en Suisse, les von Graffenried. On y voit l’ours de Berne (symbole de la capitale fédérale suisse) absolument partout, accompagné du drapeau suisse. C’est évidemment un gimmick touristique, mais c’est le seul endroit où des Américains nous ont parlé de la Suisse …
Philippe Meyer :
Et ces « nouveaux Bernois » vous-ont ils appris des choses particulières sur les Etats-Unis ?
Richard Werly :
Oui, l’escale de New Bern était intéressante. Sur le site de Blick, vous pourrez trouver une petite vidéo où tous les clichés sur la Suisse y passent : l’argent, le chocolat, la paix, la neutralité, les montagnes … Et une Américaine a même tenté la « gastronomie », ce qui était flatteur, mais nous a tout de même laissés un peu perplexes.
Dès le début du voyage, nous pouvions sentir que le vent qui soufflait était trumpiste. Il ne faisait aucun doute que ces populations que nous rencontrions dans les campgrounds, ou en dehors des rendez-vous pris à l’avance, votaient pour Trump. Mais lorsque nous nous entretenions avec des professeurs d’université, des activistes ou des collectifs défendant l’avortement (avec qui nous avions pris rendez-vous), on avait l’autre Amérique, celle qui ne voulait pas de Trump. Mais une Amérique étonnamment silencieuse : si vous n’alliez pas la voir, vous ne l’entendiez pas. Alors que les partisans de Trump étaient au contraire très vocaux. Il n’y a qu’un seul endroit où nous avons vu l’Amérique de Harris manifester : à Gettysburg (champ de bataille majeur de la guerre de sécession), sur le « rond-point » de Lincoln Drive, il y avait un collectif (surtout composé de femmes) manifestant en faveur du droit à l’avortement. Mais c’est le seul moment où nous avons vu l’Amérique de Kamala Harris s’exprimer de façon non sollicitée.
Philippe Meyer :
Je me souviens que nous avions discuté pendant que vous étiez au Etats-Unis, à un moment où tous les sondages étaient très serrés, et sans vous risquer à me faire un pronostic définitif, vous m’aviez fortement fait comprendre que la tendance était plutôt du côté de Trump, notamment parce que Kamala Harris était absente …
Richard Werly :
Totalement absente du débat public, en effet ; je veux dire par là : la conversation que vous aviez dans la rue. Elle était présente dans les médias, et le défilé de stars s’exprimant en sa faveur était impressionnant, mais dans les conversations du quotidien, c’était clairement Trump. C’est ce qui explique que dans mes articles, je prenais beaucoup de précautions. Car c’était un peu la limite du camping-car de neuf mètres : c’est pénible à conduire et surtout à garer, particulièrement dans les grandes villes. Par conséquent, nous les avons un peu évitées, alors que c’était précisément les « réservoirs » d’électeurs démocrates. Toutes la question était donc : ces Démocrates citadins allaient-ils se mobiliser ? La réponse a été non.
Philippe Meyer :
A propos de la campagne elle-même, les médias français en ont souvent souligné la violence. Il y a eu la tentative d’assassinat de Trump, et puis la violence verbale : les insultes, le ton extrêmement agressif, les fake news (les Haïtiens qui mangent les animaux domestiques). Tout cela faisait apparaître un niveau de tension très élevé, que certains analystes décrivaient comme une sorte de guerre civile larvée. Etait-ce aussi votre impression ?
Richard Werly :
Je pense que ce scénario était dans la tête de tous les Américains qui réfléchissent. Je veux dire par là : qui ne se contentent pas de gober tout ce que la télévision leur raconte (quel que soit le camp). Tous ceux-là étaient très inquiets du degré de polarisation. Nous avons par exemple rencontré un armurier au sud de Washington D.C, plutôt plus ouvert que ce que nous n’imaginions pour un Républicain acharné à défendre le port d’armes, et il nous disait très nettement que ce risque de guerre civile existait : des clients venus acheter des munitions « au cas où » … Ce scénario reposait sur une peur : celle d’un résultat si serré qu’il allait être contesté par l’un des deux camps. Comme vous le rappeliez, les sondages étaient serrés, et Donald Trump avait déjà déclaré que de toutes façons, il était inconcevable qu’il perde. Autrement dit, s’il avait été perdant, il aurait accusé Kamala Harris de lui avoir « volé » l’élection.
Mais à partir du moment où il a été clair qu’il avait gagné, et de façon incontestable, cette crainte là s’est dissipée. Les Démocrates avec qui je parlais se sont très vite résignés : « on a perdu. On passe à autre chose ». C’est la bonne nouvelle de cette élection de Trump (quelle que soit l’opinion qu’on a de sa personne) : elle était claire et incontestable, ce qui a désamorcé certaines tensions politiques. Désormais, reste à savoir ce que seront les réactions des populations aux mesures qu’entend prendre Trump une fois en exercice.
Philippe Meyer :
Il reste la question habituelle dans chaque élection démocratique : les gens ont-ils voté pour tel candidat, ou contre tel autre ? Vous avez dû rencontrer d’anciens électeurs démocrates ayant changé de camp. A votre avis, étaient-ils plutôt pour Trump, ou contre Harris ?
Richard Werly :
J’ai rencontré trois types d’électeurs de Donald Trump. D’abord, le trumpiste convaincu, celui qui a déjà voté Trump en 2016, qui est persuadé que le résultat de 2020 était frauduleux, et qui a de nouveau voté Trump en 2024. Ce type d’irréductible est véritablement le « chaudron » trumpiste, c’est l’Amérique réactionnaire, persuadée que Trump détient la solution de tous les problèmes du pays, bref, tous ceux qui veulent le programme de Trump à la lettre, et qui aiment le personnage. C’est le vote d’adhésion.
Le deuxième type est plutôt un vote bourgeois, des classes moyennes supérieures, qui vous disent : « on va voter Trump pour sa politique. On sait que le personnage est un clown, voire un barjot, mais ce qu’il veut faire nous intéresse. ». Des gens qui prennent Trump avec des pincettes, comme s’il était possible de dissocier le personnage de sa politique. Personnellement, je ne crois pas que ce soit possible, et les nominations qu’il a annoncées depuis sa victoire semblent me donner raison.
Enfin, il y a ceux qui auraient été prêts à se mobiliser pour un candidat démocrate, mais ont été rebutés par deux conditions non remplies à leurs yeux par Kamala Harris. D’abord une candidate qui leur parle de leur quotidien économique : comment boucler les fins de mois ; et il faut bien reconnaître que Kamala Harris n’a pas fait cela. Et puis, les femmes de plus de 40 ans qui en ont voulu à Harris de les réduire à la question de l’avortement. Il y a tout un électorat féminin qui n’est pas pro-Trump, qui avait voté Biden en 2020, au moment où Trump était en plein délire à propos du Covid, et qui n’ont pas suivi Harris parce qu’elle ne leur a pas parlé d’économie, mais seulement d’avortement.
Philippe Meyer :
Il y a eu quelques surprises du côté des votes « ethniques ». Les Noirs, les Latinos n’ont pas du tout suivi les Démocrates, comme on pouvait s’y attendre.
Richard Werly :
J’ai un exemple très simple : au sud du Texas, à Boca Chica, se trouve la base de lancement de SpaceX, les fusées d’Elon Musk. Boca Chica, à deux pas de la frontière avec le Mexique, est située dans le comté de Cameron, dont la ville principale est Brownsville. Ce comté n’avait jamais voté républicain, de toute son histoire. Pour la première fois, il a basculé. Autrement dit, Trump a su conquérir un vote nouveau. Et dans le comté de Cameron, il y a énormément d’hispaniques, c’est là qu’est le fameux mur de Trump. Je ne veux pas généraliser, mais pourquoi ces hispaniques ont-ils voté Trump ? D’abord parce qu’ils pensent qu’il va les enrichir, ensuite par ce qu’il est le candidat qui va repousser les nouveaux migrants, sous-entendu : « ceux dont on ne veut pas, nous, les migrants déjà installés ». On trouve toujours une excuse pour dire que le nouveau migrant est moins bienvenu que vous ne l’avez été vous-même : les cartels de drogue ou que sais-je encore.
Pour les Noirs, c’est différent. L’électorat noir s’est scindé en deux, entre les femmes et les hommes. Les femmes sont restées fidèles aux Démocrates et ont majoritairement voté Harris, mais pas les hommes. Quand je leur demandais pourquoi, j’avais toujours à peu près les mêmes réponses : d’abord elle a passé sa vie de procureur à envoyer des Noirs en prison, donc on ne peut pas lui faire confiance, et deuxièmement : « Trump parle comme un homme doit parler ». On bute là sur le non-dit de cette campagne : toute une partie de l’Amérique, quelle que soit son origine ethnique, était réticente à voter pour une femme.
Philippe Meyer :
A propos des fariboles que Donald Trump a racontées, et qui ont été abondamment répandues et amplifiées par le camp républicain, les gens avec qui vous vous entreteniez dans les Walmart ou dans les campgrounds étaient-ils dupes ? Pensaient-ils que ça faisait partie du jeu, ou croyaient-ils réellement que les Haïtiens mangeaient leurs chiens ? Quelle est la distance entre la théâtralisation de la campagne et le ressenti des électeurs ?
Richard Werly :
Il y a eu un excellent article du New York Times à ce sujet, qui titrait : « après le 5 novembre, Trump ressemble à l’Amérique » Ce que nous appelons « théâtralisation » ou « fariboles », c’est désormais une grande partie de l’Amérique d’aujourd’hui. Pour ces gens-là, il n’est peut-être pas vrai que les Haïtiens mangent les chats et les chiens, mais … Peut-être qu’ils l’ont fait quand même ? Toute une partie de l’Amérique m’a honnêtement fait peur : prête à gober des énormités, sans les questionner, et ravie de les colporter. C’est une Amérique qui a peur, et génère de la peur en réaction.
Il y a tout de même un domaine où il faut reconnaître que Donald Trump a fait très fort, et c’est cet aspect scénique. Il y a ce qu’il dit d’un côté, et ce qu’il fait sur scène de l’autre. Il réussit tout de même à rendre mythique sa danse sur YMCA, alors qu’elle est parfaitement ridicule. Il a réussi à adhérer à un certain imaginaire américain, au point que les gens dans la rue reprenaient cette danse sur le tube des Village People …
Philippe Meyer :
On pourrait hasarder l’hypothèse qu’il a réussi à abolir le ridicule, ce qui est important pour des gens qui ne sont pas très sûrs de leur place dans la société, ou de leur statut.
La taille de votre camping-car vous a empêché d’aller dans les grands villes universitaires, les plus European friendly, c’est dommage ...
Richard Werly :
Ah mais nous y sommes allés ! Simplement : sans le camping-car, on se garait en banlieue … Nous avons fait trois haltes comme ça : d’abord à Lansing, Michigan, où se trouve l’une des deux grandes universités de l’Etat. J’y ai interviewé deux professeurs du département de sciences politiques, qui me disaient que selon tous leurs indicateurs, Trump avait clairement le vent en poupe. Puis à Washington D.C, à l’université de Howard, où Kamala Harris avait prévu de faire sa soirée électorale en cas de victoire. Là, on voyait bien qu’une partie de l’électorat noir masculin penchait pour Trump. Enfin, même si ce n‘était pas une grande ville, à Savannah, au sud de la Géorgie, siège d’une université très réputée, la Savannah State University, l’un des premiers College où les Noirs pouvaient aller à l’époque de la ségrégation. Là, un sociologue avec qui je me suis entretenu m’a expliqué en quoi le trumpisme était une lame de fond. Dans ces endroits aussi, tout corroborait mes observations : l’incapacité du camp démocrate à mobiliser. A Savannah, j’ai assisté à un meeting de Tim Walz, le co-listier de Kamala Harris (homme blanc, gouverneur du Minnesota) qui mobilisait, mais pas énormément de gens, surtout des femmes, et qui n’a pas dit un mot sur l’économie, ce qui m’a beaucoup étonné. Tout son argumentaire était sociétal, axé sur le vote des femmes et le droit à l’avortement, avec ce slogan : « ne laissez pas Trump entrer dans vos chambres à coucher ».
Philippe Meyer :
Ces deux co-listiers, Tim Walz pour Kamala Harris, et le nouveau vice-président James David Vance pour Donald Trump, comment ont-ils existé pour vous ? Les gens que vous rencontriez vous en parlaient-ils ? En Europe, Tim Walz était porté aux nues, décrit comme ce que l’Amérique pouvait avoir de meilleur : solide, bon père de famille, excellent « coach » sportif … A l’inverse, JD Vance sentait le soufre : quelqu’un aux opinions versatiles, prêt à renchérir sur toutes les outrances de Trump …
Richard Werly :
On m’en parlait, oui. Tim Walz existait, avec l’image que vous dites, mais étonnamment, il n’est pas devenu le pendant économique et social de Kamala Harris. Au fond, il récitait le même discours qu’elle. Les gens m’en parlaient, mais on sentait que ça ne « percutait » pas, qu’il n’y avait pas une empreinte Tim Walz.
JD Vance, c’était complètement différent. D’abord parce qu’il est impossible d’exister à côté de Donald Trump, il n’y a tout simplement pas de place. On s’en aperçoit d’ailleurs en ce moment, dans cette période de transition : tous les communiqués sont signés « Trump-Vance », mais on ne voit JD Vance nulle part. Aucune existence médiatique scénique, donc. En revanche, il a tenu une grande place intellectuelle : il a fourni une bonne partie du narratif, qu’on peut retrouver dans son livre (non encore traduit en français) Hillbilly Elegy (« Élégie des ploucs »), dans lequel il raconte son itinéraire : issu d’une famille déshéritée du Kentucky, déménagement dans l’Ohio, mère droguée … une histoire apocalyptique. La façon dont il s’en est sorti, grâce à une grand-mère qui l’a pris sous son aile, à son engagement dans l’armée qui lui a permis d’obtenir une bourse, et d’intégrer la prestigieuse université de droit de Yale. Bref, il fournissait à Trump tout le narratif permettant de couvrir l’ensemble du spectre et faire oublier qu’il n’était pas seulement un promoteur immobilier new-yorkais.
Philippe Meyer :
On comprend aisément comment il est impossible d’exister à côté de Trump, mais cela signifie que Vance existera derrière lui, et sans doute après lui. A moins que Trump ne se représente sans lui, Il va forcément peser un peu plus chaque année …
Richard Werly :
En théorie, Trump ne peut pas se représenter, car la Constitution américaine n’autorise que deux mandats présidentiels, ou plus exactement elle ne permet d’être élu que deux fois à la présidence. Il se trouve que Donald Trump évoque le sujet sur le ton de la plaisanterie, mais est-on jamais vraiment sûr de ce qui est sérieux avec lui ? Il dit : « ah mais peut-être qu’on pourrait changer ça … ». Mais normalement, selon la Constitution, c’est son dernier mandat.
Il est évident que JD Vance est son successeur désigné. Je pense que ce choix de vice-président s’est avéré judicieux, parce que JD Vance est un produit difficile à classer. A écouter ses opinons d’aujourd’hui, il est clairement réactionnaire, mais elles ont changé au fil du temps. Il a permis trois choses à Trump. D’abord le narratif « rêve américain ouvrier » dont je parlais, cette capacité de s’arracher à sa condition sociale pour grimper les échelons, la success story dont les Américains raffolent. Ensuite, son passage dans l’armée, qui manque cruellement à Trump. Enfin, il a ses propres milliardaires qui le suivent, et notamment Peter Thiel, un autre libertarien réactionnaire, mais fâché avec Elon Musk, qui est resté dans l’orbite trumpiste via JD Vance.
Philippe Meyer :
Venons-en à Elon Musk. Occupait-il une place dans vos conversations avec l’Américain moyen ? On peut être étonné de la place qu’ il a prise dans cette élection : un personnage très difficile à cerner, mais aux antipodes de l’Américain moyen, justement ?
Richard Werly :
Pour moi, c’est une découverte. L’un des premiers livres que j’ai achetés en arrivant aux Etats-Unis est sa biographe autorisée, par Walter Isaacson (parue en 2023). Avant de la lire, je ne connaissais pas le personnage autrement que par ce que j’en lisais dans les journaux. Et je me suis rendu compte de deux choses : d’abord, je n’avais pas compris à quel point il apportait à Trump la dimension du nouveau rêve américain. Le nouvel horizon. Avant lui, le seul horizon de Trump consistait à construire des gratte-ciel avec son nom écrit en gros. Avec Musk, il gagne une porte d’entrée dans l’imaginaire américain de la conquête. Je n’ai rencontré personne se contentant de me dire que Musk n’était que dingue. Les gens ajoutaient toujours : « il est dingue, mais … » il fait de grandes choses, il va réussir à aller sur Mars, à faire ce que la NASA ne parvient plus à faire, etc. Je ne suis pas sûr que Trump aurait pu toucher un spectre si large de l’électorat américain sans Elon Musk.
Deuxième élément que j’ai pu constater en allant au Texas, dans l’une des Gigafactories de Tesla, et sur le site de lancement de Boca Chica, c’est que Musk, c’est du sérieux. Vous voyez les installations, vous voyez ce qu’on y fait, vous voyez qu’il s’agit de réelles prouesses technologiques. Il a vraiment réussi à rendre des fusées réutilisables, ce que toute l’industrie aérospatiale mondiale rêvait de faire depuis des années (car cela baisse drastiquement le coût des vols spatiaux, et ouvre donc la porte à la conquête de Mars). Au pied de ces gigantesques lanceurs de fusées, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire : « quand même …! » Elon Musk a donné au narratif de Trump une force de percussion que j’avais sous-estimée. Je croyais que sa réputation était exagérée, mais je m’étais trompé. A Brownsville, Texas, c’est la ruée, non pas vers l’or, mais vers Mars. Dans cette ville un peu paumée, un restaurant français vient d’ouvrir, pour les cadres de SpaceX …
Philippe Meyer :
Musk représente ce nouveau rêve américain, mais est-ce qu’au cours de vos conversations, vous avez perçu que ce « rêve 2.0 » était désormais sans l’Etat ? Sans la puissance publique ?
Richard Werly :
C’est une énorme question. En schématisant un peu, je dirais que quand vous traversez les USA, l’Etat n’a pas bonne presse. Très peu de gens l’aiment, vous entendez le plus souvent qu’il intervient trop. Et à chaque fois qu’on parlait d’Elon Musk, j’entendais : « la NASA n’y arrive plus, elle est devenue bureaucratique, ce ne sont plus des ingénieurs mais des administrateurs » Elon Musk a démontré que le secteur privé pouvait réussir dans des domaines où l’on n’imaginait pas qu’il soit possible de faire quoi que ce soit sans l’Etat. Mais avec un mode opératoire qu’on peut trouver remarquable ou effroyable : il lance ses fusées, quand elles explosent ou tombent, il recommence, sans toutes les considérations dont s’embarrasse la NASA. Et c’est la même idée avec Tesla ou Neuralink : les régulations étatiques empêchent les réalisations d’envergure, ce ne sont que des freins. D’où la mission que lui a confiée Trump : raboter l’Etat fédéral, jugé obsolète et pesant.
Philippe Meyer :
On imagine mal comment Musk peut à la fois diriger toutes ses entreprises et occuper ce poste auquel on vient de le nommer, celui de « tronçonneur » de l’administration américaine, pour reprendre l’image qu’utilise le président argentin Milei . Au cours de vos conversations, aviez-vous le sentiment que vos interlocuteurs étaient prêts pour cette « tronçonneuse » ?
Richard Werly :
Oui. Une bonne partie de la population américaine est prête à cette « tronçonneuse », à amputer l’Etat de certains de ses programmes. D’abord parce que les gens estiment que l’argent public est mal utilisé, et qu’il se perd dans les dédales d’une bureaucratie hypertrophiée. Ensuite, parce que l’Etat auquel les Américains ont affaire dans leur quotidien n’est pas l’Etat fédéral, mais leur Etat « local », l’un des cinquante. Cet Etat à dimension « régionale », les Américains y sont très attachés. L’Etat fédéral en revanche est la cible de toutes les critiques, même si les programmes de Joe Biden ont eu une influence positive sur l’économie, qui, ironiquement, profitera à Donald Trump. C’est la grand injustice du jeu politique : les énormes travaux d’infrastructure de l’Inflation Réduction Act de Joe Biden commencent à porter leur fruits dans l’économie américaine, mais les gens ne le voient pas. Ils ne le sentent pas, et estiment que Washington DC est devenu une machine incontrôlable, qui mérite ces coups de tronçonneuse.
Rappelons cependant que Musk n’occupera pas l’équivalent d’un « ministère », Trump n’a pas créé de nouveau secrétariat d’Etat. L’équivalent français serait à peu près un « haut commissaire à la réforme de l‘Etat ». Musk affirme qu’il va supprimer 2.000 milliards de dollars de dépenses publiques, sur un total de 6.000 milliards.