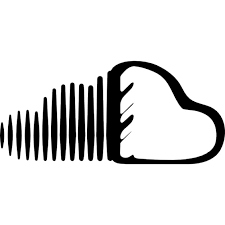LA GAUCHE DÉCOMPOSÉE ?
Introduction
ISSN 2608-984X
Philippe Meyer :
Les relations se sont tendues entre le Parti socialiste et La France Insoumise, après le choix des députés socialistes de ne pas voter le 16 janvier la motion de censure défendue par le reste du Nouveau Front populaire. Selon le PS, les « concessions » programmatiques obtenues durant leurs longues tractations avec le Premier ministre justifiaient de ne pas le sanctionner immédiatement. Les socialistes ont notamment obtenu que les déremboursements prévus sur les médicaments et les consultations soient remis en question et que des crédits supplémentaires soient accordés aux hôpitaux, sans oublier le maintien de tous les postes dans l’Éducation nationale et le renforcement des dispositifs de justice fiscale, notamment pour les plus hauts patrimoines.
L’initiative du PS, qui se définit toujours comme un « parti d’opposition », ouvre cependant une brèche à gauche et acte la confrontation avec Jean-Luc Mélenchon. Deux gauches coexistent, comme cela a toujours été. Elles sont de nouveau entrées en compétition. Tenant de la gauche réformiste, François Hollande observe que « les socialistes constituent désormais le pôle central au sein de l’Assemblée nationale puisque rien ne peut se faire sans eux ni contre eux. Ils ont la clef jusqu’en 2027 ». Il a enfoncé le clou en estimant qu’en 2027, il faudrait « deux offres à gauche », l’une réformiste et l’autre radicale. De quoi remettre de facto en cause la stratégie du premier secrétaire du parti, Olivier Faure, qui espère construire avec ses homologues écologistes et communistes une candidature unique alternative à celle de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier a hurlé à la « trahison », mais s’est toutefois gardé de sceller la rupture définitive avec le PS qui, pour lui, n’est « plus un partenaire », mais un « allié de circonstance ». Rêvant de renverser de nouveau le gouvernement et de provoquer une présidentielle anticipée, l’ancien sénateur a plus que jamais besoin des voix de son ancien parti pour voter la censure, lors du vote sur le budget, le 3 février]. Dimanche dernier, le second tour de l’élection législative partielle de la première circonscription de l’Isère a été une véritable déroute de LFI et, partant, du NFP. La candidate d’Ensemble, a remporté largement la circonscription détenue par LFI. L’ampleur de cette défaite fait de cette élection partielle un événement de portée nationale au moment où le NFP se décompose au niveau national.
Kontildondit ?
Michaela Wiegel :
Même s’il faut toujours rester prudent en ce qui concerne les processus de décision au sein du PS, on peut tout de même se risquer à dire qu’aujourd’hui, la France est en train de se « dé-présidentialiser », et de se rapprocher d’un régime parlementaire à l’allemande. Sans crier garde, François Bayrou a fait de l’Assemblée nationale le centre des décisions et des négociations ; il a en quelque sorte privé de façon assez subtile le président Macron de ce pouvoir vertical qu’il avait exercé pendant son premier mandat, où les députés de sa majorité se contentaient de lui obéir.
Il est assez cocasse de constater que François Bayrou est en train de réussir là où tous ses prédécesseurs ont échoué : ni Gabriel Attal, ni Élizabeth Borne n’avaient pu trouver un tel pacte de non-agression avec les socialistes. Force est de constater que sur les 66 députés socialistes, huit seulement ont voté la censure. Et c’est assez compréhensible, dans la mesure où l’électorat LFI est très fort dans leur circonscription. Certes, le test déterminant sera le budget, mais si les choses continuent ainsi, on pourrait vraiment voir se former un bloc central élargi, uni sur au moins trois points.
Tout d’abord, le respect des échéances institutionnelles : ne pas demander la démission du président de la République (contrairement aux députés de LFI ou du RN). Ensuite, ne pas donner de rôle décisif au Rassemblement National. Sur ce point, il était permis d’avoir des doutes avec Michel Barnier, parce que ce dernier, à chaque fois qu’il était mis à l’épreuve par le RN, se pliait publiquement à ses revendications. Ce point a été illustré récemment : quand François Rebsamen avait eu un mot un peu offensant pour le RN, tout le parti s’est offusqué, et a exigé des excuses publiques de la part de François Bayrou. Ce dernier a géré l’affaire assez habilement : il a laissé s’exprimer la porte-parole du gouvernement, qui a déclaré que les déclarations de Monsieur Rebsamen ne reflétaient pas l’opinion de tout le gouvernement. Ce faisant, il a donc réussi à ne pas se plier personnellement aux exigences de l’extrême-droite. Il paraît que Monsieur Bayrou est surnommé « l’anesthésiste », et je trouve que ce surnom n’est pas mal choisi, parce qu’il parvient à calmer un petit peu le débat très exacerbé de l’Assemblée. Enfin, le dernier point unissant le bloc central, c’est la responsabilité de donner un budget à la France.
Il va évidemment s’agir de l’épreuve la plus difficile. On se souvient qu’au mois de décembre, les socialistes étaient encore dans une étape intermédiaire, où ils considéraient que le budget présenté était si mauvais qu’il préféraient faire tomber le gouvernement. Il semble qu’on ait à présent dépassé ce stade. Par ailleurs, on constate aussi que les ministres sont plus libres de s’exprimer, qu’on les respecte davantage, qu’ils ne sont plus seulement liés par une loyauté à toute épreuve, et qu’ils peuvent se risquer à lancer des idées. Dans ces débuts de démocratie plus parlementaire, je vois un pouvoir qui s’exprime moins verticalement, et du côté du président, une tentative de reprendre la main avec cette idée des référendums.
Richard Werly :
La gauche française est-elle particulièrement décomposée ? D’un point de vue géographique d’abord, l’est-elle davantage qu’en Espagne, en Italie ou qu’en Allemagne ? Je rappelle qu’outre-Rhin, il y a une gauche radicale très forte qui flirte avec certaines idées d’extrême droite (je pense au parti de Sahra Wagenknecht). Je pense que la question de la gauche décomposée pourrait être posée à l’ensemble de l’Union Européenne : il y a un problème d’effritement structurel ou en tout cas d’incapacité de la social-démocratie à retrouver un modèle séduisant pour les électeurs. La France n’est au fond que l’illustration d’un paradigme européen, à savoir qu’à la gauche de l’échiquier politique il y a deux forces qui ne sont aujourd’hui plus capable de se parler, que le régime soit présidentiel ou parlementaire. D’un côté, la gauche social-démocrate, compatible avec l’économie de marché et avec ce que Michaela appelle le « bloc central » ; de l’autre, la gauche radicale, qui nourrit cette idée révolutionnaire d’une autre forme de gestion possible du politique et de la chose publique.
D’un point de vue historique, ensuite, le clivage de la gauche française ne date pas d’hier. J’ai entendu resurgir ces temps-ci, les comparaisons avec le congrès de Tours de 1920, en raison des fractions du parti socialiste. L’idée que la gauche est décomposée - ou en tous cas divisée - et donc ancienne et ne l’a jamais empêchée de gouverner ni d’assumer des responsabilités pendant des années. En revanche, et c’est un point où je ne suis pas d’accord avec Michaela, l’une des raisons de cette décomposition de la gauche, c’est précisément qu’on reste dans un syndrome présidentiel.
Si Jean-Luc Mélenchon tient encore aujourd’hui, c’est parce que, outre son talent et sa stature personnels, il fait tout pour convaincre l’électeur de gauche qu’il est le seul candidat possible à la prochaine présidentielle de 2027. Il rappelle qu’il n’a été éliminé du second tour de l’élection de 2022 que de justesse. Il n’était pas si loin de Marine Le Pen et reste persuadé qu’il a ses chances. Ce qu’il veut absolument, c’est un duel contre Mme Le Pen, c’est là-dessus qu’il a bâti tout son projet politique.
Il y a enfin un élément intéressant : la gauche décomposée ne correspond pas à ce que veulent les électeurs. En France, quand vous parlez avec des électeurs de gauche, le mythe de l’union de la gauche reste très présent, ce qui prouve que la gauche n’est décomposée qu’au niveau des appareils. Elle n’arrive pas à s’entendre pour des raisons de personnalités et de projets, mais dans les représentations, les sympathisants de gauche rêvent d’une candidature unique. Et à quel scrutin ? Je vous le donne en mille : la présidentielle. Pour l’électeur français de base, tout se joue au moment de la présidentielle, et une gauche qui n’y aurait pas de candidat unique et quasiment certaine de perdre.
J’aurais tendance à dépassionner ce débat : je pense qu’il y a une conjoncture difficile pour la gauche, mais qu’elle n’est pas particulièrement plus décomposée aujourd’hui qu’elle ne l’a été par le passé. Ce qui est frappant en revanche, c’est qu’il y a une très forte incarnation de la gauche radicale autour de M. Mélenchon et du projet des Insoumis ; tandis que de l’autre côté, celui de la gauche, «socialo–démocrato–écolo », il y a un vrai manque d’incarnation. Et dans un pays comme la France, c’est un gros problème.
Michel Eltchaninoff :
Au fond, ce qui donne l’impression que la gauche française est décomposée, c’est qu’elle est en recomposition permanente, depuis des décennies. Parce qu’il y a en son sein des visions du monde très différente, entre une gauche hier communiste et anticapitaliste, et une gauche social-démocrate, ou social-libérale avec François Hollande. Aujourd’hui, ces visions opposées subsistent, on le voit régulièrement à propos des questions internationales. On l’a observé pendant la dernière campagne des européennes, entre un Raphaël Glucksmann très engagé pour l’Ukraine et une France Insoumise se prétendant être le parti de la paix. En réalité, cette opposition entre un pôle d’égalité et un pôle de liberté a toujours existé.
Il ne faut pas oublier une chose très importante, c’est que le Nouveau Front Populaire est un rassemblement créé dans l’urgence, avec un programme bricolé à la va-vite ; ceux qui ont écrit ce programme le savaient parfaitement et le sous-entendaient presque. Le but était très clair : s’opposer à l’accession au pouvoir du Rassemblement National. Et le NFP a parfaitement joué ce rôle : la mobilisation de l’électorat de gauche a permis d’empêcher cette arrivée au pouvoir du RN. Mais à présent, la gauche social-démocrate fait face à une deuxième urgence : empêcher une crise institutionnelle, empêcher des élections présidentielles anticipées, et comme le disait Richard, empêcher que le rêve de Jean-Luc Mélenchon ne se réalise, à savoir celui d’un match entre lui et Mme Le Pen, qui poserait des cas de conscience terribles à beaucoup d’électeurs. En juin, le PS a géré l’urgence et a réussi. Aujourd’hui, en acceptant de ne pas censurer le gouvernement, il tente de stabiliser la situation, de jouer un autre rôle et d’empêcher un deuxième écueil, qui serait l’option révolutionnaire de Jean-Luc Mélenchon.
Cette opération comporte deux gains et deux risques. Le premier gain est la réouverture de l’option social-démocrate dans l’espace politique français. Certes, celui-ci, manque d’incarnation, et il y a encore des questions à propos desquelles la social-démocratie n’est pas assez programmatique, n’a pas assez d’idées, même si aujourd’hui, le PS insiste beaucoup sur le quotidien. Mais tout de même : en acceptant de ne pas censurer le gouvernement, c’est le PS qui a permis la renégociation de la réforme des retraites, si importante pour l’électorat de gauche. C’est un succès non négligeable. Par ailleurs, le parti socialiste a réussi à montrer qu’on pouvait désavouer Emmanuel Macron tout en acceptant de travailler pour la stabilité des institutions. Autrement dit, qu’il est possible d’initier quelque chose de positif sans se rallier au macronisme. Le deuxième gain, c’est d’arrêter d’être tétanisé par les Insoumis, c’est-à-dire de montrer que les socialistes, qui n’ont que quelques députés de moins que LFI, peuvent relever la tête, avoir leurs idées propres, et leurs options politiques. Il est possible de montrer que Jean-Luc Mélenchon n’a pas le monopole de la parole de gauche.
Les deux risques, enfin. Le premier, c’est que cette brouille entre le PS et LFI se transforme en guerre des anciens, à savoir entre Jean-Luc Mélenchon et François Hollande, tous deux largement décrédibilisés. Le premier pour sa violence chavisto–léniniste, qui rebute jusqu’à son électorat, le second par l’échec de son mandat présidentiel. Il faudrait donc de nouvelles têtes. Il y en a quelques-unes au parti socialiste, on pense par exemple à M. Glucksmann qui a fait presque 14 % aux européennes. Et à n’en pas douter, il y a sans doute au sein des deux partis des jeunes désireux de renverser les vieilles idoles, mais c’est sans doute la tâche la plus difficile. Le dernier écueil est le plus inquiétant. Le Nouveau Front populaire n’était qu’une alliance dans le but de bloquer le Rassemblement National. À présent qu’il y a une brouille au sein du NFP, il est permis de craindre pour les prochaines échéances électorales. Les insoumis, les socialistes, les écologistes et les communistes pourront-ils à nouveau faire front commun ? Pour reconstituer un front de gauche, si tant est que ce soit possible, la question du leadership sera déterminante.
Jean-Louis Bourlanges :
J’ai été déconcerté par le ton et la formulation floue de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Comme l’a dit Pascal Perrineau, elle dégage un « charme flou », mais c’est un effet volontaire, et non une faiblesse . Lorsque François Bayrou m’a dit que je devais me faire à l’idée qu’il n’était pas Margaret Thatcher, j’ai compris qu’il avait raison : ce modèle ne peut être importé en France. Il a construit un style particulier, ni mou ni rigide, mais subtil et réfléchi. Ce changement marque une évolution importante de l’assise institutionnelle de son pouvoir. Il s’est affirmé en tant que Premier ministre en revendiquant cette position publiquement, ce qui est une approche nouvelle. Il s’appuie également sur des leviers institutionnels, comme l’article 11, pour renforcer son rôle (le président peut soumettre une question au référendum, mais d’après l’article 11, il le fait « sur proposition du gouvernement »).
Le Premier ministre montre une certaine indifférence face à l’impopularité du Parlement, qu’il considère comme une conséquence naturelle de choix politiques ambitieux. Il applique une stratégie discrète, semblable à celle des présidents du Conseil sous la IVe République : il ne fait pas de déplacement en province, et laisse ses ministres agir librement sur leurs dossiers ; il n’intervient que pour arbitrer les conflits. MM. Retailleau et Darmanin, par exemple, cisèlent une image de droite rigide sur l’immigration et la sécurité, avec des discours marquants, tandis qu’Éric Lombard, connu pour ses anciennes amitiés avec la gauche, négocie avec les socialistes sur le budget. Cette gestion équilibrée reflète aussi ses convictions démocrates-chrétiennes, comme en témoignent ses prises de distance sur des sujets sensibles comme la loi sur la fin de vie.
Cette stratégie séduit les socialistes, car elle répond à leur désir de démocratie parlementaire sans leur poser directement la question de leur rôle comme parti de gouvernement. En évitant cette question, M. Bayrou préfère construire progressivement un terrain favorable, en faisant des concessions habiles, notamment sur les enseignants et les collectivités territoriales. Cependant, cette méthode reporte l’heure de vérité, et une telle procrastination pourrait poser problème. Sa proposition de représentation proportionnelle offre une perspective d’autonomie pour les socialistes, mais son impact dans un paysage politique fragmenté reste incertain. Il semble s’inspirer de la loi de 1986 introduite par François Mitterrand (et qui avait permis à François Bayrou de lui-même devenir député) mais c’était une loi départementale, et je doute de sa capacité à autonomiser durablement les partis dans le contexte actuel.
Jean-Luc Mélenchon, autrefois une figure respectée pour son talent et ses performances électorales, s’éloigne de son image présidentiable, car il se restreint à un électorat limité. Par exemple, son refus de soutenir la libération de l’écrivain algérien Boualem Sansal au Parlement européen illustre cette marginalisation. Cette situation bénéficie indirectement au Rassemblement National, qui se positionne en principal rival du gouvernement. Le RN n’a qu’une idée en tête : maximiser les chances de Marine Le Pen d’entrer à l’Élysée, et son soutien à une motion de censure dépendra uniquement de ses propres intérêts. Quant à LFI, ils ne savent que dire « non ». Les socialistes sont donc dans une position clef pour la survie du gouvernement, car ils sont la seule variable d’ajustement. Cependant, leur unité est fragilisée, rappelant les divisions internes qui ont marqué la fin du quinquennat Hollande. Et c’est le véritable objectif de M. Mélenchon : diviser le PS. Une partie pourrait être tentée de voter une motion de censure, rejoignant LFI et le RN. Cette fragmentation menace le rôle politique central des socialistes et laisse planer une incertitude sur leur capacité à s’affirmer en tant que parti de gouvernement. Le grand problème du Parti Socialiste, c'est la sauvegarde de son unité.
QUELLE PAIX POUR L’UKRAINE ?
Introduction
Philippe Meyer :
Avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les Européens craignent un désengagement des États-Unis dans le conflit en Ukraine, voire des pressions de Washington pour un accord au détriment de Kyiv. Le président américain qui se vantait d'obtenir la fin de la guerre en vingt-quatre heures, parle désormais de cent jours, sans jamais détailler son plan. Les contours d'un accord restent difficiles à imaginer. Le président ukrainien a récemment fait une ouverture en affirmant qu'il était prêt à renoncer à utiliser la force pour récupérer les territoires occupés par la Russie depuis 2014 (20 % de l'Ukraine) ; il a même envisagé un abandon de souveraineté temporaire sur la Crimée et une partie du Donbass, contrôlés par Moscou, en attendant une solution diplomatique. Cependant, Volodymyr Zelensky insiste pour que l'Ukraine soit invitée à adhérer à l'OTAN. De son côté, Vladimir Poutine s'est dit prêt à discuter d'un accord de cessez-le-feu avec Trump, mais exclut toute concession territoriale majeure et insiste pour que Kyiv abandonne ses ambitions de rejoindre l'OTAN.
L'année 2024 aura été difficile pour Kyiv : l'armée russe a avancé en Ukraine de près de 4.000 km2 en 2024 face à des Ukrainiens en difficulté, soit sept fois plus qu'en 2023, et l'année à venir s'annonce incertaine notamment du fait d'interrogations sur la pérennité du soutien américain. En mai 2022, 10% des Ukrainiens se déclaraient prêts à céder des territoires pour parvenir à la paix lors que 82 % y étaient opposés. En décembre 2024, l’écart se resserre : 38 % des Ukrainiens se disent désormais disposés aux concessions territoriales, quand 51 % y restent opposés.
À Varsovie mi-décembre, Emmanuel Macron et le premier polonais, Donald Tusk, ont évoqué la possibilité du déploiement d'un contingent militaire européen en Ukraine, le long de la ligne de front qui s'étend sur quelque 1.000 km. Cette hypothèse pourrait impliquer les armées de pays membres de l'OTAN, ou encore détenteurs de l'arme nucléaire, comme la France et le Royaume-Uni. Intervenant mardi au Forum économique mondial, le président ukrainien a affirmé qu'il faudrait une force de maintien de la paix européenne d'« au moins 200.000 hommes ». Mercredi, Donald Trump a sommé Moscou de trouver un accord pour clore la guerre en Ukraine, faute de quoi il lui imposerait de nouvelles sanctions. En saluant la volonté de Kyiv de chercher un compromis et en évoquant les « gros ennuis » notamment économiques de Poutine, le président américain semble mettre légèrement plus la pression sur le Kremlin, sans évoquer toutefois pour autant la possibilité d'armer l'Ukraine.
Kontildondit ?
Michel Eltchaninoff :
Je pense qu’il n’y a quasiment aucune chance de parvenir à une paix durable en Ukraine. Tout porte à croire que Donald Trump est prêt à sacrifier le pays. S’il y a un cessez-le-feu, ce ne sera au mieux qu’une trêve, donc provisoire. La seule possibilité de paix viable était ce qu’on appelait la paix par la justice, un concept dont le président Zelensky parlait beaucoup. Il s’agit d’une paix assortie de conditions de sécurité, qui assurent l’avenir de l’Ukraine, avec une mise en œuvre de mesures de justice, c’est-à-dire une intégration à l’OTAN, un retrait des troupes russes des territoires occupés, et des mesures de réparation.
Cette notion a disparu, remplacée par celle de paix par la force. Il s’agit d’un concept ancien du parti Républicain américain, utilisé notamment par Ronald Reagan et par Donald Trump lors de son premier mandat. Il consiste à menacer suffisamment les belligérants pour les forcer à s’asseoir autour d’une table. Volodymyr Zelensky lui-même l’a utilisé le jour où il a félicité Trump de son élection. C’est cette logique de paix par la force que semble suivre Donald Trump aujourd’hui, en menaçant la Russie de nouvelles sanctions.
Mais c’est purement rhétorique. La Russie est déjà sous sanctions, et Vladimir Poutine sait pertinemment que Donald, Donald Trump est décidé à obtenir un deal avec lui sur l’Ukraine. Mais surtout, je vois mal l’administration américaine actuelle surarmer les Ukrainiens au nom de la paix par la force. Car c’était l’idée : si les Russes refusent les pourparlers, on renforce l’Ukraine. Donc en réalité, cette notion de paix par la force ne s’inscrit pas du tout dans la logique de Donald Trump, qui consiste à ne pas financer de guerre qui ne concernent pas directement les États- Unis.
Ce qu’on peut espérer de mieux, c’est donc un compromis, ou plutôt ce que le philosophe israélien Avishai Margalit appelle un « compromis pourri ». Un « compromis pourri », dans le contexte de la guerre en Ukraine, cela signifie d’abord des négociations dont les Européens pourraient être exclus, ce qui est tout de même problématique. Cela signifie ensuite une Ukraine sans protection de l’OTAN, voire que l’on forcerait à avoir le statut de pays neutre, ce qui est l’un des buts de guerre de Vladimir Poutine. Il est de toutes façons certain que le président russe refusera catégoriquement une intégration de l’Ukraine dans l’OTAN : rappelons qu’en automne 2021, quelques semaines avant l’invasion, la Russie avait formellement demandé à Washington de dire que l’Ukraine n’intégrerait jamais l’alliance atlantique. Si c’est ce vers quoi nous allons, les Ukrainiens se sentiront purement et simplement - et bien légitimement - abandonnés par l’Occident.
Ensuite, ce serait une Ukraine encore plus déstabilisée. Un sondage récent disait qu’en cas d’accord impliquant une démobilisation, plus de 20 % des Ukrainiens avaient l’intention de quitter le pays. On aurait donc un pays encore plus exsangue qu’il ne l’est aujourd’hui. On entend parler ces jours-ci d’envois de troupes européennes, mais c’est très compliqué à plusieurs niveaux. D’un point de vue européen d’abord, je ne sais pas si les parlements nationaux devront être consultés, mais je doute que le RN et LFI acceptent qu’on envoie des troupes françaises en Ukraine … Ensuite, il faudrait des accords entre Européens. De toutes façons, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe a déclaré il y a trois jours qu’il n’était pas question que des troupes des pays de l’OTAN viennent s’interposer en Ukraine. Tout cela est donc bien mal parti.
Enfin, il reste les conditions. Le 19 décembre dernier, il y avait ce grand évènement médiatique russe, « la ligne directe », au cours duquel Poutine parle aux journalistes et à son peuple. Et il y a dit les choses suivantes : d’abord que la Russie est toujours prête à des négociations, et que la politique est l’art du compromis. A priori, une posture d’ouverture. Mais il a ensuite détaillé ses conditions. Premièrement, ne pas parler avecZelensky, considéré comme illégitime depuis qu’il a reporté les élections élections présidentielles du printemps 2024. Deuxièmement, il ne faut pas que les intermédiaires de la paix soient des parties prenantes du conflit. Par conséquent, les Américains sont exclus. Dans les faits, cela signifie que Poutine parlera certainement avec Trump, mais en coulisses. Sur la scène, il faudra peut-être faire la paix avec les Chinois. Troisièmement, le président russe exige qu’il ne s’agisse pas seulement d’un cessez-le-feu, il lui faut des garanties de sécurité. Enfin, il y a les buts de guerre : la « dénazification » de l’Ukraine (qui n’est qu’un changement de régime à Kyiv), sa démilitarisation, et une protection de la population russophone.
S’il y a un cessez-le-feu, il mettra des mois pour être mise en place, à mon avis beaucoup plus de 100 jours. Et comme il sera en défaveur des Ukrainiens, il n’arrêtera pas vraiment la guerre, parce que les Ukrainiens la reprendront au bout d’un certain temps. Au fond, ce qu’on peut espérer de mieux, ce n’est qu’une pause dans la guerre de Poutine contre ses voisins.
Michaela Wiegel :
Je serai un peu moins pessimiste. Non pas concernant les objectifs de Poutine, qui restent clairs : il conteste la légitimité de Zelensky et souhaite ramener l’Ukraine dans l’ensemble russe avec un esprit impérialiste. Cependant, la présidence Trump « saison 2 » ne ressemblera pas à la saison 1. Dès son discours inaugural, le président américain a clairement laissé entendre que le nouvel âge d’or américain serait impérialiste, utilisant notamment le retrait d’Afghanistan comme exemple d’humiliation des États-Unis.
Je pense que tout ce qui pourrait être perçu comme une humiliation de l’Occident, comme l’abandon ou le sacrifice de l’Ukraine, contrarierait cet objectif affiché. Trump cherchera à sortir de cette guerre en position de force, même son nouveau secrétaire d’État, Marco Rubio, a évoqué une durée d’au moins six mois pour ajuster les politiques. Fait notable : dans ses premiers décrets, Trump, malgré la réduction de toutes les aides internationales, a maintenu le soutien américain à l’Ukraine. C’est tout de même un signal fort. Certes, il y aura tôt ou tard une épreuve de force, et nous ne savons pas encore la façon dont les USA en sortiront.
Par ailleurs, le discours du vice-président J.D. Vance lors de la conférence de sécurité à Munich a mis en lumière un objectif américain : pousser les Européens à investir davantage dans leur propre sécurité. Cela devient une priorité, et c’est sans doute sur ce point que la pression va sensiblement monter ces prochains mois. En écoutant jeudi les ministres de la Défense allemands et français, Boris Pistorius et Sébastien Lecornu, j’ai trouvé leurs déclarations éclairantes. Pistorius a averti qu’en 4 à 5 ans, la Russie pourrait redevenir une menace militaire directe pour l’Europe, tandis que Lecornu a évoqué une « zone grise » émergente : cyberattaques, attaques sur les infrastructures critiques et ingérences dans nos démocraties.
En fin de compte, si on analyse la guerre en Ukraine, il est évident que les États-Unis exercent une forte pression sur les Européens pour qu’ils s’équipent davantage et relancent leur industrie de défense, surtout après bientôt trois ans de conflit.
Richard Werly :
Je ne sais pas si certains de nos auditeurs ont suivi l’intervention de Donald Trump au forum de Davos, sa première apparition internationale, bien qu’en visioconférence. Ceux qui l’ont fait l’auront entendu aborder par deux fois la paix et les destructions en Ukraine. Et même si cela pourra surprendre, je tiens à lui rendre hommage pour avoir parlé de manière poignante (même si c’était une instrumentalisation évidente de l’émotion) d’un conflit que je connais bien, ayant visité l’Ukraine à quatre reprises. Ce qu’il a décrit est vrai : un charnier, des villes détruites, une horreur indescriptible. Tous les Ukrainiens que je connais rêvent de paix. Ce pays est à bout, et même une trêve temporaire serait une petite victoire pour l’humanité.
Trump, à sa façon pragmatique de promoteur immobilier, a insisté sur les destructions et la reconstruction à venir. Mais peu importe la méthode, il a pointé une réalité que beaucoup partagent. Par ailleurs, un scénario de type « coréen », avec une zone démilitarisée et une force internationale, a été envisagé, même s’il semble aujourd’hui de plus en plus improbable. Cela a fonctionné pour la Corée du Sud depuis 1953, permettant l’essor économique du pays. Certes, la Russie rejette ce modèle, notamment à cause de la présence possible de troupes de l’OTAN à ses frontières. Mais ce n’est pas parce que la Russie refuse qu’il ne faut pas tenter de l’imposer.
Enfin, je suis consterné par l’absence de coordination de l’Union européenne. On sait que des poids lourds de l’Union comme l’Allemagne, la France ou la Pologne sont mobilisés et prêts à aider davantage, et pourtant, l’UE n’a toujours pas nommé d’envoyé spécial pour l’Ukraine. Alors que Trump, avant même de prendre ses fonctions, avait désigné un émissaire. C’est ce qu’il faut faire. En Europe, Mme Von der Leyen veut être sur tous les dossiers : Davos, l’Ukraine ... Cela suffit. Il faut nommer une personnalité qualifiée assez forte pour être l'envoyée spéciale de l'Union européenne sur le conflit ukrainien. C’est comme cela qu'on verra des ouvertures.
Enfin, et même si c’est très difficile, il faut dire à M. Zelensky qu’il a un problème de légitimité politique. Je ne parle pas ici du report de l’élection présidentielle de 2024, tout à fait compréhensible. Mais les forces politiques ukrainiennes sont en train de perdre leur cohésion. Il est urgent de les rassembler, car ce délitement profite à la Russie.
Jean-Louis Bourlanges :
Je suis très sensible à ce qu’a évoqué Richard. Même si je ne suis pas allé récemment en Ukraine, j’ai discuté avec plusieurs Français vivant là-bas. La semaine dernière, j’ai eu une conversation approfondie avec un homme qui travaille dans le secteur privé à Kyiv et anime une association venant en aide aux blessés, leur offrant des perspectives de réinsertion et de logement. Il m’a décrit un désespoir profond, amplifié par des comportements de fuite, comme dans le cas du bataillon Anne de Kyiv. La corruption pour échapper à la conscription est omniprésente, bien qu’elle coexiste avec l’héroïsme absolu des soldats sur le front, dont le courage face aux Russes est exceptionnel.
Je crois profondément que les Ukrainiens aspirent à la paix. Même si le front résiste et que les Russes peinent à lancer une offensive de grande envergure, la situation actuelle a renforcé le sentiment national ukrainien. Ce patriotisme a désormais consolidé un véritable État. La nation ukrainienne existe pour longtemps, et elle n’est pas prête à plier face à la Russie.
Il faut analyser la situation sous trois angles. D’abord, l’angle ukrainien et européen, à peu près similaire. De ce point de vue, il semble évident que le Donbass et la Crimée ne seront pas reconquis militairement. Un cessez-le-feu, ou même un armistice comparable à celui de la Corée, pourrait être acceptable, à condition que l’Ukraine demeure une démocratie pluraliste et que sa sécurité soit garantie. Cela peut passer par une armée ukrainienne renforcée, aujourd’hui la première armée européenne, mais aussi par des engagements de l’OTAN ou de l’Union européenne, dont l’article 42.7 du traité prévoit une solidarité militaire. Des pays comme ceux qu’a cités Richard y sont prêts, auxquels il faut ajouter les États baltes, la Finlande, la Suède, le Danemark ou encore le Royaume-Uni (qui joue déjà un rôle clé dans cette mobilisation).
Ensuite, l’angle des Russes. Ils rejettent tout règlement permettant à l’Ukraine de renforcer ses capacités. Ils veulent une Ukraine neutralisée, désarmée et sous contrôle russe, voire une « démocratie dénazifiée » calquée sur la Biélorussie, c’est à dire le contraire d’une démocratie ... Certains évoquent même un projet de dépeçage territorial de l’Ukraine, en donnant des morceaux à la Roumanie, à la Pologne, etc. Une politique de « pourboires » en somme, totalement révoltante.
Enfin, l’angle des Américains, sur lequel je suis un peu moins pessimiste. Bien que Trump reste imprévisible, ses récentes déclarations montrent qu’il ne lâcherait pas l’Ukraine, mettant même en garde les Russes sur l’impasse de leur stratégie : « et si je ne bouge pas, qu’allez-vous faire ? Vous seriez bien avancés ». Trump ne pourra pas se contenter de purement et simplement céder aux exigences de Poutine. Cependant, comme la paix qu’il pourrait soutenir ressemblerait probablement à celle désirée par les Européens, cela resterait incompatible avec les exigences de Poutine. Par conséquent, la seule variable me paraît être la négociation entre Européens et Américains sur l’ampleur des efforts de Défense européens, qu’il s’agisse de financements ou d’acquisition de matériel militaire. Cela permettrait aux États-Unis de continuer à soutenir l’Ukraine tout en partageant le fardeau avec l’Europe.
Michel Eltchaninoff :
Je pense que pour Trump, ce qui compte avant tout, c’est de conclure un accord, peu importe son contenu. C’est quelque chose qu’on a déjà observé dans le passé, et cela pose un réel problème. Pour ma part, j’ai passé deux semaines en Ukraine, entre octobre et novembre. J’y ai moi aussi constaté la fatigue et le désespoir des gens, ainsi que leur profond désir que le conflit prenne fin. Cependant, ce qu’ils m’ont dit est révélateur, et corroboré par les sondages du centre Razoumkov : parmi les 38 % des Ukrainiens favorables à des négociations, seule une faible part accepterait un accord défavorable à leur pays. Autrement dit, les Ukrainiens souhaitent évidemment la paix et le retour de leurs soldats, mais pas à n’importe quel prix. C’est là que les choses deviennent complexes.
Enfin, concernant Volodymyr Zelensky, il sait qu’il devra organiser des élections, et les Ukrainiens l’attendent au tournant. Si un accord est trouvé, Zelensky a déjà annoncé son intention de tenir des élections. Il devra alors affronter un adversaire redoutable, l’ancien commandant en chef des forces armées, Valeri Zaloujny, qu’il tente actuellement de rallier à lui pour former un front commun. Mais quoi qu’il en soit, des élections en Ukraine auront lieu.