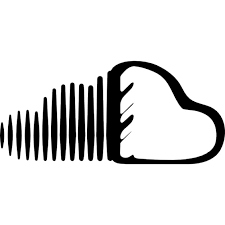ÉLECTIONS ALLEMANDES
Introduction
ISSN 2608-984X
Philippe Meyer :
À quelques semaines des élections législatives allemandes, le 23 février, le dernier baromètre de la chaîne de télévision ARD, indique que 37 % des Allemands considèrent l'immigration ou l'asile comme l'un des deux problèmes politiques auxquels les politiques doivent s'attaquer en priorité, juste devant l'économie (34 %) et très loin devant la guerre et la paix (14 %), l'environnement et le climat (13 %) et l'injustice sociale (11 %).
La succession des attaques au couteau de la part d’étrangers est de nature à populariser le discours antimigrants du parti d’extrême-droite, Alternative pour l'Allemagne (AfD). Partisan de l'avènement d'une politique européenne plus résolue à Berlin, la tête de liste chrétienne-démocrate (CDU) Friedrich Merz, a fait sauter mercredi, le « cordon sanitaire » avec l’extrême droite en proposant un texte plaidant pour un durcissement de la législation en matière d’immigration, qui a obtenu une courte majorité au Bundestag grâce aux voix de l’AfD. Un vote dénoncé par l’ancienne chancelière CDU Angela Merkel. Sur le volet économique, conformément aux prévisions des experts, le produit intérieur brut allemand s’est contracté de 0,2 % en 2024, marquant une deuxième année de récession, après une baisse de l’activité économique de 0,3 % en 2023. Les indicateurs de janvier sont si faibles qu’une troisième année de récession n’est pas exclue. Eclipsée par l’immigration et l’économie, le sujet de la guerre en Ukraine a refait surface à l’approche du scrutin, rappelant la profondeur des clivages qu’il suscite, y compris au sein du gouvernement. Une querelle persistante oppose le chancelier social-démocrate Olaf Scholz (SPD) à ses ministres de la défense, Boris Pistorius, et des affaires étrangères, Annalena Baerbock (Verts), au sujet d’une rallonge budgétaire de 3 milliards d’euros destinée à l’Ukraine. Réclamée par les deux ministres, cette enveloppe est bloquée par la chancellerie. Le pays est lui-même divisé sur le sujet : les enquêtes d’opinion montrent qu’une majorité d’Allemands soutient l’aide à l’Ukraine, mais pas la livraison de missiles de croisières Taurus, qui permettrait à Kyiv de frapper le territoire russe en profondeur, et à laquelle Olaf Scholz s’est jusqu’ici toujours opposé.
Dans les sondages, l’AfD pointe en deuxième position, gagnant du terrain selon une étude parue le 11 janvier qui crédite la formation de 22 % des suffrages, derrière les conservateurs du camp CDU/CSU autour de 30 % mais devant les sociaux-démocrates du chancelier Olaf Scholz autour de 16 %. La formation à la rhétorique anti-migrants et qui prône un rapprochement avec la Russie a reçu le soutien appuyé d'Elon Musk, allié et appui financier de Donald Trump avec lequel Alice Weidel, investie par l’AfD pour conquérir la chancellerie allemande, a dialogué plus d'une heure lors d'un échange public le 9 janvier sur le réseau social X du milliardaire.
Kontildondit ?
Michaela Wiegel :
À quelques semaines des élections, les similitudes entre l’Allemagne et la France sont frappantes. Trois éléments me paraissent particulièrement marquants : la fragmentation du paysage politique, la polarisation autour de l’immigration, et une économie en crise.
La fragmentation est spectaculaire. L’AfD, un parti tellement extrême que même le Rassemblement National refuse désormais de s’y associer au Parlement européen, est devenu la deuxième force politique du pays. Avec un score attendu entre 20 et 25 %, c’est un bouleversement (aux dernières européennes, l’AfD avait atteint 15,9 %).
Dans ce contexte, la CDU-CSU de Friedrich Merz, bien qu’en tête avec moins de 30 %, peine à s’imposer. Quant au SPD d’Olaf Scholz, il plafonne à 15-17 %, et les Verts oscillent entre 13 et 15 %. Trois partis sont en danger : les libéraux du FDP, qui risquent de tomber sous la barre des 5 % nécessaires pour siéger au Bundestag, l’extrême gauche de Die Linke, et le nouveau parti de Sahra Wagenknecht, qui combine des positions de gauche économique et de droite radicale sur l’immigration.
Avec ce morcellement, former une coalition sera une véritable gageure. Beaucoup d’observateurs estiment qu’un gouvernement à trois partis, associant Verts, sociaux-démocrates et conservateurs, sera nécessaire. Mais la polarisation autour de l’immigration complique la donne. Friedrich Merz voulait axer sa campagne sur l’échec économique du gouvernement sortant, mais les récentes attaques au couteau l’emportent by forcé à remettre la question migratoire au centre du débat. Un attentat à Aschaffenburg, où un Afghan (qui aurait dû être expulsé depuis longtemps), a attaqué des enfants en maternelle, a radicalement changé la donne.
Merz a décidé de mettre tout son poids politique dans une résolution symbolique sur l’immigration, adoptée grâce aux voix de l’AfD. Cette rupture du cordon sanitaire a provoqué un tollé : Michel Friedman, (ancien président de l’équivalent du CRIF allemand), a quitté la CDU, Angela Merkel est sortie de sa réserve pour critiquer Merz, et même un survivant de la Shoah, Albrecht Weinberg, a rendu sa croix de l’ordre du Mérite en signe de protestation. En parallèle, Viktor Orbán a félicité Merz, preuve que cette dynamique pourrait bien profiter à l’AfD. Certains s’interrogent même : Merz n’est-il pas en train d’ouvrir la voie à une alliance avec l’extrême droite, malgré ses dénégations ? Enfin, l’économie allemande est en grande difficulté. Wolfgang Münchau l’explique dans son livre « Kaput » : l’Allemagne souffre d’un retard dans la digitalisation, d’un sous-investissement dans ses infrastructures et d’un système éducatif qui se dégrade. Ce n’est pas seulement une crise conjoncturelle, c’est une crise structurelle qui rappelle, à bien des égards, celle que traverse la France.
Nicolas Baverez :
Cette élection est évidemment cruciale, non seulement pour l’Allemagne, mais aussi pour la France et l’Europe. Elle constitue un double test.
Le testAvec la France, l’Allemagne est aujourd’hui « l’homme malade de l’Europe ». La question est donc de savoir si elle pourra se relever et modifier son modèle économique. Car il ne s’agit pas d’un simple problème conjoncturel. L’Allemagne repose sur un modèle mercantiliste qui fonctionnait grâce à trois piliers : l’énergie russe bon marché, une main-d’œuvre à bas coût venue d’Europe centrale et orientale, et des exportations massives vers les BRICS, notamment la Chine, ainsi que vers les États-Unis. Mais aujourd’hui, l’énergie russe n’est plus accessible, le coût du travail augmente et la Chine, comme les États-Unis, devient un partenaire commercial de plus en plus difficile.
Ensuite, c’est un test européen. C’est la première grande élection après l’arrivée de Trump et la montée en puissance du « système Trusk » (Trump + Musk). Trump a fait de l’Allemagne une cible de son hostilité envers l’Europe. Quant à Elon Musk, il s’implique directement dans la campagne allemande en soutenant ouvertement l’AfD et sa dirigeante, Alice Weidel. Normalement, le congrès de l’AfD attire environ 400.000 spectateurs. Grâce à Musk, plus de 4 millions de personnes l’ont suivi sur X. On a vu aux États-Unis l’impact de ces dynamiques sur une élection.
La grande question est donc de savoir si l’Allemagne peut se réformer sans basculer dans une démocratie illibérale ou une expérience extrémiste. C’est d’autant plus important que c’est sans doute la dernière élection où l’AfD n’est pas directement en position d’accéder au pouvoir. L’Allemagne a pourtant les moyens de se redresser : sa dette publique représente seulement 63 % de son PIB, bien en dessous de celle de la France. Pourtant, pour l’instant, il n’y a pas de vision claire. L’Agenda 2030, censé relancer le pays, et qui reprend en grande partie les idées de Gerhard Schröder, mais reste flou. Par ailleurs, l’immigration a éclipsé les autres enjeux. L’autre question clef est celle du réarmement de l’Allemagne. On voit une montée des partis pro-russes, l’AfD bien sûr, mais aussi le parti de Mme Wagenknecht. Et sur cette question, il n’y a pas de réponse claire. Enfin, pour l’Europe, le danger est double. D’un côté, sa compétitivité s’effondre, ce qui enclenche une mécanique de paupérisation. De l’autre, sa défense est affaiblie alors que Trump fait pression. Un rapport intelligent et structuré, celui de Mario Draghi, donnait une feuille de route pour répondre à ces défis : relancer la compétitivité et renforcer la défense face à la Russie. Mais Ursula von der Leyen l’a déjà mis à la poubelle. L’Europe risque donc de ne pas prendre les mesures nécessaires pour garantir son avenir.
Quand on compare les situations allemande et française, on voit bien des similitudes, mais aussi des différences fondamentales. L’Allemagne, contrairement à la France, a les moyens de se réformer. Elle dispose d’une alternative politique crédible autour de Friedrich Merz, qui n’est pas une figure d’extrême droite. Elle souffre d’une pathologie inverse de la France vis-à-vis de la dette : là où nous sommes dans le laxisme budgétaire, l’Allemagne considère l’endettement comme une faute morale. Son frein à l’endettement, inscrit dans la Constitution, la contraint, alors même que de gigantesques investissements sont nécessaires pour moderniser son économie, réussir sa transition énergétique et se réarmer face à la Russie. Enfin, l’Europe ne pourra pas se redresser sans l’Allemagne. Cette élection nous concerne au plus haut point.
Lucile Schmid :
Ce qui me frappe, c’est l’incertitude qui entoure les comportements politiques, en France comme en Allemagne. Avec l’élection de Trump et l’influence croissante d’Elon Musk, on assiste à une remise en cause des limites traditionnelles du jeu politique. Il y a une mise en scène permanente du dépassement des règles. Elon Musk est intervenu à quatre reprises depuis le début de la campagne allemande. C’est une ingérence étrangère manifeste. L’Europe est en train de s’interroger sur la manière de réagir à ce type d’intervention. Au moment du Brexit ou de l’élection d’Emmanuel Macron, il y avait déjà eu des influences extérieures, mais elles étaient plus discrètes. Là, avec Musk et X, l’interférence est flagrante et assumée. En parallèle, il y a une ambiguïté dans notre rapport à Musk. Il fascine en tant qu’entrepreneur visionnaire, notamment sur l’intelligence artificielle. Mais dès qu’il se mêle de politique, son intervention est perçue comme problématique. On ne sait pas comment gérer cette contradiction.
Friedrich Merz, en proposant cette résolution symbolique sur l’immigration et en s’alliant de fait avec l’AfD, a pris un énorme risque électoral. Il pensait sans doute qu’il n’avait pas d’autre choix. Il est dans une position où il se demande comment gérer les relations avec les États-Unis, la pression de Musk et la montée de l’AfD.
Enfin, un élément important à surveiller : la coalition qui émergera de ces élections. Les Verts, en assumant une ligne économique plus centriste et une posture très pro-Ukraine, se sont rendus compatibles avec la CDU. Ils prennent leurs distances avec Olaf Scholz, qui mise davantage sur une posture pacifiste. Mais leur participation au gouvernement leur a coûté cher électoralement. Ils ont subi de lourdes défaites aux élections régionales. Deux scénarios sont possibles. Soit une grande coalition CDU-SPD, ce qui serait un retour en arrière et, si on croit les précédents, ne garantirait pas de réformes audacieuses. Soit une alliance CDU-Verts, plus innovante, mais qui pose problème sur la question migratoire, où les Verts restent très proches de la ligne d’Angela Merkel et du respect du droit européen. Tout dépendra du verdict des urnes et de la manière dont l’opinion réagit à la stratégie risquée de Merz.
Marc-Olivier Padis :
Ce que montre notre discussion, c’est à quel point l’Allemagne traverse une période d’incertitude inédite. Pendant longtemps, elle incarnait la stabilité. Aujourd’hui, son modèle est remis en cause sur trois fronts : économique, politique et géopolitique.
Économiquement, Nicolas l’a montré, le modèle mercantiliste est en crise. Politiquement, Michaela a bien décrit l’ampleur de la fragmentation du paysage partisan. Mais cette fragmentation est-elle un éclatement ou une recomposition ? L’AfD s’est imposée comme un acteur incontournable. Et côté populiste, un nouveau parti, celui de Sahra Wagenknecht, émerge. En parallèle, des partis historiques comme le FDP et Die Linke risquent de disparaître du Bundestag. La CDU, qui aurait pu remporter ces élections facilement, est pénalisée par Friedrich Merz, une personnalité qui ne suscite pas d’enthousiasme. Son pari risqué sur l’immigration pourrait le fragiliser encore davantage.
Géopolitiquement, l’Allemagne doit repenser trois grands principes qui structuraient sa politique : le mercantilisme, le pacifisme et l’atlantisme. Sur ces trois sujets, elle est en pleine redéfinition. Olaf Scholz, en retrait sur les affaires européennes, pourrait être remplacé par un gouvernement plus actif sur ce terrain, surtout si la CDU l’emporte. Un élément clé à surveiller est la montée de l’AfD en Allemagne de l’Ouest. Jusqu’ici, il s’agissait surtout d’un phénomène à l’Est. Si l’AfD progresse à l’Ouest, cela marquera une rupture politique majeure.
Michaela Wiegel :
Lucile a évoqué la question des ingérences étrangères. Il faut rappeler qu’en Allemagne, ce type d’intervention n’est pas totalement inédit. Barack Obama avait à plusieurs reprises exprimé son soutien à Angela Merkel, allant même jusqu’à transmette des messages dans des meetings. Ce qui rend l’affaire Musk différente, c’est qu’il ne se contente pas de soutenir l’AfD : il réécrit aussi l’histoire allemande. Il appelle les Allemands à « oublier » la culpabilité liée à leur passé et à tourner la page de la Shoah. Ce discours séduit une partie de la jeunesse, notamment à l’Est, où l’AfD est devenue le premier parti chez les jeunes. Sur les réseaux sociaux, l’AfD alimente une fascination pour une certaine virilité allemande. TikTok et Instagram jouent un rôle central dans cette guerre culturelle, et les autres partis n’ont pas encore trouvé comment y répondre efficacement.
Lucile Schmid :
Un point important dans cette recomposition politique est la question territoriale. Les Verts ont de très mauvais résultats dans les Länder de l’Est. L’un des enjeux du scrutin sera de voir si l’AfD parvient à s’implanter aussi en Allemagne de l’Ouest. Cela pourrait peser sur les choix de coalition de Friedrich Merz.
Nicolas Baverez :
Un des atouts de l’Allemagne face à cette crise, c’est la vitalité de sa société civile. Elle n’a rien à voir avec ce qu’on observe en France. Le patronat a clairement pris position contre l’AfD. D’autres acteurs économiques et culturels s’impliquent activement dans le débat. Cette capacité de mobilisation est un atout pour le pays.
SOMMET DE L’IA : RÊVES EUROPÉENS, MONOPOLE AMÉRICAIN
Introduction
Philippe Meyer :
Après les sommets de Bletchley Park (au Royaume-Uni) en novembre 2023 et de Séoul au printemps dernier, le sommet de Paris sur l'intelligence artificielle réunira les 10 et 11 février le « Sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle », un événement de portée mondiale réunissant chefs d'État et de gouvernement, dirigeants d'entreprise, universitaires, chercheurs, organisations non gouvernementales, artistes et autres membres de la société civile. L'événement a pour ambition de mettre la France et l'Europe sur la carte mondiale de l'IA, mais aussi de rendre compréhensibles pour le grand public les enjeux liés à cette technologie. Les discussions s'orienteront autour de trois objectifs prioritaires, : le développement d'une IA plus durable - cette technologie étant particulièrement énergivore - plus ouverte et au service de l'intérêt général, et la mise en place d'une gouvernance mondiale plus inclusive. Alors que les précédents sommets se concentraient surtout sur les risques, celui de Paris mettra en avant les opportunités qu'offre cette technologie.
Deux régulations très différentes s'opposent : alors que les Européens veulent réguler a priori l'IA, les Américains ont opté pour de grands principes certes ambitieux mais non contraignants. La présence d'Elon Musk dans la nouvelle administration américaine, alors que le milliardaire vient de lever 6 milliards de dollars pour son entreprise d'IA, « XIA », risque d'accélérer ce découplage entre les Etats-Unis et l'UE. Dans la lignée du rapport Draghi sur la compétitivité de l'Europe, le Sommet de Paris doit surtout renforcer la place de l'innovation dans l'approche européenne de l'IA, approche que soutient Paris au sein des 28. Il s'agit de limiter drastiquement une approche qui serait principalement centrée sur les risques, encadrant les entreprises innovantes, et qui ne permettrait pas au continent européen de prendre le tournant de cette nouvelle révolution technologique.
L’IA est devenue un véritable enjeu de souveraineté pour les États. Donald Trump a annoncé mardi le projet « Stargate », comprenant des investissements « d’au moins 500 milliards de dollars » pour construire des centres d’hébergement et de traitement des données, les fameux « data centers », indispensables pour faire fonctionner les intelligences artificielles. Selon Bloomberg, les grandes entreprises de la tech américaine vont dépenser 274 milliards de dollars en investissements en capital dans l'IA en 2025. C'est presque deux fois plus qu'en 2023. Avec ses 20 Mds d’euros d’investissement par an, dont 4 Mds en France, l’Europe reste largement distancée par les États-Unis.
Kontildondit ?
Marc-Olivier Padis :
Ce qui frappe à propos de l’intelligence artificielle, c’est l’aspect encore très spéculatif du sujet. On sent qu’une révolution est en train de s’installer, mais il est difficile d’en prévoir la direction. Il faut aussi dissiper un malentendu autour du mot « intelligence ». En anglais, il ne signifie pas seulement capacité de réflexion, mais aussi renseignement et traitement de l’information. Intelligence Service désigne par exemple les services secrets. En français, nous avons tendance à assimiler l’IA à la pensée, activité auto-réflexive, et, dans notre tradition cartésienne, indissociable de la conscience. Alors que pour le monde anglo-saxon, il s’agit simplement de traitement massif de données selon des méthodes statistiques et des algorithmes génératifs.
L’IA se distingue des autres révolutions technologiques récentes parce qu’il s’agit d’une General Purpose Technology, c’est-à-dire une technologie dont les usages sont multiples et qui pourrait transformer en profondeur différents secteurs, comme l’électricité en son temps : les premiers usages que nous observons en ce moment ne sont peut-être pas ceux qui domineront dans quelques années.
Ce qui est certain, c’est que la diffusion de l’IA est extrêmement rapide. ChatGPT, un des outils conversationnels les plus connus, compte déjà plus de 250 millions d’utilisateurs hebdomadaires. Mais l’impact sur l’emploi reste incertain. Les études macroéconomiques varient considérablement dans leurs conclusions : certaines annoncent une destruction massive d’emplois, d’autres estiment au contraire que de nouvelles activités émergeront, et les ordres de grandeur varient parfois de 1 à 10. Ce que l’on observe à l’échelle des entreprises, c’est une appropriation spontanée et informelle par les salariés. Il existe déjà un phénomène d’ « IA clandestine » : des employés utilisent ces outils pour accomplir des tâches routinières, sans en informer leur hiérarchie ni leurs collègues. L’impact est d’autant plus notable que l’IA transforme d’abord le travail des cols blancs, ceux qui effectuent des tâches de rédaction, de synthèse ou d’analyse, et non celui des ouvriers ou des employés de production, contrairement aux précédentes révolutions industrielles, où les machines remplaçaient les cols bleus.
Enfin, un coup de tonnerre est venu de Chine cette semaine avec le lancement de DeepSeek, un modèle d’IA qui rivalise avec les plus avancés du marché, mais qui repose sur une architecture nettement moins coûteuse. Cela met en difficulté le projet Stargate des États-Unis, qui visait à creuser l’écart avec la Chine et l’Europe à coups d’investissements massifs.
Lucile Schmid :
Depuis l’élection d’Emmanuel Macron, nous avons tenu en France des sommets destinés à marquer l’agenda international, comme Make Planet Great Again sur l’environnement. Aujourd’hui, avec ce sommet sur l’intelligence artificielle, l’accent est mis sur l’idée d’une IA au service de l’intérêt général, une expression qui revient fréquemment dans le discours du président de la République. Mais cette notion même d’intérêt général traduit nos ambivalences et nos inquiétudes face à cette technologie. Comme l’a expliqué Marc-Olivier, l’IA se diffuse extrêmement vite, et la frontière entre recherche fondamentale, recherche appliquée et usages se brouille. Il est donc difficile d’anticiper précisément son évolution. Affirmer que l’IA peut servir l’intérêt général, c’est tenter de l’orienter vers un projet de société plus inclusif et une forme de progrès maîtrisé. Frédéric Worms, directeur de l’École normale supérieure, qui participera au sommet, souligne qu’il serait intéressant de promouvoir une « IA plus », c’est-à-dire une IA dédiée en priorité aux domaines où elle peut véritablement améliorer la vie des gens. Il cite la santé (on sait que l’IA peut accélérer la découverte de nouveaux traitements, notamment contre le cancer), mais aussi l’éducation. Aujourd’hui, pour beaucoup de parents, la principale question est de savoir comment leurs enfants utilisent ChatGPT, souvent pour rédiger un devoir à la dernière minute. Mon fils me faisait ces jours-ci une comparaison parlante : il me disait que ChatGPT, c’est comme la vache folle – il assimile des contenus, les régurgite en masse, et peut finir du contenu délirant, à partir de ce qu’il a lui-même produit. Cette dynamique illustre bien le problème de régulation qui se pose, alors que 70 % des 18-25 ans utilisent déjà cet outil. L’idée d’une IA au service de l’intérêt général doit donc encore être définie précisément. Elle peut être bénéfique dans certains domaines, comme la santé ou la lutte contre le changement climatique, en permettant des modélisations bien plus précises que celles dont nous disposons aujourd’hui. Mais elle reste un concept à clarifier.
Un autre point crucial concerne les infrastructures ouvertes. Nous savons qu’OpenAI, qui a créé ChatGPT, n’a plus rien « d’open ». Elon Musk lui-même a lancé le débat en déclarant que l’entreprise n’aurait plus le droit d’utiliser ce nom, puisqu’elle ne repose plus sur un modèle ouvert. Cette opacité des algorithmes et des modèles d’IA pose une question essentielle : est-il possible de garantir une IA transparente et accessible ? C’est un domaine où l’Europe pourrait jouer un rôle majeur en articulant intelligence artificielle et enjeux démocratiques.
Cela pose aussi la question de l’usage des données. Aujourd’hui, lorsque nous confions des informations à une IA, nous ne savons pas précisément comment elles seront exploitées. Cette opacité est au cœur des débats actuels. Prenons l’exemple de DeepSeek, cette IA chinoise que Marc-Olivier a mentionnée comme un coup de tonnerre. L’application est massivement téléchargée, mais la question de l’utilisation des données qu’elle collecte reste entière. Nous savons que DeepSeek est directement en lien avec le gouvernement chinois. Ce type de modèle soulève donc des préoccupations légitimes sur la souveraineté numérique et le contrôle des informations.
Un troisième point important est la manière dont l’Europe peut réellement répondre au modèle américain. Nous observons une surenchère financière dans ce domaine. Donald Trump annonce un programme de 500 milliards de dollars pour l’IA, mais comme toujours avec lui, il est difficile de savoir ce que cette somme recouvre réellement. Peut-être n’y a-t-il que 50 milliards derrière cette annonce … Il faut aussi distinguer l’argent public et l’argent privé : ce ne sont pas les États qui financent directement le développement de l’IA, mais ils peuvent encourager les investissements et fixer un cadre.
L’enjeu pour l’Europe est de créer une dynamique de levées de fonds. En France, l’IA a été au premier rang des levées de fonds pour les startups ces trois dernières années, mais cette dynamique s’essouffle. Comment faire en sorte que ce phénomène ne reste pas national, mais devienne un véritable projet européen ? Nous ne pouvons plus nous contenter d’avoir quelques licornes isolées dans chaque pays. Il faut que la France accepte de jouer pleinement le jeu européen, et surtout que l’Union européenne ne se limite pas à une approche a priori restrictive. Réguler un phénomène qui évolue aussi vite que l’IA, sans même avoir une vision claire de son développement, c’est prendre le risque de se retrouver marginalisé.
Nicolas Baverez :
L’intelligence artificielle représente une rupture technologique majeure, bien plus qu’une opération de marketing comme le metaverse. Contrairement à ces effets de mode, l’IA a déjà des impacts mesurables et transformateurs. Aux États-Unis, elle joue un rôle central dans la reprise de la productivité, qui atteint désormais 2,5% par an. Elle a aussi des applications déterminantes en matière de défense, notamment en Ukraine, où elle optimise le renseignement et le ciblage des frappes. Au Moyen-Orient, elle accélère la prise de décision militaire et transforme la gestion des conflits en temps réel.
Par ailleurs, l’IA illustre parfaitement la dynamique géopolitique actuelle :
- Les États-Unis innovent, en concentrant l’essentiel des avancées et en maîtrisant les principaux acteurs du secteur.
- La Chine imite, investissant massivement tout en procédant à un pillage systématique des technologies occidentales.
- L’Europe régule, au lieu de produire, ce qui la condamne à un rôle de spectatrice dans cette course technologique.
- La France organise des sommets, ce qui permet d’affirmer un leadership diplomatique mais ne change rien à notre dépendance technologique.
Cette posture européenne est intenable. L’IA Act, adopté en 2024 et applicable en 2025, en est l’illustration parfaite : nous avons voté une régulation stricte, mais elle concerne avant tout des entreprises sous capitaux américains. Même Mistral, que l’on présente comme un champion européen, repose sur des financements étrangers.
Pourtant, nous avons tous les atouts pour exister dans cette révolution. Nous disposons d’une électricité largement décarbonée grâce au nucléaire, ce qui est un avantage déterminant pour alimenter les data centers et entraîner des modèles d’IA. Nous formons certains des meilleurs ingénieurs au monde, mais nous les laissons partir aux États-Unis. Chaque année, plus de 300 milliards d’euros de capitaux européens traversent l’Atlantique pour financer des innovations qui nous échappent. L’exemple de DeepSeek montre à quel point nous sommes en retard. Ce modèle, aussi performant que ses équivalents américains, repose sur une architecture plus efficace et bien moins coûteuse. Cela prouve qu’il est possible d’innover sans forcément investir des centaines de milliards de dollars. Cette annonce a eu un impact immédiat : Nvidia, le géant américain des semi-conducteurs, a subi une perte boursière massive, car DeepSeek remet en cause l’idée d’un monopole technologique durable.
Mais l’IA chinoise pose un autre problème, celui du contrôle politique et idéologique. DeepSeek est totalement aligné avec les exigences du régime chinois. Par exemple, si vous interrogez ce modèle sur la place Tiananmen et les événements de 1989, vous obtenez une page blanche. Cela signifie que l’IA chinoise ne se contente pas de rivaliser avec les modèles occidentaux sur le plan technologique : elle intègre aussi une censure totale de l’histoire et des idées.
Nous sommes à un tournant. L’Europe peut-elle encore rattraper son retard, ou restera-t-elle une simple consommatrice de technologies conçues ailleurs ? Aujourd’hui, nous ne produisons pas, nous nous contentons d’élaborer des normes. Mais réguler sans innover, c’est accepter de devenir une puissance secondaire. Nous devons changer de cap et investir massivement, faute de quoi nous serons bientôt marginalisés. L’IA est une révolution aussi structurante que l’électricité ou Internet. Si nous ne nous réveillons pas, nous perdrons non seulement la bataille technologique, mais aussi une part de notre souveraineté. Innovons au lieu de réguler.
Michaela Wiegel :
À propos du sommet français, Emmanuel Macron a tout de même réussi un très joli coup en choisissant l’Inde comme co-présidente de cet événement, à un moment où les États-Unis dominent largement l’IA et où nos relations avec Donald Trump restent à redéfinir. L’Inde, comme l’a mentionné Nicolas, joue un rôle clef en fournissant une grande partie des ingénieurs et des mathématiciens qui font avancer cette technologie, mais elle cherche encore à s’imposer comme une puissance à part entière dans ce domaine. Si l’Europe veut éviter de devenir un simple réservoir de talents aspirés par les États-Unis ou la Chine, il est crucial d’associer des pays comme l’Inde, qui eux aussi cherchent à se positionner dans cette compétition féroce.
Il faut également s’arrêter sur un point essentiel : les pressions de la Silicon Valley et plus largement de toute l’industrie de l’IA aux États-Unis en faveur de Donald Trump. Un entretien très intéressant avec Marc Andreessen (l’un des plus grands investisseurs en tech à travers son fonds Andreessen Horowitz) a récemment été publié dans le New York Times. Il y explique comment la volonté de réguler l’IA sous l’administration Biden a progressivement poussé l’ensemble des entrepreneurs de la Silicon Valley dans le camp de Trump, alors même que beaucoup d’entre eux étaient historiquement des Démocrates.
On sous-estime probablement le bouleversement qu’entraîne le retour de Trump, notamment sur le plan éthique. En levant les restrictions que Biden avait mises en place pour encadrer l’IA, il accélérera encore l’écart entre l’approche américaine et l’approche européenne.
Je partage l’analyse de Nicolas sur les faiblesses de l’Europe. Nos startups sont systématiquement rachetées dès qu’elles développent une innovation prometteuse. C’est la même chose en Allemagne : nous avons les idées, mais elles sont immédiatement absorbées par les grandes entreprises américaines. Si nous voulons sortir de cette dépendance, il faut au moins commencer par se positionner et réfléchir au rôle que nous pouvons jouer. L’exemple chinois montre bien que l’IA n’est pas uniquement une question de moyens financiers. L’arrivée de DeepSeek et la récente perte boursière exceptionnelle de Nvidia sont comparées à moment Spoutnik pour les États-Unis (en référence au choc provoqué par le lancement du premier satellite soviétique en 1957).
L’Europe doit absolument éviter de se cantonner à un rôle de simple puissance de régulation. Si nous nous contentons d’élaborer des normes pendant que d’autres produisent et innovent, nous resterons spectateurs de cette révolution technologique au lieu d’en être acteurs.
Lucile Schmid :
Un dernier point qui mérite d’être souligné est l’impact écologique de l’IA. On sait qu’elle est extrêmement consommatrice d’énergie et de ressources, notamment d’eau. C’est un enjeu central pour la durabilité de cette révolution technologique. Aujourd’hui, certains réfléchissent déjà à la possibilité de coupler les data centers à de petits réacteurs nucléaires. L’IA a des besoins énergétiques si importants que l’arbitrage entre son développement et d’autres usages de l’électricité deviendra inévitable. Mais l’exemple de DeepSeek montre que l’optimisation de l’architecture des modèles permet de réduire leur consommation énergétique. C’est une piste à explorer si l’on veut éviter que l’IA n’entraîne une explosion incontrôlable de la demande en électricité et en eau.