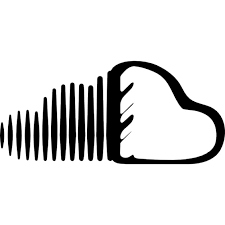COMMENT RÉARMER ?
Introduction
ISSN 2608-984X
Philippe Meyer :
Après l’intervention télévisée du chef de l’État le 5 mars, la défense nationale est devenue la priorité du gouvernement. Fleurons de l'industrie de l’armement, PME et start-up innovantes, sous-traitants ... Tout un écosystème est mobilisé pour faire face à la menace russe amplifiée et au retrait de l'allié américain. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu a évoqué une enveloppe de 100 milliards d'euros par an pour la défense à l'horizon 2030, contre 68 milliards inscrits dans la loi de programmation militaire, soit 1,5 point de PIB supplémentaire évoqué par le président de la République, pour passer de 2% à 3%-3,5% chaque année. Le ministre des Armées a esquissé quelques priorités : « Les munitions et la guerre électronique sont les urgences puis la dronisation et la robotisation des armées. » L’accélération des cadences est déjà visible sur certains segments comme les munitions, l’artillerie et les missiles. Il faut également rester performant dans le domaine de l’intelligence artificielle, et du spatial. Du côté des grands programmes, Sébastien Lecornu entend augmenter le nombre d’avions de combat et de frégates de premier rang.
Les revues stratégiques successives qui évaluent régulièrement les menaces pesant sur le pays et prévoient les moyens d’y répondre, n’ont jamais écarté le risque d’un retour de la guerre de haute intensité. C’est pourquoi le modèle d’armée complet français a toujours été préservé au nom de la souveraineté nationale, afin de pouvoir agir sur tous les niveaux de conflictualité, même s’il a souvent été qualifié d’échantillonaire. La France s’inscrit également dans un cadre européen avec de nombreux programmes de coopération comme le système de combat aérien du futur avec l’Allemagne et l’Espagne ; l’hélicoptère du futur avec notamment l’Italie, l’Espagne, et l’Allemagne ou les missiles avec le Royaume-Uni.
Interrogés par Ipsos-Ceci pour La Tribune Dimanche, les Français sont 68% à considérer favorablement une augmentation du budget de la Défense quitte à augmenter encore les déficits pour 66% d’entre eux et même sacrifier des budgets de l’Éducation ou de la Santé (51%). La sécurité nationale passant ainsi devant la sécurité sociale. Avant d’en arriver là, le gouvernement veut toutefois explorer d’autres pistes de financement. Le ministre français de l'Économie, Éric Lombard, exclut d'activer la clause de sauvegarde prévue par Bruxelles pour financer les investissements dans la défense par de la dette. Parmi les outils envisagés à Bercy ou à Matignon, figurent notamment le recours au Livret A ou encore un grand emprunt. Vendredi, le président de la République, Emmanuel Macron a reçu les industriels de la défense pour leur fixer une nouvelle feuille de route visant à accélérer les cadences de livraison d’équipements. Face aux difficultés budgétaires et industrielles, Bercy doit organiser le 20 mars prochain une réunion rassemblant les banques et les assurances, mais aussi des acteurs de l'industrie de la défense.
Kontildondit ?
Nicolas Baverez :
Beaucoup de générations ont eu l’impression de vivre des périodes historiques sans que ce soit toujours vrai. En revanche, c’est effectivement le cas aujourd’hui, compte tenu de ce que nous vivons. Le contexte stratégique a totalement basculé, tout d’abord avec la guerre d’Ukraine. C’est à la fois une grande confrontation entre les empires autoritaires et les nations libres, et le retour de la guerre de haute intensité sur le continent européen. À cela s’ajoute le retour de Donald Trump dans une version profondément idéologique, avec une Amérique qui prend ses distances par rapport à la démocratie et surtout son alignement sur la Russie, non seulement sur la question ukrainienne mais sur des positions fondamentales concernant les libertés. Ainsi, pour la France et pour l’Europe, nous vivons la situation la plus grave depuis les années 1930, marquée par la faiblesse militaire des Européens, leur division et surtout cette alliance contre nature : ce n’est plus le pacte germano-soviétique, mais l’alliance Washington-Moscou.
Pour l’Europe, c’est un traumatisme majeur, car elle s’est reconstruite sur l’idée que la paix passait par le commerce et le droit, tout en bénéficiant du parapluie sécuritaire américain. Or, tout cela vient de disparaître. Pour la France aussi, c’est une profonde remise en cause. Certes, nous n’avons pas totalement cédé au mythe de la fin de l’histoire, mais notre système militaire n’est pas adapté aux combats de haute intensité en Europe. Nous avons subi une défaite massive en Afrique, notre dissuasion nucléaire fonctionne un peu comme une ligne Maginot, et nos armées conventionnelles ont été formatées pour des opérations de maintien de la paix ou des expéditions, ce qui n’est plus adapté aujourd’hui. Face à cette situation, il y a deux urgences : soutenir l’Ukraine, d’abord pour elle-même mais aussi pour gagner du temps et permettre le réarmement européen, puis défendre l’Europe face à la menace existentielle russe (sans oublier la persistance de la menace djihadiste). Beaucoup parlent de réarmement en évoquant immédiatement les moyens, c’est-à-dire les milliards nécessaires, mais il faut avant tout revenir aux objectifs, car c’est le fondement de toute stratégie.
Quelle est la situation ? Il faut le rappeler car il y a beaucoup de confusion. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, et la guerre hybride n’est pas une guerre tout court. Si nous voulons nous réarmer, ce n’est pas pour faire la guerre, mais précisément pour préserver la paix, en dissuadant Poutine d’engager de nouvelles agressions. Ensuite, que voulons-nous faire exactement ? Nous voulons assurer la continuité de la vie nationale en toutes circonstances, et contribuer à la défense de l’Europe. Avec qui pouvons-nous le faire ? Aujourd’hui, les États-Unis sont une source d’instabilité et de chaos ; nous ne pouvons clairement plus compter sur leur garantie de sécurité. En revanche, en Europe, la solution n’est pas l’Union européenne mais un directoire des grandes nations. Cela permettrait notamment de rapatrier le Royaume-Uni, indispensable puisqu’il représente le tiers du potentiel militaire du continent. Ce directoire comprendrait la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Pologne, l’Espagne, l’Italie et la Suède. Concernant l’OTAN, il ne faut jamais oublier que c’est un bien commun européen : nos armées européennes utilisent quotidiennement les procédures OTAN, contrairement à l’armée américaine qui ne les applique qu’aux 90.000 soldats stationnés en Europe. C’est ainsi, avec ces procédures, que nous pourrons construire un vrai pilier européen opérationnel, pas à travers une « armée européenne » (qui n’est qu’un mythe), mais avec des armées nationales capables d’opérer efficacement ensemble, et coordonnées sur le plan des équipements.
Que faire concrètement ? D’abord, rehausser la dissuasion. Nos 290 têtes nucléaires ne suffisent clairement plus face à ce que représente la Russie dans l’hypothèse d’un désengagement américain. Il faut notamment insister sur la composante aérienne, plus flexible, plus précise, et mieux adaptée aux démonstrations de force. La dissuasion ne saurait se limiter pas aux sous-marins nucléaires lanceurs d’engins. Ensuite, il faut moderniser nos forces armées pour les rendre aptes aux combats de haute intensité. Sur ce point, il existe un vrai problème de volume : l’armée de terre compte actuellement 77.000 hommes, c’est presque moitié moins que nos besoins. Pour constituer une force européenne crédible face aux 800.000 à 1 million de soldats russes potentiellement mobilisables, il faudrait au minimum 150.000 hommes. Évidemment, tous ne viendraient pas de France, mais nous avons clairement un problème d’effectifs, et aussi d’importants retards en matière de drones, de capacités de frappe en profondeur et de défense antiaérienne.
Comment financer ce réarmement ? Il faut porter l’effort de défense d’au moins 2% à 3% du PIB. Cela ne peut pas être financé par la dette (déjà à 120% du PIB avec des taux d’intérêt à 3,6%). Ce ne peut pas être financé non plus par l’impôt, qui ferait fuir les capitaux, les talents et les entreprises. La seule solution est de basculer une partie des 34% du PIB consacrés à l’État-providence vers l’effort de défense. C’est le seul moyen d’obtenir un financement solide et durable, mais surtout d’ancrer le réarmement dans une véritable modernisation de notre modèle économique et social. Il existe un lien fondamental entre réarmement militaire, réarmement économique, réarmement politique et réarmement moral.
Richard Werly :
Est-ce que « réarmer » est simplement une question militaire ? Ne s’agit-il que d’investissements et d’équipements ? Je n’en suis pas sûr. À mon sens, réarmer est aussi une question morale, une question de détermination et une question politique.
Il faut d’abord convaincre la majorité de la population, avec des arguments solides, que les raisons de ce réarmement sont objectives et nécessaires. Ainsi, je placerais la politique sur le même plan, voire avant les décisions d’investissements, car il me semble que, pour une grande partie de la population française, la preuve n’est pas encore faite. On le voit dans les débats à l’Assemblée nationale, ou même dans les médias : la preuve que la menace actuelle exige un réarmement français n’est pas entièrement établie. Elle l’est peut-être au sein des élites, notamment médiatiques, sur les plateaux de télévision. Mais est-ce qu’elle l’est dans la rue, ou dans les mairies ? Je n’en ai pas l’impression, or il faudrait une forme d’union nationale sur la nécessité du réarmement. J’ai noté que le ministre des Affaires étrangères a entamé une tournée en province, dans plusieurs villes. Je me demande s’il ne faudrait pas mener une démarche similaire, plus ambitieuse encore, avec davantage de membres du gouvernement et en y associant différents partis politiques. Car s’il n’y a pas ce réarmement moral, cette volonté collective de faire face, je doute que tout le reste suive vraiment. Dans un pays comme la France, où l’on sait que le compromis est difficile à atteindre, il n’y aura pas de véritable solution sans consensus.
Sur les objectifs, je voudrais ajouter deux éléments à ce qu’a présenté Nicolas. Premièrement, se réarmer implique nécessairement une coopération entre Européens. Cela suppose de renoncer au mythe selon lequel l’industrie française d’armement engrangerait toutes les commandes et deviendrait le fournisseur exclusif des armées européennes. La réalité est que, pour s’armer de manière moderne et performante, il faudra accepter que certains équipements soient produits ailleurs, dans des usines d’autres pays européens, et qu’ensemble, nous montions des projets convaincants dans tous les domaines prioritaires. Et il me semble que cette partie de l’équation n’est pas non plus pleinement acceptée en France. On voudrait bien que Dassault fournisse l’ensemble des Européens, que le canon Caesar soit adopté par toutes les armées européennes, on continue à penser que la France peut trouver une alternative nationale au char Léopard allemand, qui est probablement le meilleur char au monde … L’urgence est donc d’introduire pleinement dans le débat français la nécessité de coopérer entre Européens pour produire et acheter européen. Là, un gros effort reste à faire.
Enfin, sur la question du financement, je suis convaincu qu’on ne pourra pas éviter à terme un grand emprunt national. Autrement dit, qu’il faudra s’endetter. Et s’endetter au niveau européen, contrairement à ce que laisse entendre Olivier Faure (je ne sais pas si d’autres le disent aussi, mais lui, je l’ai entendu), ne signifie pas que la France n’aura pas à rembourser. C’est absurde de laisser croire aux Français qu’une dette européenne ne les concernerait pas. En revanche, il serait pertinent de s’endetter entre Français. C’est-à-dire que le montant de la dette consacrée à la Défense ne serait pas porté par des fonds spéculatifs internationaux aux allégeances incertaines, mais par les Français eux-mêmes. Une dizaine de grands emprunts nationaux ont scandé l’histoire de France. Je trouverais judicieux, dès maintenant, de poser clairement le débat sur un grand emprunt national consacré à la défense européenne (pas uniquement française). J’ajoute que ce grand emprunt français pourrait peut-être même servir de modèle, et inspirer d’autres pays européens, puisque nous voyons que, dans cette histoire, la France a eu raison sur un certain nombre de sujets.
Marc-Olivier Padis :
Sur la question du réarmement, la France a moins de terrain à rattraper que certains de ses partenaires européens, qui ont une culture militaire beaucoup moins ancrée. Nous disposons d’une armée complète, comme l’expliquait très bien Louis Gautier dans une émission de mars 2023. Ce modèle d’armée complète est une spécificité française que peu de pays européens possèdent. Nos forces sont actives sur plusieurs théâtres d’opérations, et nous avons une industrie de défense qui accompagne cette capacité d’action. Certes, le budget militaire a diminué depuis les années 1990, mais l’essentiel de la base industrielle a été préservé, ce qui permet une montée en puissance, même si elle reste lente. Comme le soulignait Richard, le carnet de commandes des Rafale est plein : même si le Canada ou le Portugal renonçaient à acheter des F-16 américains, il ne serait pas possible de leur livrer des Rafale du jour au lendemain.
Ensuite, pour renforcer la coopération européenne, il faut se libérer de la dépendance américaine. Dans l’OTAN, les États-Unis ont tout verrouillé, notamment les systèmes d’armes, par le biais de logiciels et de composants soumis à des contraintes juridiques et techniques, rendant impossible toute mise à jour sans leur aval. Ils ont aussi tout fait pour conserver leur emprise sur les centres de commandement. Il est donc étonnant d’entendre certains discours affirmant que les États-Unis seraient perdants dans l’OTAN, alors qu’ils ont systématiquement sécurisé leur position de fournisseurs d’armements et de garants des systèmes de défense. Il est impératif d’organiser une véritable coordination européenne. Sur le papier, les moyens militaires et humains des pays européens sont loin d’être négligeables, mais il existe des lacunes dans certains domaines et des redondances dans d’autres. Il faut donc ajuster ces capacités de manière cohérente.
Troisièmement, il ne suffit pas de trouver des financements, encore faut-il savoir les utiliser efficacement. Car dépenser efficacement de l’argent n’est pas une chose évidente. On l’a vu avec les budgets post-Covid mobilisés par l’emprunt européen : certains pays n’ont même pas réussi à utiliser les fonds alloués. L’Allemagne, par exemple, a annoncé en 2022 un plan de 100 milliards pour moderniser la Bundeswehr, mais elle peine à l’exécuter, faute de priorisation claire et d’une organisation adaptée. De même, l’Europe prévoit un projet de réarmement de 800 milliards à l’échelle continentale : il faudrait déjà commencer par utiliser intelligemment ces ressources avant d’envisager de tailler dans d’autres budgets nationaux. Je suis donc très réservé sur l’idée d’un jeu à somme nulle entre dépenses sociales et dépenses militaires. L’histoire montre d’ailleurs l’inverse : c’est souvent en période de guerre que les systèmes de solidarité ont été renforcés. Ainsi, le plan Beveridge, qui a posé les bases de la protection sociale britannique, a été adopté en 1942. De même, en France, après 60 ans de débats acharnés, l’impôt sur le revenu a été voté le 15 juillet 1914, dans un contexte évident.
Enfin, je rejoins Richard sur la nécessité d’un « réarmement moral », c’est-à-dire d’une prise de conscience collective. Il faut comprendre la situation géopolitique et construire un consensus dans un pays qui, comme d’autres, est entraîné vers une polarisation excessive des débats. Un aspect peu abordé concerne le partage éventuel de la dissuasion nucléaire française avec d’autres Européens. Si cette discussion devait s’ouvrir, il serait essentiel de leur expliquer notre doctrine nucléaire, qui diffère sensiblement de celle des États-Unis. Or, ce n’est pas une évidence. Et pour les Français eux-mêmes non plus, d’ailleurs. Il y aurait donc un immense travail de pédagogie à mener auprès de nos partenaires pour leur faire comprendre les principes de cette doctrine, et pas seulement leur transmettre des documents officiels et des procédures.
Jean-Louis Bourlanges :
Ici, nous ne sommes pas dans « Qui veut gagner des millions ? », mais plutôt dans « Qui veut dépenser des milliards ? » C’est assez stupéfiant. Je me souviens qu’au nom de la commission des Affaires étrangères, lors des discussions sur la loi de programmation militaire, j’avais déposé un amendement extrêmement modéré, proposant d’atteindre les 2% du PIB dans l’année, plutôt que d’attendre deux ou trois ans comme prévu. Le texte insistait aussi sur le fait que ce seuil devait être un point de départ, et non un plafond. Et à l’époque, la commission de la Défense et les voix du gouvernement s’y étaient opposées. Pourtant, Sébastien Lecornu comprenait bien l’enjeu et était même d’accord avec moi, mais il avait arbitré en défaveur de cette accélération budgétaire. On chipotait alors sur quelques milliards … Et aujourd’hui, d’un seul coup, on parle d’augmentations absolument massives, de centaines de milliards. Tout cela est un peu ahurissant, même si je comprends bien la stratégie du ministre des Armées. Habile, il sait que dans un contexte budgétaire contraint, il doit frapper fort, demander beaucoup pour obtenir un minimum. Il met donc le Premier ministre, le président de la République et tout le gouvernement face à une demande qu’ils ne peuvent rejeter en bloc.
Mais il faut prendre un peu de recul. Comme l’a dit Marc-Olivier, le réarmement ne se limite pas aux dépenses militaires. Il s’agit aussi d’un effort scientifique et technologique, mêlant civil et militaire, bien au-delà du seul budget de la Défense. Aujourd’hui, nous avons un budget militaire représentant 2% du PIB et des dépenses sociales qui atteignent un tiers de la richesse nationale. Il est absurde de prétendre que toute augmentation de l’un impliquerait nécessairement un affaiblissement de l’autre. Il ne s’agit pas de remettre en cause le modèle social, mais il existe une marge d’ajustement. Après avoir beaucoup insisté sur l’ampleur des sommes à mobiliser, il serait temps d’adopter un discours plus rationnel : nous parlons ici d’un effort budgétaire important, mais qui reste très éloigné des sacrifices imposés dans d’autres périodes historiques.
J’ai récemment relu un document rappelant la politique économique de Paul Reynaud en 1938, qui fut un grand succès : en 1939, la France était dans une situation économique excellente. Si l’on avait écouté Reynaud en économie et de Gaulle sur le plan militaire, nous aurions sans doute abordé 1940 dans de bien meilleures conditions. Certes à l’époque, l’effort de réarmement avait été tardif mais colossal : on demandait aux ouvriers des industries d’armement de travailler plus de 60 heures par semaine.
Comme le disait Richard, il faut avant tout définir nos objectifs. On ne peut pas demander aux citoyens de financer massivement des dépenses sans leur expliquer clairement à quoi elles servent. L’argent ne tombe pas du ciel : il vient forcément des particuliers, des entreprises ou des générations futures, via l’endettement. Il est donc indispensable de justifier précisément les choix budgétaires et stratégiques, d’autant plus que, si l’on regarde les budgets militaires des États européens, ils sont globalement équivalents à ceux de la Russie. Pourtant, avec un PIB dix fois supérieur au sien, l’Europe devrait pouvoir faire beaucoup mieux. Pourquoi n’est-ce pas le cas ?
Ensuite, il faut définir les priorités. Faut-il renforcer la dissuasion nucléaire ? Probablement. Faut-il faire plus pour les forces aéroterrestres, chargées de la défense du territoire européen ? Sans doute. Pour les forces de projection ? Peut-être moins. La question se pose aussi pour la marine : est-il plus pertinent d’investir dans un nouveau porte-avions ou plutôt dans des frégates et des sous-marins d’attaque ? Évidemment, poser cette question à un chef de la Marine, c’est risquer d’être immédiatement pendu au grand mât… Mais la réflexion mérite d’être menée.
Enfin, nous avons un problème fondamental d’autonomie. Nous sommes dans une situation de méfiance vis-à-vis des États-Unis, et c’est bien légitime. Il faut donc investir pour garantir une véritable indépendance des forces européennes. Cela implique non seulement de produire en Europe, mais aussi de développer nos propres systèmes d’armement, sans dépendre des technologies américaines. Il ne s’agit pas d’unir toutes les armées européennes en une seule, mais de rendre leur coordination efficace et leurs équipements interopérables. Nous devons investir massivement dans les technologies de guerre modernes. Il faut expliquer aux citoyens français et européens ce que cela signifie concrètement : quels objectifs nous voulons atteindre, quels résultats nous pouvons espérer et combien cela coûtera. À ce moment-là, nous pourrons avoir un débat plus rationnel. Sur le plan financier, il faudra bien admettre que, quoi qu’il arrive, il faudra payer. Si nous voulons une défense à la hauteur des défis actuels, nous devrons accepter d’y consacrer les moyens nécessaires.
TRUMP-MUSK : QUELS CONTREPOIDS ?
Introduction
Philippe Meyer :
Les décisions et les méthodes de Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche, le 20 janvier, soulèvent des interrogations quant aux limites du pouvoir présidentiel aux États-Unis. Le système politique américain repose sur le principe des checks and balances, visant à ce que « le pouvoir arrête le pouvoir », comme l’avait théorisé Montesquieu au XVIIIème siècle. Chacune des trois branches du gouvernement – exécutif, législatif, judiciaire - dispose de moyens de contrôle sur les autres (checks) pour viser un certain équilibre (balance). Les Républicains contrôlent la présidence, la Chambre des représentants et le Sénat. Même si leur majorité à la Chambre est très étroite, la passivité des sénateurs conservateurs face aux nominations les plus controversées de Trump n’augure pas d’un rôle de frein à la présidence de la part du Congrès. Bien que les Républicains n'aient pas capturé l'ensemble du pouvoir judiciaire, ils disposent d'une nette majorité à la Cour suprême.
Depuis deux mois, les recours en justice se multiplient dans les États fédérés à majorité Démocrate qui cherchent à mettre en place des contentieux stratégiques sur quasiment toutes les mesures : suspension des traitements médicaux pour les personnes transgenres, autorisations pour Elon Musk d’accéder aux informations du fisc et de la Sécurité sociale, licenciements massifs de fonctionnaires publics ou intimidations à leur encontre, suppression du droit du sol pour les personnes nées de parents irrégulièrement ou temporairement immigrés, élimination de plusieurs autorités administratives …Même les Églises se tournent vers la justice pour protéger les lieux de culte du décret y autorisant les raids de la police de l’immigration. Mais une bonne partie des dossiers risquent soit d’être enterrés, soit portés devant une Cour Suprême qui a proclamé, avant l’élection de 2024, que Donald Trump, poursuivi dans de multiples affaires, bénéficiait d’une présomption d’immunité en raison du principe de séparation des pouvoirs. Et, le vice-président, J.D. Vance, pourtant diplômé de la faculté de droit Yale, a déclaré que « les juges n’ont pas le droit de contrôler le pouvoir légitime de l’exécutif. » En outre, si l’administration Trump décidait de désobéir à une décision des juges, la Cour ne dispose pas de moyens de coercition.
Face à une opposition étonnamment passive et encore sonnée, les contrepouvoirs paraissent bien faibles. Sauf un, que Montesquieu ne connaissait pas : Wall Street. Les entreprises américaines, surtout les grandes entreprises cotées en Bourse, dépendantes du marché mondial et de la chaîne de valeur globale paraissent être les seules à pouvoir réfréner les ardeurs autocratiques du clan au pouvoir à la Maison Blanche. Wall Street, qui avait soutenu l’élection de Donald Trump, semble déjà déchanter.
Kontildondit ?
Richard Werly :
Je ne partagerai pas complètement la confiance en Wall Street. Elle n’existe que tant qu’on offre aux fonds et aux institutions financières une alternative d’investissement rentable. C’est pourquoi j’ai trouvé intéressant le signal envoyé par la Commission européenne en affichant un montant – certes encore très hypothétique – de 800 milliards d’euros pour la Défense. Ce chiffre ne s’adresse pas seulement aux gouvernements européens, il vise aussi les investisseurs américains : « Venez en Europe, il y aura de l’argent à gagner. » C’est une dimension essentielle : il n’y aura pas de résistance durable de Wall Street contre Trump si les capitaux qui transitent par New York ne trouvent pas ailleurs des rendements comparables à ceux qu’ils obtiendraient aux États-Unis. Il est donc temps pour l’Europe de structurer une véritable alternative d’investissement, et d’affirmer clairement que oui, on peut faire de l’argent en investissant en Europe. C’est ce langage-là qui permettra, peut-être, de détacher Wall Street de Donald Trump.
Pour ce qui est des contrepoids, je suis plus optimiste que la moyenne. J’ai récemment regardé une série sur Netflix, Zero Day, avec Robert De Niro. Ce qui est intéressant, c’est qu’elle a été conçue avant l’élection présidentielle et la victoire de Trump, et qu’elle met en scène une présidente afro-américaine. L’intrigue tourne autour d’un immense bug numérique paralysant le pays, orchestré par l’alliance d’un magnat de la tech devenu fou et d’un groupe d’élus dont on ne précise pas l’affiliation politique. L’issue semble désespérée, mais in fine, la morale et la justice triomphent.
Pourquoi en parler ? Parce que cela illustre ce qui reste encore, selon moi, la grande force des États-Unis : une société où la liberté et la vérité ont encore une chance de prévaloir. Je ne voudrais pas que l’on jette trop vite l’Amérique avec l’eau du bébé Trump. Certes, il a certes profondément marqué le pays, mais il ne l’a pas encore totalement contaminé. La société américaine est sonnée, assommée, mais elle conserve des ressources. Les médias, la société civile, peuvent encore se réveiller et se faire entendre. Et c’est peut-être là qu’est le premier véritable contrepoids.
Quant aux autres, ils sont affaiblis. Les juges sont dans une position compliquée. Difficile d’imaginer ce qu’aurait pensé Maryanne Trump, la sœur de Donald Trump (décédée en 2023), une juge fédérale respectée, en entendant son frère, il y a quelques jours, prononcer un discours au Département de la Justice, appelant les magistrats à se plier à sa volonté, un précédent inédit. Trump est de toute évidence prêt à aller très loin. Mais il y a encore des juges capables de résister. Ils ne seront pas l’ultime barrière, mais ils peuvent ralentir la dérive et offrir à la société civile le temps nécessaire pour se mobiliser. Il y a ensuite les États. Plusieurs gouverneurs sont désormais en rébellion ouverte contre l’exécutif central dirigé par Trump. C’est un contrepoids non négligeable.
Enfin, s’agissant d’Elon Musk, il s’est fait beaucoup d’ennemis. Parmi eux, certains de ses pairs milliardaires, pour des raisons variées – et souvent purement capitalistes – pourraient chercher à l’affaiblir, voire à l’évincer. Les grands fauves du capitalisme américain pourraient finir par se dévorer entre eux. Personnellement, si la proie devait être Elon Musk, je reconnais que cela ne me poserait pas un grand problème …
Nicolas Baverez :
Il y avait trois hypothèses sur Trump. La première, c’était qu’il ne serait qu’une parenthèse, qui se refermerait après un épisode turbulent. La deuxième, qu’il incarnerait un pouvoir transactionnel, brutal à l’intérieur comme à l’extérieur, mais sans renverser fondamentalement les institutions. Et la troisième, qu’il amorcerait une révolution conservatrice, une rupture majeure, transformant en profondeur les États-Unis et l’ordre mondial. Aujourd’hui, il est malheureusement difficile de nier que nous sommes dans la troisième hypothèse, la plus inquiétante.
Quatre éléments en témoignent. D’abord, la toute-puissance présidentielle, incarnée par la doctrine de l’executive unitarianism (exécutif unitaire) qui permet un déluge de décrets et revendique un pouvoir qui n’est contrôlable ni par le Congrès, ni par la justice. Trump a résumé cette doctrine en une phrase : « celui qui sauve son pays ne viole aucune loi. » Deuxième élément : la souveraineté du peuple érigée en opposition à l’État de droit et au pluralisme. C’est un coup d’État à la fois juridique et numérique, avec le rôle majeur joué par Elon Musk. Troisièmement, la prédation économique, avec l’alliance perverse entre un pouvoir politique absolu et une oligarchie de milliardaires liés à la Big Tech. C’est le retour des « barons voleurs » que Theodore Roosevelt avait autrefois combattus. On le voit avec le bitcoin, désormais transformé en réserve stratégique (alimentée par des capitaux bien réels en provenance de Trump, Musk et d’autres acteurs influents), mais aussi avec Musk, qui accumule les marchés et les subventions publiques. Enfin, il y a la stratégie du chaos. Trump assume la brutalisation du système, tant sur le plan économique, avec son protectionnisme exacerbé, que sur le plan stratégique, avec son alignement sur la Russie contre l’Ukraine.
Dans ce contexte, le mécanisme classique des checks and balances ne fonctionne plus. Le Congrès, dominé par les Républicains, accepte pour l’instant sa propre mise en retrait. Il pourrait se réveiller à la perspective des midterms, mais aujourd’hui, il n’est pas un contre-pouvoir. Quant aux Démocrates, ils sont traumatisés, coupés de leur base populaire. Aux États-Unis, c’est une logique de peur qui s’installe : peur chez les fonctionnaires, soumis à des purges et à des campagnes de harcèlement numérique.
Quels sont alors les contre-pouvoirs possibles ? D’abord, Wall Street et l’économie. Trump va conduire l’Amérique à la récession. Contrairement à l’Europe, où la Bourse concerne surtout les investisseurs institutionnels, aux États-Unis, elle est directement liée aux fonds de pension. Une chute de Wall Street signifierait des difficultés massives pour des millions de retraités américains. Ensuite, les États fédérés, qui résistent déjà à certaines décisions de Washington. Enfin, il y a aussi des réactions au niveau international, notamment des nations libres. Le Canada en est un bon exemple : ce pays, qui envisageait de retirer le roi d’Angleterre de ses billets de banque, a finalement décidé de le conserver, réaffirmant ainsi sa souveraineté. Les Canadiens n’ont jamais été aussi unis sur cette question.
Reste la dernière interrogation : le réveil de l’Europe. Le choc provoqué par Trump est immense, mais il engendre aussi une réaction, notamment en matière de sécurité et de compétitivité. Plus encore, il crée une opportunité stratégique : le monde des affaires américain commence à revenir en Europe. Pourquoi ? Parce que le capitalisme a besoin de stabilité, et Trump génère un niveau d’arbitraire et de violence tel que l’Europe redevient un terrain attractif. À nous de saisir cette chance : attirons de nouveau les investisseurs américains, mais aussi leurs chercheurs. C’est une occasion unique de renforcer l’Europe sur le long terme.
Marc-Olivier Padis :
Donald Trump a prononcé vendredi dernier un discours au ministère de la Justice, poursuivant sa campagne d’attaques personnelles contre les juges. Une telle interférence avec le pouvoir judiciaire est effectivement sans précédent dans l’histoire américaine.
Il est important de rappeler que la séparation des pouvoirs et le principe des checks and balances sont deux notions distinctes. En 1787, lors des débats entre fédéralistes et antifédéralistes, les Pères fondateurs américains, inspirés par Montesquieu, ont construit un système qui repose à la fois sur la distinction des trois branches du gouvernement – exécutive, législative et judiciaire – et sur un ensemble de mécanismes de contrôle mutuel. Par exemple, le président dispose d’un droit de veto sur les lois du Congrès, tandis que le Congrès peut voter l’impeachment.
Ce qui change profondément avec Trump, c’est sa volonté de transgresser ces équilibres, notamment par le biais des executive orders, ces décrets présidentiels. Leur statut est d’ailleurs flou dans le droit américain. J’ai interrogé des juristes à ce sujet : curieusement, la Constitution, pourtant extrêmement détaillée, ne les mentionne pas. Ils ne découlent d’aucune disposition explicite de l’article 2, consacré aux pouvoirs du président. Ils relèvent en réalité simplement d’une tradition, qui s’est progressivement imposée. En France, nous avons une culture juridique où la distinction entre la loi et le décret est rigoureusement encadrée, avec des institutions dédiées à veiller au respect de cette séparation. Aux États-Unis, ce n’est pas le cas. Ainsi, Trump a pu multiplier les executive orders sur des sujets sans aucune conséquence pratique (le changement de nom du golfe du Mexique – rebaptisé « golfe de l’Amérique ») à des directives bien plus lourdes de conséquences, orientant l’action des administrations fédérales.
Théoriquement, le rôle du président est de veiller à la bonne exécution des lois. Il peut donc, via ces décrets, préciser aux fonctionnaires comment appliquer une législation. Mais Trump est allé bien au-delà, imposant des directives qui en déforment parfois complètement le sens. Certes, et comme le faisait remarquer Richard, certains juges vont s’y opposer, affirmant que ces décisions outrepassent les textes. Mais là où je suis moins optimiste que lui, c’est sur le délai et la complexité du processus. Contester un executive order en justice est un parcours tortueux, mais surtout très long : il faut passer par un juge de district, puis une cour d’appel, puis éventuellement une seconde, et remonter les échelons avant que la Cour suprême ne tranche. Tout cela peut prendre des années, au cours desquelles les dégâts sont faits. De plus, ces affaires deviennent vite illisibles : elles se transforment en batailles de procédures où l’enjeu ne porte plus sur le fond des décisions, mais sur des questions techniques, comme la légitimité du juge de première instance à statuer.
Ce qui est frappant, et où je rejoins totalement l’analyse de Nicolas, c’est qu’un véritable projet intellectuel conservateur et révolutionnaire est en train de transformer les institutions américaines. La doctrine de l’executive unitarianism, qui vise à renforcer les pouvoirs du président, était déjà à l’œuvre après 2001 sous George W. Bush. Mais aujourd’hui, elle prend une tournure plus radicale. Ce qui est paradoxal, c’est qu’avec Elon Musk, on observe le phénomène inverse : une volonté de démanteler l’État fédéral. Trump, d’un côté, renforce son pouvoir exécutif en dictant la conduite des fonctionnaires par décret, tandis que Musk, de l’autre, sabote cette même administration en licenciant massivement. Trump est littéralement en train de scier la branche sur laquelle il est assis, affaiblissant les moyens d’action de l’État alors même qu’il veut les utiliser à son avantage. Ce double mouvement, qui mêle hypertrophie du pouvoir exécutif et destruction des structures fédérales, est profondément incohérent. Il y a là une contradiction majeure qui, à terme, pourrait bien fragiliser l’ensemble du projet trumpiste.
Jean-Louis Bourlanges :
Nous sommes dans une situation très particulière : aux États-Unis, le pouvoir est exercé par un homme qui ne prépare pas un coup d’État, mais qui en a déjà tenté un il y a quelques années. Un coup d’État qui a échoué, mais dont il est sorti indemne, grâce à des manœuvres juridiques complexes et à une Cour suprême qui, dans le passé, a cherché à lui donner raison. Il existe des précédents historiques : certains dirigeants sont parvenus au pouvoir par des voies légales après avoir tenté un putsch. Hitler, par exemple, a échoué lors du putsch de la Brasserie avant de revenir par les urnes. Il a passé quelques mois en prison (ce qui a produit Mein Kampf) mais cela ne l’a pas empêché de s’imposer ensuite par des moyens d’abord légaux.
Aujourd’hui, aux États-Unis, nous assistons à un bouleversement juridique et politique profond. La question centrale est l’articulation entre ces deux dimensions. Sur le plan juridique, l’administration fédérale est profondément remise en cause. Traditionnellement, les fonctionnaires américains sont loyaux envers le gouvernement et le président, mais ils sont aussi tenus de respecter la Constitution et les principes démocratiques. Or, ce second type de loyauté est désormais visé : il ne s’agit plus seulement d’être fidèle au président, mais de lui être entièrement soumis. Aux États-Unis, les fonctionnaires ne bénéficient pas des mêmes protections sociales qu’en France. Ils sont particulièrement exposés et peuvent être brutalement licenciés. Aujourd’hui, ils sont dans le viseur du pouvoir : des centaines de milliers de personnes risquent de se retrouver en situation de précarité totale. À Washington, ville acquise aux Démocrates à 95 %, cela crée un sentiment d’inquiétude profonde.
Par ailleurs, la théorie de l’exécutif unitaire, que Marc-Olivier a rappelée, renforce cette fragilité : les agences fédérales, qui constituaient jusqu’ici un rempart administratif, sont désormais sous la menace constante du président et de ses proches. Trump, ou son délégué Musk, peuvent révoquer n’importe qui à tout moment. Ce démantèlement de la fonction publique centrale commence à susciter des réactions dans l’Amérique profonde. Comme en France, où Paris incarne souvent l’opposition au reste du pays, le gouvernement fédéral fait face à une contestation grandissante dans plusieurs États.
Deuxième contre-pouvoir : les juges. L’ampleur de la remise en cause du pouvoir judiciaire est impressionnante. Depuis les origines de la Constitution américaine, les tribunaux ont été un élément clé de l’équilibre institutionnel. Comme le soulignait Marc-Olivier, la relation entre les pouvoirs ne repose pas seulement sur leur séparation, mais aussi sur une forme de coopération : le veto présidentiel, le rôle du Congrès, l’intervention des juges… Tout cela forme un système d’interactions complexes. Aujourd’hui, cette logique est brisée : Trump ne veut plus de coopération, il veut un pouvoir unique, sans contrepoids.
Troisième contre-pouvoir : le Congrès. Il est lui aussi frontalement attaqué. Lorsqu’une aide à l’Ukraine, pourtant votée par le Congrès, est bloquée unilatéralement par l’exécutif, ce n’est rien de moins qu’une remise en cause de la souveraineté parlementaire. Les conséquences sont lourdes : les Ukrainiens se retrouvent brutalement affaiblis, non pas par un vote du peuple américain, mais par une décision autoritaire de l’administration Trump. De même, la suppression des crédits de l’USAID a des effets catastrophiques. Certes, ce programme d’aide internationale avait ses défauts, mais son arrêt brutal plonge des milliers de personnes dans la détresse, en particulier en Afrique. Dans certains cas, il devient même impossible d’organiser des opérations de rapatriement. Tout cela est décidé de manière arbitraire, contre l’avis du Congrès.
Un autre élément clé de cette mainmise politique, c’est le contrôle exercé sur la Cour suprême. On connaît la plaisanterie sur les juges de la Cour : « Ils ne démissionnent jamais et meurent rarement. » Ils sont nommés à vie, ce qui garantit à l’exécutif une influence durable. Nous avons nos propres problèmes en France avec le Conseil constitutionnel, dont l’organisation est loin d’être idéale. Mais aux États-Unis, le problème est encore plus aigu : l’allongement de l’espérance de vie rend ces nominations quasiment éternelles, figeant l’idéologie de la Cour pour des décennies.
Quant au Congrès, son silence est troublant. Même chez les Républicains, rares sont ceux qui osent s’opposer frontalement à Trump. Le contraste est saisissant avec l’époque de Ronald Reagan, qui avait mené la lutte contre l’URSS en s’appuyant sur une large coalition, incluant le pape Jean-Paul II, François Mitterrand et Helmut Kohl. Aujourd’hui, on assiste à un renversement complet de cette politique, et les Républicains restent muets. Du côté des Démocrates, l’apathie est tout aussi frappante : à l’exception de Bernie Sanders, on peine à entendre une voix forte s’élever contre cette dérive. C’est là ce qui est le plus troublant pour les Européens : cette absence de réaction intérieure aux États-Unis. La seule voix que nous ayons entendue récemment, sur le territoire américain, est celle du sénateur français Claude Malhuret, qui a prononcé un discours brillant, audacieux et lucide.
Nous sommes actuellement dans un chaos cognitif généralisé. L’esprit public occidental, et particulièrement américain, semble pris dans un tourbillon d’émotions, de moralisation excessive, de revendications indignées, mais sans construction politique cohérente. La réflexion sur les objectifs, la hiérarchisation des priorités, l’acceptation des conséquences d’une politique à long terme semblent avoir disparu. Pour combien de temps ? À mes yeux, le seul véritable contre-pouvoir à la politique de Donald Trump, c’est son échec programmé. Car cette politique, en plus d’être dangereuse, est tout simplement absurde. Elle va à l’encontre des intérêts fondamentaux des États-Unis et finira par se fracasser sur la réalité.