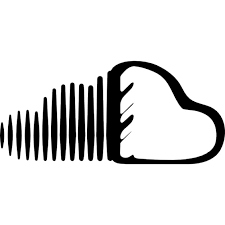POLOGNE, HISTOIRE D’UNE AMBITION
Introduction
ISSN 2608-984X
Philippe Meyer :
La Pologne occupe aujourd’hui une position stratégique centrale en Europe, façonnée par une histoire tourmentée et une résilience remarquable. Longtemps soumise à l’influence de puissances étrangères, elle a même disparu en tant qu’État entre 1795 et 1918 avant de renaître, pour être aussitôt confrontée aux épreuves de la Seconde Guerre mondiale et à la domination soviétique. Depuis la chute du communisme en 1989 et son adhésion à l’Union européenne en 2004, elle s’est affirmée comme un acteur incontournable de la sécurité européenne et transatlantique. Pierre Buhler, vous retracez avec finesse cette trajectoire historique dans l’ouvrage que vous publiez aux éditions Tallandier, Pologne, histoire d’une ambition, en montrant comment le pays a su conjuguer aspirations nationales et intégration internationale.
L’essor économique amorcé dans les années 1990 sous l’impulsion des réformes de Leszek Balcerowicz a permis à la Pologne de s’intégrer pleinement aux chaînes de valeur européennes, en particulier grâce à son partenariat privilégié avec l’Allemagne. Pourtant, derrière cette réussite économique, des tensions persistent. Le parti conservateur Droit et Justice (PiS) revendique une souveraineté nationale affirmée, parfois en opposition avec Bruxelles, tandis que l’opinion publique reste globalement favorable au projet européen. Ces contradictions internes reflètent un débat plus large sur l’identité nationale et le positionnement du pays face aux institutions supranationales.
Sur la scène internationale, la Pologne joue un rôle de premier plan dans la dissuasion face à la Russie. Elle a plaidé pour un renforcement des capacités de l’OTAN en Europe de l’Est et consolidant son alliance stratégique avec les États-Unis, aujourd’hui mise à mal. Son ambition de devenir la première puissance militaire conventionnelle d’Europe atlantique témoigne de cette volonté d’autonomie stratégique. Mais cette posture affirmée ne va pas sans heurts : les tensions mémorielles avec l’Allemagne autour des réparations de guerre, ou encore avec l’Ukraine sur la mémoire des massacres de Volhynie, rappellent combien l’Histoire reste un enjeu diplomatique majeur. À cela s’ajoute la question sensible de la restitution des biens spoliés pendant l’Holocauste, qui continue d’alimenter les débats sur la reconnaissance des injustices passées.
La trajectoire polonaise illustre ainsi un équilibre délicat entre héritage historique, quête de souveraineté et ancrage dans les institutions euro-atlantiques. À travers votre analyse, vous mettez en lumière la manière dont la Pologne cherche à concilier ces dynamiques parfois contradictoires pour s’imposer comme un acteur incontournable de la sécurité et de la stabilité en Europe. Toutefois, le contexte actuel est peu favorable à une position d’équilibre et la question se pose de savoir si la Pologne peut - et jusqu’à quel point - prendre acte du retrait américain de l’OTAN.
Kontildondit ?
Pierre Buhler :
J’ai écrit ce livre pour partager l’histoire d’un pays plutôt mal connu en France. En me plongeant dans l’histoire ancienne de la Pologne, j’ai cherché à définir ce qu’est aujourd’hui l’objet politique « Pologne » et comment il s’inscrit dans le paysage européen. Ce que j’ai identifié, ce sont des lignes de force profondément inscrites dans les gènes historiques, dans la conscience et l’identité du pays, et qui réémergent avec force aujourd’hui.
La première de ces lignes, c’est la cohésion assurée par le catholicisme, véritable ciment de l’histoire polonaise depuis plus de mille ans. Ce facteur a été déterminant dans la libération du pays du joug communiste. Une autre ligne réside dans cette fonction de rempart face aux assauts venus de l’Est. Ces menaces se sont manifestées à différentes époques : dès le XIIIème siècle, avec trois grandes invasions mongoles et tatares qui ont profondément marqué la conscience nationale, puis avec les assauts ottomans. Dans le même temps, la Moscovie, devenue l’empire russe puis tsariste, a engagé une pression continue, jusqu’à s’allier avec la Prusse et l’Autriche pour se partager la Pologne. Le pays a alors disparu de la carte pendant 123 ans, avant de renaître brièvement, puis de disparaître à nouveau en 1939, cette fois sous le double coup de l’Allemagne nazie et de l’Union soviétique. Une occupation qui a duré près d’un demi-siècle.
Au total, cela représente environ 175 ans de non-souveraineté, un facteur décisif dans la formation des esprits. L’intellectuel polonais Jarosław Kwiś parle à ce propos de « syndrome de la souveraineté post-traumatique ». Ce sentiment n’est d’ailleurs pas seulement propre à la Pologne ; on le retrouve aussi dans les pays baltes. Ce sont des nations conscientes que leur existence peut être effacée du jour au lendemain, et c’est cette conscience aiguë qui explique la posture politique et intellectuelle de ces pays en première ligne face à une Russie redevenue agressive, et qui constitue aujourd’hui une menace existentielle non seulement pour eux, mais pour l’ensemble des Européens et en particulier pour l’Union européenne à laquelle ils appartiennent.
Michaela Wiegel :
Je pense que votre livre a ce double mérite de mettre en lumière un traumatisme russe, bien sûr, mais aussi un traumatisme allemand. Et c’est en tenant compte de ces deux dimensions que l’on comprend mieux ce qui freine aujourd’hui la capacité de la Pologne à jouer un rôle de véritable leadership. Même si la relation entre la Pologne et l’Allemagne s’est un peu améliorée depuis les dernières élections parlementaires, elle reste marquée par une profonde méfiance, enracinée dans un passé qui ne passe pas. Ce que je trouve frappant, c’est que, malgré les tensions récurrentes entre la France et l’Allemagne, leur relation a été en grande partie purgée de ces vieux démons. Ce n’est pas le cas entre la Pologne et l’Allemagne.
Et j’aimerais vous entendre sur ce point : la Pologne assure actuellement la présidence de l’Union européenne, mais on a le sentiment qu’elle n’est pas réellement aux commandes. C’est la France, en association avec une Allemagne en attente de gouvernement, qui semble tracer la voie pour l’Ukraine. Je trouve la Pologne étrangement absente. J’ai l’impression que cette défiance persistante vis-à-vis de l’Allemagne, qui a conduit la Pologne à s’en remettre quasi exclusivement à sa relation transatlantique pour sa sécurité, constitue aujourd’hui un sérieux obstacle à un leadership européen.
Pierre Buhler :
C’est tout à fait exact. Historiquement, la Pologne entretient une relation très complexe et douloureuse avec l’Allemagne — une histoire qui commence bien avant la Seconde Guerre mondiale. L’indépendance que la Pologne reconquiert en 1918, a dû se construire contre l’Allemagne. Le territoire polonais, sur le plan ethnique et démographique, formait alors une véritable « peau de léopard » : Silésie, Poméranie, Prusse orientale … Il en résulte une méfiance atavique vis-à-vis de l’Allemagne, que le régime communiste a instrumentalisée. Il se présentait, dans son alliance avec Moscou et à travers le Pacte de Varsovie, comme le rempart contre un éventuel retour du militarisme allemand. Aujourd’hui encore, cette méfiance n’a rien de marginal : elle est profondément ancrée dans la population polonaise, et sert de carburant à la vie politique intérieure. Elle s’est quelque peu estompée durant les vingt années qui ont suivi la fin du communisme. Mais quand le PiS est revenu au pouvoir, il a su la raviver, en s’en servant comme levier politique pour conquérir l’électorat, en prétendant protéger la Pologne face à l’Allemagne.
Lors des deux mandats du PiS — entre 2005 et 2007, puis entre 2015 et 2023 — l’un des arguments récurrents contre l’Union européenne était qu’elle n’était qu’une marionnette, contrôlée en sous-main par l’Allemagne, notamment à travers son influence sur la présidence de la Commission. Cet argument, si douteux soit-il, reste très utile dans les joutes politiciennes. Le PiS l’a largement exploité, en réclamant par exemple des réparations de guerre à hauteur de 1.320 milliards d’euros. Une demande sans fondement réaliste, évidemment refusée par Berlin, mais qui permet d’alimenter une rhétorique persistante contre le gouvernement de Donald Tusk, accusé d’être le porte-voix de l’Allemagne. Cette idée demeure profondément enracinée dans une partie de l’opinion publique.
Concernant le retrait apparent de la Pologne du leadership européen, il tient en grande partie au contexte : le pays est entré en campagne présidentielle, un moment crucial, avec un risque réel de cohabitation et de paralysie institutionnelle. Ce contexte explique le repli actuel, alors que Donald Tusk s’était montré très actif fin 2023 pour mobiliser les dirigeants européens face à la menace russe. Tout dépendra des élections de mai et juin. Si les équilibres changent, la Pologne pourrait retrouver une place centrale sur la scène européenne.
Le candidat de la Coalition civique (le parti de M. Tusk) s’appelle Rafał Trzaskowski. C’est le maire de Varsovie, un homme jeune, brillant, avec un profil intellectuel, que ses adversaires utilisent parfois pour le dénigrer. En face, le PiS (Parti Droit et Justice) soutient Karol Nawrocki, président de l’Institut de la mémoire nationale, mais sa campagne peine à décoller. Plus préoccupant encore : un troisième candidat, issu d’une formation d’extrême-droite, « Confédération »semble avoir dépassé Nawrocki dans les sondages. Il s’agit de Sławomir Mentzen, un jeune entrepreneur. Il est crédité de 22 % des intentions de vote. Et comme il s’agit d’une élection à deux tours, il pourrait bien se retrouver face à Trzaskowski. Est-ce plus risqué pour Trzaskowski d’affronter la Confédération que le PiS ? Difficile à dire. Le candidat du PiS ne convainc pas vraiment, et pour des raisons constitutionnelles, le président sortant ne peut pas se représenter : il a déjà accompli deux mandats.
Matthias Fekl :
Tout au long de votre excellent livre, vous faites de l’ancrage transatlantique l’un des marqueurs les plus forts de la politique étrangère de la Pologne. Dans quelle mesure l’élection de Donald Trump, puis les déclarations de son vice-président lors de la conférence sur la sécurité à Munich — et plus largement, cette dynamique de transformation, qui n’est pas encore un renversement d’alliance mais qui marque tout de même des évolutions profondes aux États-Unis — viennent-elles affecter cet ancrage transatlantique ?
Pierre Buhler :
Depuis la fin du communisme, la Pologne regarde Washington avec des yeux de Chimène, sans réserve ni discernement. Ce tropisme transatlantique structure profondément sa politique étrangère et de sécurité. Elle s’est engagée aux côtés des États-Unis dans la deuxième guerre d’Irak, a ouvert son territoire — ou, en tout cas, a permis l’installation de ces fameuses prisons pour djihadistes — et a adopté une posture de suivisme constant vis-à-vis de Washington. Le président Aleksander Kwaśniewski, pourtant issu du parti communiste, résumait bien cet alignement. Je me souviens que dans une interview au New York Times , on lui pose une question sur une position américaine. Il répond : « Si c’est la vision du président Bush, c’est la mienne. » Autrement dit, le degré zéro de la politique. Et cette attitude a été poursuivie par tous les Premiers ministres et présidents successifs, convaincus que la garantie de sécurité des États-Unis était le seul salut pour leur pays.
Mais les discours et les actes de Donald Trump, pendant sa campagne puis une fois à la Maison Blanche, ont laissé perplexes l’ensemble des Européens, Polonais compris. Face à cela, Donald Tusk a eu l’intelligence de faire évoluer le discours. L’an dernier, il a martelé deux principes : « Plus jamais de faiblesse » et « Plus jamais de solitude ». « Faiblesse », en référence à ces moments où la Pologne s’était affaiblie et en avait payé le prix. Et « solitude », une critique implicite du PiS qui, à force de se brouiller avec tout le monde, s’était isolé : avec l’Allemagne, avec les États-Unis, avec l’Ukraine hmalgré un soutien officiel), et même avec la Lituanie ...
La stratégie de Tusk repose donc sur un équilibre : s’appuyer à la fois sur l’OTAN, l’Alliance atlantique et l’Union européenne. Et parallèlement, consentir à un effort national massif : non pas uniquement pour atteindre les 5 % du PIB exigés par Donald Trump, mais pour renforcer de manière globale l’appareil militaire polonais. L’armée conventionnelle polonaise est désormais, en nombre d’hommes, la première en Europe, devant la France. La trajectoire actuelle pourrait l’amener à 300.000 soldats. Et ce n’est pas seulement une question d’effectifs. Tusk, tout comme le futur chancelier allemand Friedrich Merz, souhaite ouvrir un débat sur la dissuasion nucléaire française. Il n’exclut même pas, en dernière instance, que la Pologne doive se doter de sa propre arme nucléaire, si aucune autre option ne se présente. Signe supplémentaire de cette détermination : la Pologne, avec les pays baltes, envisage sérieusement de sortir de la convention d’Ottawa sur l’interdiction des mines antipersonnel. La volonté est claire, et exprimée sans aucun tabou : la Pologne fera tout ce qu’elle estime devoir faire pour garantir sa sécurité.
Jean-Louis Bourlanges :
J’ai été personnellement et parlementairement très impliqué dans les relations entre la Pologne et l’Union européenne, notamment en tant que membre de la commission mixte entre la Diète polonaise et le Parlement européen, jusqu’à l’entrée de la Pologne dans l’UE. J’ai ainsi connu de près nombre de figures politiques polonaises. Je me souviens de ma première rencontre avec le président Jaruzelski, juste après les élections de la table ronde. Un personnage tout à fait lunaire qui, derrière ses lunettes noires, nous avait lancé : « Demain le soleil brillera encore. » J’ai ensuite beaucoup côtoyé Lech Wałęsa. Et j’ai bien connu Aleksander Kwaśniewski, que vous évoquiez. Je me rappelle de lui lorsqu’il était secrétaire général du POUP (Parti Ouvrier Unifié Polonais) en 1990. J’ai vu cette transformation étonnante d’un leader communiste en une sorte de Tony Blair polonais. Il a terminé son mandat, comme vous l’avez rappelé, en étant totalement solidaire des États-Unis dans la guerre en Irak — ce qui, à l’époque, pouvait surprendre. J’ai également beaucoup apprécié toute l’équipe de la transition démocratique : Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek, Adam Michnik … Des personnalités remarquables. Je n’ai pas rencontré Leszek Balcerowicz, mais j’ai été profondément sidéré de voir, au début des années 2000, tout cet héritage s’évanouir au profit d’une sorte de régression mentale — que vous analysez très justement dans votre livre.
Je voudrais vous interroger sur deux aspects de cette régression. D’abord, la fracture électorale. Quand on regarde la carte électorale polonaise, elle est saisissante. L’Ouest du pays vote massivement pour la Coalition civique, le parti du Premier ministre Donald Tusk. Ce dernier a parfaitement intégré les apports de l’Union européenne en termes de sécurité, de stabilité et de liberté. On a donc un parti profondément européen, dirigé par un homme qui est un véritable maître de l’UE, comme Piotr Serafin, le commissaire qu’il a envoyé à Bruxelles et qui, je le crois, a probablement plus d’influence que le commissaire français.
Face à cela, on a l’Est du pays, qui reste figé dans une posture à la fois rigide et contradictoire. Vous évoquiez tout à l’heure la possibilité que le candidat de la Confédération gagne du terrain. Il est dans une position extrêmement ambiguë. Alors même que la société polonaise dans son ensemble est fondamentalement antirusse, ce candidat joue un jeu trouble. Et je suis convaincu que Vladimir Poutine mise sur cette ambiguïté pour tenter de déstabiliser l’Union européenne.
Et puis, le second point que je souhaite aborder, c’est l’évolution du rapport à l’Église. J’avais participé à une délégation reçue par Monseigneur Glemp, le successeur de Jean-Paul II, et primat de Pologne. Il parlait parfaitement français, mais comme il n’y avait pas que des Français dans la délégation, il s’était exprimé en polonais. À un moment, l’interprète avait traduit : « En Pologne, l’Église ne se mêle pas de politique. » Glemp l’avait interrompu pour corriger : « Je n’ai pas dit ça. J’ai dit : en Pologne, l’Église ne se mêle pas directement de politique. » Nuance essentielle ...
À l’époque de Jean-Paul II, on sentait une adhésion assez forte entre l’idéal européen, la volonté de libération et l’affirmation de l’Église. Le PPE, la CDU, avaient joué un rôle très actif dans le soutien à cette dynamique. Je me souviens très bien d’un déplacement en Pologne avec Egon Klepsch — une figure du PPE — où tout cela ressortait très clairement. Aujourd’hui, on a l’impression d’une Église qui s’est profondément encrassée, et qui semble très éloignée, par exemple, du Saint-Siège. Alors, on peut être critique à l’égard de certaines positions du pape — moi-même, je ne partage pas totalement ce qu’il dit sur l’Ukraine ou sur d’autres sujets — mais il incarne tout de même une évolution. Comment expliquez-vous cette rupture entre ce que j’appellerais le « parti européen » et le « parti catholique » en Pologne ?
Pierre Buhler :
Vous avez mentionné le président Aleksander Kwaśniewski. Il y avait, à l’époque, une blague qui circulait en Pologne : « il a simplement changé de maîtres », en référence au fait qu’après l’Union soviétique, il avait trouvé ses nouveaux maîtres à Washington … Vous avez aussi évoqué Leszek Balcerowicz, le maître d’œuvre des réformes économiques. Ce fut une réforme nécessaire, et fondamentalement bonne, mais elle a entraîné des dégâts dans l’économie politique du pays : des enrichissements suspects, la disparition de diverses formes d’État-providence héritées de l’époque communiste. Dans un premier temps, face à ces bouleversements, la population s’est tournée vers les post-communistes — donc Kwaśniewski et son parti, qui s’était « ripoliné » en formation social-démocrate, mais en réalité de plus en plus libérale-sociale. Pendant une dizaine d’années, ces forces ont alterné avec la droite. Kwaśniewski lui-même est resté président pendant dix ans, dans une fonction qui, il faut le rappeler, n’offre que peu de pouvoir exécutif direct.
C’est au début des années 2000 que les élections ont balayé les « socio-démocrates » au profit de formations national-populistes. C’est ce basculement qui a porté le PiS au pouvoir dès 2005, au sein d’une coalition. Cette coalition n’a pas duré, de nouvelles élections ont permis à Tusk et à son parti de gouverner. Mais un certain malaise social, bien réel, a été exploité par le PiS, qui a su revenir au pouvoir avec une majorité suffisante pour gouverner huit ans.
Cette période a été marquée par une régression notable sur le plan de l’État de droit. Le PiS, dès son premier passage au pouvoir entre 2005 et 2007, avait constaté ce qu’il percevait comme un « impossibilisme juridique » : autrement dit, même porté par le suffrage universel, son action politique se heurtait à des freins constitutionnels. Lorsqu’il est revenu en 2015, il s’est donc attaqué méthodiquement à ces verrous : d’abord le contrôle de constitutionnalité, paralysé dès les premiers jours, puis les médias publics, ensuite les médias privés, enfin les universités. On peut y voir une inspiration directe du modèle hongrois, et un parallèle avec ce que fait Donald Trump aujourd’hui.
La fracture électorale actuelle en Pologne saute effectivement aux yeux sur les cartes : il y a une diagonale, du sud-ouest au nord-est, qui sépare deux pays. À l’ouest — la région de Poznań, la Silésie, la Poméranie, Gdańsk, et puis dans les grandes villes — on vote massivement pour la Coalition civique. Au sud et à l’est, qui correspondent en grande partie à l’ancienne zone d’influence russe (et pour la Galicie, à celle de l’empire austro-hongrois), on trouve ce qu’on appelle le « PiSland » : les bastions du parti Droit et Justice. Ce sont souvent de petites villes, en marge des grandes dynamiques de prospérité, car la croissance en Pologne reste inégalement répartie selon les régions.
Quant à l’Église, c’est un point particulièrement intéressant. Elle a joué un rôle central, notamment sous Jean-Paul II, dans la marche vers la libération du joug communiste dans les années 1980. Une fois la démocratie retrouvée, elle a estimé qu’il était temps de recueillir les dividendes de son engagement, et a commencé à démanteler ce qui, dans la législation antérieure, lui déplaisait — notamment le droit à l’avortement, devenu un enjeu majeur. L’Église n’est pas directement intervenue dans la vie politique, mais elle l’a fait de manière claire, en influençant les partis à propos des grandes lois sociétales. Cela a créé une forte polarisation, dans une société où la jeune génération aspirait à vivre une vie plus ouverte, proche de ce qu’elle observait dans les pays occidentaux — une permissivité que Jean-Paul II dénonçait avec force, parlant par exemple de « culture de la mort » à propos de l’IVG.
L’Église a donc été un allié important, et même efficace, du PiS dans sa conquête du pouvoir. Elle a pu s’appuyer notamment sur Radio Maria, plus qu’une chaîne de radio : un véritable relais électoral du PiS, avec une base populaire solide. Mais le prix de cette alliance a été une sécularisation accélérée de la société polonaise. Les chiffres sont frappants : la pratique catholique s’effondre. La pandémie de Covid a aggravé cette tendance : les églises se sont évidemment vidées, mais une fois la crise sanitaire passée, les fidèles ne sont pas revenus. L’opprobre social qui pesait autrefois, notamment dans les campagnes, sur ceux qui ne se rendaient pas à la messe, a disparu. Les séminaires sont aujourd’hui désertés : presque plus personne ne veut revêtir la soutane. Et à cela se sont ajoutés de nombreux scandales de pédophilie, révélés au grand jour, ainsi que le silence et la complicité de l’Église, qui savait.
Michaela Wiegel :
J’aimerais aborder la relation entre la Pologne et l’Ukraine. Dans votre livre, vous adoptez un point de vue assez inattendu en vous intéressant à la période Bandera, ce qui va un peu à contre-courant. Aujourd’hui, on a tendance à voir la Pologne comme le pays le plus généreux à l’égard des réfugiés ukrainiens — et c’est très certainement vrai. Mais j’ai le sentiment que l’on parle très peu des tensions qui existent malgré tout entre les deux gouvernements, même dans le contexte actuel de guerre. Et ces tensions ne datent pas uniquement du gouvernement PiS : elles perdurent, en réalité, même depuis l’arrivée de Donald Tusk. On voit bien qu’il n’est pas toujours sur la même ligne que les autorités ukrainiennes. Est-ce que cette situation aussi s’explique par une mémoire historique difficile, par des conflits du passé qui n’ont pas été entièrement surmontés ?
Pierre Buhler :
Il y a en effet une histoire longue et complexe entre la Pologne et l’Ukraine — ou plus exactement, entre les Polonais et les Ukrainiens — qui remonte au moins au XVIIème siècle, et probablement même avant. À cette époque, l’aristocratie polonaise s’est emparée de vastes territoires situés de part et d’autre du Dniepr — des régions qui forment aujourd’hui l’Ukraine — pour les coloniser littéralement. Elle a imposé un ralliement de l’Église orthodoxe à Rome, donnant naissance à ce qu’on appelle l’Église uniate, ou gréco-catholique. Il ne s’agissait pas d’une obligation formelle, mais dans les faits, cette église uniate a été instaurée par la Pologne à la fin du XVIe siècle. Cela a suscité un ressentiment immense du côté ukrainien envers ces « Pan » polonais, perçus comme des maîtres dominateurs. Ainsi, dès le milieu du XVIIème siècle, on assiste à de véritables insurrections ukrainiennes, et à la tentative de création d’un proto-État : le Hetmanat, qui a duré quelques années avant que la Pologne ne reprenne le dessus. Ensuite, à l’époque des partages de la Pologne, les tensions sont restées vives. Après la Première Guerre mondiale, en 1918-1919, il y a eu des affrontements ouverts entre indépendantistes ukrainiens et forces polonaises. La Pologne reconstituée a intégré des territoires ukrainiens et biélorusses dans ses frontières entre 1920 et 1939, et les Ukrainiens y étaient clairement traités comme une nationalité de second rang.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, après la défaite allemande à Stalingrad, la Wehrmacht a commencé à se replier, et les nationalistes ukrainiens ont cru qu’ils pourraient alors créer leur propre État. C’est dans ce contexte que l’UPA, l’armée insurrectionnelle ukrainienne liée à Stepan Bandera (qui était alors en prison en Allemagne), a lancé une campagne de nettoyage ethnique contre les populations civiles polonaises de Volhynie. Ces populations n’étaient pas majoritaires, mais elles étaient présentes, et elles ont été massacrées par dizaines de milliers : entre 60.000 et 100.000 victimes civiles. Ce traumatisme a laissé une cicatrice profonde.
Sous le régime communiste, ce sujet a été étouffé : il ne fallait pas nuire à l’idée de fraternité entre les peuples soviétiques. Mais après 1989, cette mémoire douloureuse a ressurgi, et le PiS s’en est emparé. Il avait besoin d’ennemis pour nourrir un récit national conforme à sa vision politique, et cette séquence historique lui offrait un levier puissant. Même après son retour dans l’opposition, ce discours a continué à infuser.
Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, la Pologne s’est montrée très accueillante envers les réfugiés ukrainiens, qui ont été reçus avec beaucoup de générosité par la population. Mais rapidement, les tensions ont refait surface. Certaines exportations agricoles ukrainiennes — notamment de céréales — ont transité par la Pologne, provoquant des perturbations sur les marchés locaux. Cela a entraîné des protestations, des blocus, des accrochages entre transporteurs, et des échanges de noms d’oiseaux entre Zelensky, Duda, Morawiecki … Depuis l’arrivée de Tusk, les choses se sont un peu apaisées. Mais le gouvernement reste très ferme, car il sait que toute faiblesse serait immédiatement exploitée par l’opposition. Nous sommes donc dans un entre-deux : une volonté affichée de soutien à l’Ukraine, mais avec une ligne dure sur les intérêts agricoles et économiques, pour ne pas perdre l’opinion. Enfin, le candidat d’extrême-droite de la Confédération surfe ouvertement sur ce ressentiment envers les Ukrainiens, qui demeure présent dans une partie de la population, dans l’espoir d’en tirer des bénéfices électoraux.
Matthias Fekl :
J’aimerais vous interroger sur la perception de la Pologne en France, j’ai l’impression qu’il existe un décalage important entre tout ce que vous développez dans votre livre et ce que perçoivent beaucoup de citoyens français. On est évidemment sorti du cliché du « plombier polonais », qui avait parasité la campagne du référendum de 2005 — avec des arrière-pensées très claires. Mais comment la Pologne est-elle perçue aujourd’hui en France, et qu’est-ce que cela dit de notre compréhension des enjeux est-européens ?
Pierre Buhler :
M’étant beaucoup intéressé à l’histoire longue de la Pologne, notamment au XIXème siècle, je commencerai par rappeler à quel point la France était alors fascinée par ce pays. La Pologne apparaissait comme une nation qui résistait aux empires, on a par exemple utilisé à son sujet le mot de « résilience », qui me semble tout à fait approprié. Je cite à un moment Victor Hugo, dans un discours remarquable prononcé à la Chambre des Pairs en 1846 : « le peuple français a été le missionnaire de la civilisation en Europe ; le peuple polonais en a été le chevalier. » Cela donne une idée : toute la France libérale était alors aux côtés des Polonais, il y avait un véritable engouement pour leur combat contre l’oppression impériale, notamment l’empire tsariste.
Dans l’entre-deux-guerres, la Pologne était notre alliée, même si le régime avait évolué vers plus d’autoritarisme. Et il faut se rappeler l’enthousiasme suscité en France par le mouvement Solidarność : notre pays a été l’un de ceux qui se sont le plus mobilisés, avec les syndicats, les partis politiques, pour soutenir la résistance au communisme. Même dans les années 1990, si l’opinion publique était peut-être moins mobilisée, les autorités françaises, elles, étaient présentes. Il y avait par exemple la Fondation France-Pologne, dirigée par Jacques de Chalendar, qui a œuvré à la formation des élites municipales et locales.
Puis est venu le navrant épisode du « plombier polonais », qui a laissé des traces. Mais déjà, dans les années 1990, on sentait dans nos élites une certaine réticence à l’idée d’intégrer rapidement la Pologne dans l’Union Européenne. Ce n’était d’ailleurs pas propre à la Pologne : cela concernait l’ensemble des pays libérés du communisme — qu’on appelait alors les « pays de l’Est » (eux-mêmes rejettent cette expression, et préfèrent qu’on parle de pays d’Europe centrale, ce qu’ils sont, de fait).
Aujourd’hui, je dirais qu’il y a une forme d’indifférence installée dans l’opinion publique française. D’autres sujets ont capté l’attention, et la Pologne est devenue moins visible, moins bien connue, moins présente dans les médias. C’est aussi pourquoi j’ai écrit ce livre : pour expliquer à nos compatriotes ce qu’est réellement la Pologne, et rappeler le rôle essentiel qu’elle joue dans notre environnement stratégique, si instable soit-il. La Pologne continue, comme elle l’a toujours fait dans son histoire, de jouer ce rôle de rempart.
Jean-Louis Bourlanges :
Je voudrais revenir sur la question du rapport entre la Pologne et l’Union européenne. Je me souviens d’une émission que nous avions faite en décembre 2023. Lionel Zinsou, Nicole Gnesotto et moi étions frappés par l’incapacité du Conseil européen à répondre concrètement aux besoins de l’Ukraine. Kyiv demandait des armes et des munitions, et ce qu’on lui a proposé, c’était une accélération du processus d’intégration européenne … C’était totalement irréel. Un pays menacé dans son existence immédiate, qui appelle au secours et s’entendait répondre : « vous allez nous rejoindre en 2030. » On voit bien là une tendance typique chez les Européens : se défausser de leurs responsabilités immédiates en tirant de grands plans sur la comète.
Et ce que nous avons fait vis-à-vis de la Pologne me semble également très grave. Vous avez évoqué l’affaire des blés : la libéralisation de la circulation des céréales ukrainiennes a profondément désorganisé le marché polonais. L’Union Européenne a également libéré des contingents tarifaires sur la volaille et sur le lait, ce qui a profité directement à des oligarques ukrainiens qui contrôlent ces deux marchés. Cela a conduit la Pologne à adopter une attitude de plus en plus réticente, y compris sur des dossiers comme le Mercosur. Les Polonais disent : « pourquoi nous demander des efforts sur le Mercosur, alors que vous avez lâché des quantités bien plus importantes de contingents tarifaires sur nos propres marchés ? » Cette attitude européenne a eu un effet contre-productif : elle donne du grain à moudre à la droite populiste, car elle alimente l’idée que la Pologne est marginalisée, voire trahie, par ses partenaires européens. Ce sentiment nourrit à la fois une opposition à l’Union Européenne et une lecture très défensive du rapport à l’Ukraine, perçue comme un acteur déstabilisant, et non plus comme une cause à défendre.
Il faut faire très attention à la manière dont on traite ces équilibres. Je suis, très préoccupé par ce que je vois ces derniers jours au Conseil européen. On assiste, dans les médias français, à une forme d’autocélébration : triomphe supposé des idées françaises sur l’autonomie stratégique, etc. Mais dans le même temps, on perçoit de fortes réticences chez les habituels radins (les Néerlandais, notamment). L’Allemagne, cette fois, semble prête à jouer un rôle d’arbitre. Pascal Lamy disait récemment que Berlin pourrait être en position de médiation entre les différentes lignes européennes. Mais on sent aussi des réserves fortes du côté italien et du côté espagnol, en particulier face à l’idée d’un engagement militaire massif.
Dans ce contexte, je m’interroge vraiment sur ce que signifierait un échec de la Coalition civique à l’élection présidentielle en Pologne. Je crois que cela remettrait profondément en cause toute la dynamique de mobilisation actuelle face à la double menace que représentent l’agression de Poutine et la trahison potentielle de Trump.
Philippe Meyer :
C’est d’autant plus important de bien comprendre cette situation que, après tout, Donald Tusk a déjà travaillé avec le président Duda, qui était pourtant la créature du PiS. Donc si le futur président n’est pas parfaitement aligné avec Tusk, en quoi cela constituerait-il une catastrophe ?
Jean-Louis Bourlanges :
J’ajouterais que Duda vient justement de se faire recadrer de manière assez brutale par J.D. Vance. Duda a récemment réclamé que les Américains installent des forces nucléaires à moyenne portée en Pologne. Et Vance, avec la délicatesse qu’on lui connaît, a répondu qu’il était totalement opposé à cette idée, qu’il la jugeait tellement inadaptée qu’il ne prendrait même pas la peine d’en parler au président Trump. Le président sortant très pro-américain se retrouve dans une situation assez inconfortable …
Pierre Buhler :
L’élection présidentielle sera un enjeu majeur, car depuis décembre 2023, le gouvernement dirigé par Donald Tusk est paralysé sur plusieurs fronts à cause de la cohabitation et du droit de veto présidentiel. Le président polonais a peu de pouvoirs, mais il en détient un considérable : celui de bloquer la promulgation des lois. Il ne signe que celles qu’il considère conformes à ses vues — et il en a déjà refusé un grand nombre. Par ailleurs, il peut aussi bloquer les nominations. Résultat : aujourd’hui, l’appareil diplomatique polonais est composé principalement de chargés d’affaires, car juridiquement, le gouvernement ne peut pas nommer de nouveaux ambassadeurs sans le feu vert du président. Alors le ministre des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, rappelle les ambassadeurs nommés à l’époque du PiS et place ses propres représentants, ceux qu’il juge les plus aptes à défendre la politique étrangère du pays. M. Sikorski est parfois un peu excessif, mais il est habile et très intelligent. Cela étant dit, si cette paralysie institutionnelle devait se poursuivre avec l’élection d’un président issu de l’opposition, cela poserait un véritable problème pour le fonctionnement même d’un État moderne. Mais politiquement, cela pourrait aussi redonner un souffle à l’opposition.
Les prochaines élections législatives sont prévues pour octobre 2027, mais d’ici là, les formations national-populistes restent en embuscade. Et si le jeune candidat de la Confédération devait accéder au second tour de la présidentielle, qui sait quelles conséquences cela pourrait avoir … Nous sommes en train de passer dans un monde de plus en plus fluide, presque liquide, où les choses évoluent très vite, avec une sorte d’accélération : tout ce qui nous semblait solide ou stable peut très vite se déliter, s’effondrer. C’est ce qu’on observe aux États-Unis : on pensait que les fameux « mécanismes de rappel » allaient jouer leur rôle de protection, et on assiste finalement à une forme de dévastation politique. Rafał Trzaskowski est un bon candidat — assurément brillant. Mais est-ce que cela compte toujours aux yeux de l’électorat ? C’est difficile à dire. Je pense qu’il a de très bonnes chances de l’emporter, notamment s’il parvient à cristalliser une forme de pare-feu, de « front républicain ». Mais la messe n’est pas dite.