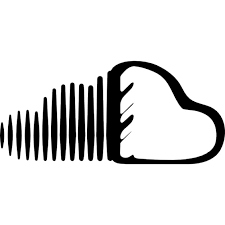TABLEAU DES FORCES POLITIQUES APRÈS LA DÉCISION DU TRIBUNAL DE PARIS
Introduction
ISSN 2608-984X
Philippe Meyer :
Lundi, Marine Le Pen a été reconnue coupable de détournement de fonds publics dans l’affaire des assistants parlementaires européens du Front national (devenu Rassemblement national, RN). Elle a été condamnée à quatre ans d’emprisonnement, dont deux ferme avec bracelet électronique, et à une amende de 100.000 euros. Mais c’est la peine d’inéligibilité à cinq ans avec exécution provisoire qui fait débat. La députée du Pas-de-Calais a interjeté appel, mardi, de la décision du tribunal correctionnel de Paris. Quelques heures après, la cour d’appel de Paris a annoncé vouloir rendre sa décision à l’été 2026.
Alors que la leader du RN s'insurge contre « la tyrannie des juges », le Président défend « l'indépendance de la justice ». En revanche, tout en considérant qu’il n’a « pas le droit », en tant que membre du gouvernement, de « critiquer une décision de justice », François Bayrou a jugé « en tant que citoyen », que la décision du tribunal correctionnel de Paris soulève « des interrogations ». Lui-même est sous la menace d’une condamnation dans l’affaire des assistants parlementaires du MoDem au Parlement européen, pour des faits comparables à ceux reprochés à Marine Le Pen. Le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon a jugé que « la décision de destituer un élu devrait revenir au peuple ». LFI pourrait bientôt devoir répondre devant la justice à des accusations semblables. Le président du Sénat, Gérard Larcher a estimé que « si la loi va trop loin, le législateur doit pouvoir la corriger », tandis que le président du groupe de l’Union des droites pour la République à l’Assemblée nationale, Éric Ciotti, allié de Marine Le Pen, a décidé de la « supprimer ».
Écologistes, socialistes, communistes et anciens « insoumis » ont applaudi la décision des juges et fustigé au passage les propos de Jean-Luc Mélenchon. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, et le chef de file des députés macronistes, Gabriel Attal, se sont démarqués. « Je suis troublé par le trouble du Premier ministre », a dit Olivier Faure. « Je ne suis jamais troublé par la démocratie », a enchaîné Gabriel Attal. Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand s’est inquiété des « manifestations de soutien » de « l’internationale de l’extrême droite » à l’endroit de Marine Le Pen.
Ce week-end, Le RN a organisé une mobilisation dans les rues afin de mettre la pression contre l’institution judiciaire – ou comme il le présente, « sauver la démocratie ». Ce dimanche, Gabriel Attal entend rassembler le bloc central dans un meeting au cours duquel, Edouard Philippe, qui n’est pas encore sorti de sa réserve, devrait s’exprimer. D'après un sondage Elabe pour BFMTV 57 % des Français estiment que la décision de justice est « normale au vu des faits reprochés ».
Kontildondit ?
Nicolas Baverez :
Jamais une décision de la justice française n’avait provoqué de telles réactions. On a parlé des réactions en France, mais n’oublions pas l’étranger, puisque Donald Trump, Elon Musk, Matteo Salvini, Vladimir Poutine ou encore Steve Bannon ont commenté cette décision. Comment l’expliquer, et qu’en dire ? Ce qui frappe d’abord, c’est à quel point on a peu travaillé le droit, tant dans la défense que dans les commentaires. Du côté de Marine Le Pen, rien ou presque n’a été fait sur la question de la prescription, ni sur la loi Sapin, alors que la grande majorité des faits lui sont antérieurs. Il y avait là matière à discussion sérieuse.
Concernant l’exécution provisoire, qui est l’aspect le plus complexe, il faut reconnaître que le raisonnement des juges, fondé sur le risque de récidive et de trouble à l’ordre public, est pour le moins paradoxal et mérite qu’on s’y attarde. L’un des principes fondamentaux du procès équitable, c’est le droit à l’appel. Or, pour que l’appel ait un sens, sauf en matière criminelle, il faut que la décision contestée ne produise pas déjà ses effets les plus irréversibles. C’est un vrai problème en matière de présomption d’innocence et de respect du droit au procès équitable.
Autre élément étonnant, même dans le camp de l’extrême droite : tout le monde se félicite que l’appel soit prévu pour l’été 2026. Quand on connaît le fonctionnement de la justice et le corporatisme judiciaire, c’est pour le moins paradoxal. Je rappelle en outre que la Cour de cassation a rendu deux décisions confirmant que l’exécution provisoire est maintenue, y compris en cas de cassation après un appel défavorable. Du point de vue juridique, on est donc dans une situation où la défense, les commentaires et même le jugement sont déconnectés du droit. Cela a conduit à un emballement politique total, avec des manifestations contre une décision de justice, ce qui n’est certainement pas la manière de faire fonctionner un État de droit. Le président Larcher a sorti une phrase pour le moins surréaliste : « si la loi va trop loin, le législateur doit la corriger ». Peut-être faudrait-il lui rappeler que cette loi a été votée par ce même législateur, et récemment. Il aurait peut-être été plus pertinent de légiférer avec réflexion, plutôt que dans l’émotion ...
Quant aux conséquences politiques, elles restent très incertaines : Marine Le Pen pourra-t-elle se présenter ? Quelle sera la stratégie du RN ? Quel impact sur les élections ? Les Français sont divisés. Une majorité estime que la sanction est méritée, mais une minorité importante est profondément révoltée par la décision. Deux aspects de fond me paraissent sous-estimés. D’abord, ce jugement marque une bascule dans le fonctionnement des institutions de la Ve République. L’exécutif débat au lieu d’agir. Le Parlement ne vote plus de lois sérieuses, seulement des textes folkloriques, et il ne joue plus son rôle de contre-pouvoir. Le débat n’existe plus vraiment, remplacé par l’invective. Dans ce vide institutionnel, l’autorité judiciaire s’est engouffrée, et on assiste à une forme de vengeance judiciaire contre la classe politique. Il suffit de regarder l’Italie pour comprendre ce que cela produit : la destruction méthodique des partis traditionnels et, mécaniquement, la montée au pouvoir de l’extrême droite. Par ailleurs, le droit a été remplacé par une morale de corps, ce qui est très contestable.
Le second aspect, inédit, c’est l’impact international. Certains parlent d’une « internationale réactionnaire » ; je parlerais plutôt du « camp illibéral », qui est aujourd’hui majoritaire dans le monde et qui soutient activement Marine Le Pen. Au lieu de réagir dans l’urgence par des propositions de loi, il faudrait réfléchir à deux choses. D’abord, il ne s’agit pas de changer la Vème République, mais d’en retrouver l’esprit : remettre de la responsabilité au sommet, de l’engagement à la base. Ensuite, il faut organiser une réponse des démocraties, qui défende l’État de droit, mais qui en fasse aussi évoluer les règles pour affronter des problèmes bien réels. Il faut permettre à ce qu’il reste de démocratie dans le monde de se coordonner pour répondre ensemble à cette spectaculaire offensive illibérale.
Nicole Gnesotto :
Quelles sont les conséquences de ce verdict sur l’état des forces politiques ? Il est aujourd’hui très difficile de savoir de quel côté va tomber le curseur. Le Rassemblement national est le parti pour lequel il y a le plus d’incertitude. Il est possible qu’il joue dans cette affaire à « qui perd gagne ». D’un côté, on peut dire que le parti est affaibli, d’abord parce qu’il risque de perdre son leader. Mais ce n’est pas seulement Marine Le Pen qui est concernée, c’est toute la colonne vertébrale du parti qui est mise en cause, avec notamment M. Alliot ou M. Odoul, le porte-parole du parti. Et cette décision pourrait créer un vrai conflit entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Ce dernier aura peut-être envie de s’affirmer ... Donc, on peut penser que le RN sera affaibli, surtout si le parti se « trumpise » dans la rue. Si l’on assiste à des manifestations radicales, une partie des électeurs récents du RN pourrait en être effrayée et cesser de le soutenir.
Mais à l’inverse, il est également possible que le RN ressorte renforcé de cette épreuve. D’abord parce qu’il est passé maître dans l’art de transformer une coupable en victime. Ensuite, cette affaire pourrait signer un tournant : l’abandon de la stratégie de normalisation du RN, et le retour à un RN polémique, provocateur, « trumpiste ». Ce qui, pour certains, pourrait être séduisant. Le RN peut ainsi devenir le réceptacle de tous les ras-le-bol français : ras-le-bol de la République des juges, ras-le-bol de l’élitisme, de l’Europe, de la mondialisation … Ce positionnement pourrait faire monter ses scores. Sur le site du RN, on annonce que 300.000 personnes ont signé leur pétition, et que 10.000 ont rejoint le parti depuis le jugement.
Pour les autres partis, c’est un peu plus clair. Le vrai perdant de cette affaire, c’est Jean-Luc Mélenchon. Il avait fait de son opposition à Marine Le Pen l.alpha et l’oméga de sa stratégie pour le second tour de la prochaine présidentielle. Elle était la candidate repoussoir par excellence, et face à elle, il pouvait espérer l’emporter, comme le nouveau Front populaire avait triomphé aux dernières législatives en se présentant comme le rempart face au RN. Mais si Marine Le Pen disparaît du paysage politique et que Jordan Bardella la remplace, personne aujourd’hui ne pense qu’il sera capable de faire le même score qu’elle. Mélenchon se retrouve donc de facto décrédibilisé.
Le grand gagnant potentiel, c’est Bruno Retailleau. Je crois qu’il est aujourd’hui le seul à se réjouir franchement de cette situation. Toute sa stratégie consistait à coller aux thèmes du RN — immigration, sécurité, autorité — tout en conservant une façade républicaine. Si Mme Le Pen disparaît, Bardella ne fera pas le poids face à Retailleau. Cela pourrait représenter un espoir pour une victoire des LR à la prochaine présidentielle.
Philippe Meyer :
Les sondages sur la prochaine présidentielle, avec l’hypothèse tantôt Marine Le Pen, tantôt Jordan Bardella, ne donnent pas raison à votre raisonnement, puisque l’un et l’autre obtiennent des scores extrêmement proches.
Lucile Schmid :
Quand Marine Le Pen lorsqu’elle s’est su condamnée, elle a déclaré : « l’État de droit a été violé. » Cette formule, à la fois surprenante et révélatrice, témoigne de son hésitation entre une posture institutionnelle — la stratégie de la respectabilité — et la tentation de dénoncer le système qui la rattrape. C’est à travers cette phrase qu’on peut examiner les questions qui nous sont posées aujourd’hui : en quoi l’État de droit garantit-il le bon fonctionnement de la démocratie et une vie démocratique saine ? Pour moi, c’est la vraie question.
C’est aussi pourquoi je me suis plongée dans les motivations du jugement — 152 pages — et je dois dire que contrairement à Nicolas, je trouve l’argumentation juridique solide. Les juges partent du principe que lorsqu’on prétend à de hautes responsabilités, quand on est élu, on est tenu de respecter les principes du droit pénal. Il n’existe aucune exemption au motif qu’on serait élu. Et lorsque vous ambitionnez la magistrature suprême — Marine Le Pen a toujours affirmé qu’elle se présenterait en 2027, et elle l’a encore répété après sa condamnation, en écartant toute alternative —, les juges considèrent qu’il faut examiner les faits avec une attention encore plus grande. Or que disent ces faits ? Qu’un système structuré, systématique de siphonnage des fonds du Parlement européen était en place depuis 2005. Et ce n’est pas comparable à ce qui s’est passé autour de François Bayrou : ici, le système est plus élaboré, plus ancien, et le détournement de fonds bien plus massif. De surcroît, les membres du RN n’étant pas toujours très habiles, il existe des mails dans lesquels un député européen du RN évoque clairement la question des emplois fictifs, et le trésorier du parti lui répond en citant Marine Le Pen comme caution. On est donc face à des faits massifs, avérés, face auxquels la ligne de défense de Marine Le Pen a consisté, tout au long du procès, à nier en bloc et à tout réduire à un simple problème administratif. Il est évident que ce déni systématique a pesé dans la conviction du juge et dans la sévérité du jugement. Quant à l’exécution provisoire, (qui n’aurait choqué personne si elle avait concerné un chef d’entreprise ou un citoyen ordinaire), elle s’explique par la volonté d’empêcher la récidive.
Dire qu’il n’y a plus de risque parce qu’elle n’est plus députée européenne ne tient pas, puisque Mme Le Pen affirme n’avoir rien fait de répréhensible, et qu’elle siège aujourd’hui à l’Assemblée nationale. Or le risque de récidive ne se mesure pas à l’institution concernée, mais à la possibilité même de détournement. Et ce risque reste avéré.
Je trouve donc ce jugement très juste. Certes, certains sondages montrent qu’une minorité importante de Français rejette ce raisonnement, mais une majorité l’approuve. Et il y a une autre question qui me semble cruciale : la manière dont le Rassemblement national prétend être propriétaire de ses 11 millions d’électeurs. Aucun parti politique n’a jamais revendiqué une telle appropriation de son électorat. Ce jugement ouvre un abîme entre une grande partie de la classe politique française et beaucoup de citoyens, comme s’il existait désormais une vie parallèle entre le monde judiciaire et la sphère politique et démocratique. Or une démocratie ne se résume pas à l’élection. Elle repose aussi sur l’existence de contre-pouvoirs, sur une autorité judiciaire indépendante. De ce point de vue, les mots du Président Emmanuel Macron ont été justes : « il y a une justice indépendante, il faut respecter les juges. Ensuite, il y a un droit de recours. » En quelques phrases, il a dit l’essentiel. J’aimerais que notre classe politique, ou du moins une partie d’entre elle, soit capable de cette sobriété et de cette clarté.
Aujourd’hui, le débat politique se résume à un choix binaire : soit on soutient les juges, soit on les attaque. Mais ce n’est pas la bonne question. La vraie question, c’est : qu’est-ce qu’une vie démocratique dans une démocratie moderne comme la France ? Un pays où, désormais, le détournement de fonds publics, comme le rejet des lois — je rappelle que la dernière loi sur l’immigration comportait une vingtaine d’articles contraires à la Constitution — sont devenus pour certains un sport national. Il faut en finir avec cela : l’État de droit n’a pas été violé. Il doit être protégé, et renforcé.
Jean-Louis Bourlanges :
Je suis frappé par la manière dont le débat s’est structuré autour de la responsabilité du système juridique lui-même. Il aboutit à imputer cette responsabilité aux juges, qu’on accuse d’avoir bien ou mal agi, selon qu’on approuve ou non leur décision. Il est pourtant incontestable que dans cette affaire, les juges ont agi dans le strict respect de la loi. Et c’est là que se situe, selon moi, le vrai problème : la loi elle-même, notamment la loi Sapin, me paraît très contestable, sur au moins trois points.
Premier point : cette loi est une loi de circonstance, comme le sera d’ailleurs la proposition de loi annoncée par Éric Ciotti. Et je crois qu’une loi de circonstance est toujours une mauvaise loi. Dans le cas présent, la loi Sapin est née en réaction à l’affaire Cahuzac. Mais ce qu’on a reproché à Jérôme Cahuzac — au-delà du mensonge à l’Assemblée nationale, qui est grave et pourrait justifier une procédure d’indignité nationale — c’est un délit de droit commun. Il avait placé sur un compte en Suisse les honoraires qu’il touchait comme chirurgien, tout en niant leur existence. Rien là-dedans qui ne soit spécifique à une fonction politique, c’est un comportement que n’importe quel citoyen aurait pu adopter. Et pourtant, on a construit à partir de cela un dispositif juridique particulier, ciblant spécifiquement les élus.
Deuxième point : l’atteinte au principe de la double juridiction. Et ici encore, je ne remets pas en cause les juges, car la loi est explicite. Elle ne leur laisse pas le choix : l’exécution provisoire est de droit, sauf exception motivée. En l’occurrence, ils ont estimé qu’aucune exception ne s’appliquait. La juge a certes mal présenté les choses, mais elle a appliqué la loi.
Troisième point : le concept d’inéligibilité. Je peux comprendre qu’on le prononce dans les cas d’indignité nationale, comme cela s’est fait par le passé. Mais on parle ici d’une disposition qui permet au juge de se substituer au peuple pour apprécier les qualités d’un candidat. C’est un glissement problématique, et cette sanction devrait être maniée avec une extrême prudence. Mais là encore, ce n’est pas aux juges qu’il faut en vouloir : c’est la loi qui leur donne cette prérogative.
Dans cette affaire, ce sont donc les hommes politiques qui se sont montrés légers. On se souvient de ce que disait François Mitterrand, à la fin de son dernier Conseil des ministres : « Méfiez-vous des juges, ils ont tué la monarchie. Ils tueront la République. » Or, ce qu’on voit ici, c’est que les responsables politiques, dans cette affaire, se sont comportés exactement comme des plaideurs ordinaires. Quand un scandale touche un parti, la classe politique accuse les juges. Ce jeu de renvois a conduit à l’adoption de lois insatisfaisantes.
Cela dit, dans ce cas précis, je considère que le le président de la cour d’appel a fait preuve d’un vrai sens des responsabilités. Et il ne s’en est pas pris à ses collègues, mais à ceux qui ont voté la loi. Ce qui l’a choqué, profondément, c’est qu’on puisse priver un justiciable du double degré de juridiction pour une affaire d’une telle gravité. Il a donc pris la décision d’« audiencer ». Grâce à cette décision, le cœur du problème est résolu : les juges ont respecté la loi, et la remise en cause du double degré de juridiction a été écartée par une interprétation raisonnable de la loi Sapin. La situation, de ce point de vue, est redevenue satisfaisante.
Sur les conséquences politiques, je crois que tout cela s’inscrit dans un contexte plus large, un moment de remise en cause systématique des fondements mêmes de la pensée populiste et nationaliste — ou insoumise — dans la société française. Ce que l’on voit à travers cette affaire, et ce qui se passe ailleurs — Trump, Poutine — c’est une mise en échec progressive de ces discours. Le libre-échange, par exemple, était encore récemment voué aux gémonies, personne ne reconnaissait ce qu’ont pourtant démontré Trenard et Jean Court-Galignani — à savoir que le libre-échange a été un levier décisif pour le monde en developpement. En géopolitique : pendant longtemps, certains ont voulu minimiser Poutine. Aujourd’hui, tout le monde voit bien que c’est un dictateur dangereux, et que Trump n’est pas mieux. On revient donc à des exigences géopolitiques claires. Troisième point : l’Europe. Elle était constamment vilipendée. Désormais, on comprend qu’elle est indispensable si l’on veut défendre notre sécurité, notre économie et notre démocratie. Il y a donc un retour du balancier, et cette affaire en est une des expressions. Car au fond, ce qu’elle révèle, c’est que les délires populistes de Mme Le Pen — condamner tout le monde, contester l’État de droit — trouvent aujourd’hui leurs limites. Elle est dans la position de l’arroseur arrosé. Cela place le RN dans une situation très difficile. La famille Le Pen, en voulant conserver une emprise dynastique sur le parti, pousse à une stratégie de re-diabolisation. À l’inverse, Bardella incarne un RN qui veut poursuivre la dédiabolisation. Il n’est pas du tout sur la même ligne que Mme Le Pen, notamment sur le libéralisme. On assiste donc, au sein même de l’extrême droite, à un affrontement entre deux trajectoires antagonistes. Et cela rend l’issue de la prochaine élection présidentielle très incertaine.
Nicole Gnesotto :
Sur le jugement lui-même, j’aimerais apporter deux contre-arguments à ce qu’a dit Lucile. Le premier concerne l’idée que les juges auraient estimé que la ligne de défense de Marine Le Pen n’était pas la bonne. On comprend en filigrane que si elle avait reconnu les faits, elle aurait peut-être été moins lourdement condamnée. Je trouve cela absolument incroyable. S’il y a une chose qui doit rester libre dans notre système judiciaire, c’est bien le droit, pour un accusé, de choisir sa stratégie de défense, quelle qu’elle soit. Les juges doivent juger sur les faits, pas sur la forme ou la nature de l’argumentaire présenté.
Deuxième point, sur l’exécution provisoire. Elle est automatique dans la loi, c’est un fait. Mais cette automaticité connaît des exceptions, et parmi les éléments pouvant justifier une dérogation, il y a bien la prise en compte du contexte politique général. Or, on aurait pu imaginer que, dans un tel contexte, la juge décide de ne pas appliquer immédiatement la sanction, mais de la suspendre jusqu’à l’issue de l’appel. Il y avait matière à apprécier différemment la situation.
Enfin, sur les conséquences politiques plus immédiates, je me pose une question : si Marine Le Pen ne peut pas être candidate en 2027 et si Emmanuel Macron ne peut pas non plus se représenter, cela signifie que les deux grandes figures politiques qui dominent aujourd’hui la scène française auront disparu en deux ans. Cela pourrait marquer un retour à une configuration politique plus classique, avec une recomposition droite-gauche-centre. Les extrêmes auraient perdu leurs deux figures emblématiques, Marine Le Pen d’un côté, Jean-Luc Mélenchon de l’autre. Mais ce n’est encore qu’une hypothèse …
Lucile Schmid :
Je ne crois pas du tout que la question soit psychologique ou que, du côté des juges, il y ait l’idée de nier à Marine Le Pen la liberté de sa ligne de défense. En revanche, on peut juger la contradiction qui existe entre le factuel avéré par l’enquête judiciaire et la réalité des arguments présentés par Marine Le Pen, qui réduit les choses à un problème administratif alors même que le détournement de fonds publics est parfaitement avéré et renseigné. On voit dans les motivations du jugement que, dans les condamnations à reverser les fonds qui ont été détournés et puis aux amendes, il y a des choses très précises qui sont dites ; une enquête a tout de même montré qu’un certain nombre de personnes étaient rémunérées par le Parlement européen, alors qu’ils n’y mettaient jamais les pieds … Il y avait une enveloppe globale, et il fallait en dépenser jusqu’aux moindres centimes. Ça s’appelle tout simplement un détournement de fonds organisé.
Si l’on revient à une scène politique traditionnelle, sans Mme Le Pen et M. Macron, n’oublions pas que le détournement de fonds publics a concerné aussi bien François Bayrou et Jean-Luc Mélenchon que Marine Le Pen. Donc on peut espérer que dans cette scène à venir, ce détournement de fonds publics sera empêché, ce qui pose la question du financement des partis politiques lorsqu’ils ont peu de députés, de façon à ce qu’on n’imagine pas que le détournement de fonds publics est excusable parce qu’on était faible.
Il me semble que la question de l’exemplarité du personnel politique est aujourd’hui très ouverte, pas seulement à l’élection présidentielle. Qu’est-ce que ça veut dire, être exemplaire, quand on est un élu ? Cette question est posée à un moment où le malaise entre les Français et ceux qui sont élus n’a jamais été aussi important. Il ne faut donc pas l’entendre seulement de manière juridique. Peut-être que la loi Sapin est une mauvaise loi, il n’en reste pas moins qu’en 2016, Marine Le Pen avait dit : « il faut faire de l’exécution provisoire automatique. » Donc, si être élu, ça signifie dire une chose en 2016 et crier à la fin de l’État de droit lorsqu’on est soi-même concerné, il y a un problème d’exemplarité …
Philippe Meyer :
Il ne faut surtout pas sous-estimer le fait que cette affaire a aussi des conséquences à gauche. On assiste à une rupture de plus en plus nette entre la France insoumise et le reste de la gauche. À ce propos, il faut souligner une déclaration de Jean-Luc Mélenchon qui, à mes yeux, illustre parfaitement sa méthode : celle qui consiste à transformer la réalité pour mieux répondre aux questions qu’elle soulève. Il a affirmé que « la décision de destituer un élu devrait revenir au peuple ». Mais il n’est écrit nulle part qu’un élu doive être « destitué », et encore moins que cela relève d’une autre instance que les électeurs. C’est une manière très caractéristique de M. Mélenchon de brouiller les repères, de créer un brouillard autour d’une question pourtant simple, tout à fait représentative de sa méthode.
Jean-Louis Bourlanges :
Marine Le Pen ne peut s’en prendre qu’à elle-même. C’est vraiment le cas typique de l’arroseur arrosé : elle proteste aujourd’hui contre un système qu’elle a, par le passé, appelé de ses vœux — et même sous une forme plus dure encore. Elle est donc en pleine contradiction. Là où je rejoins Nicole, c’est sur le fait que l’expression d’un désaccord juridique est un droit fondamental. La preuve : le système judiciaire prévoit deux niveaux de juridiction. Cela signifie bien qu’une décision de première instance n’est pas une vérité d’Évangile. Ce qui m’a choqué dans les motivations du tribunal, c’est cette tendance à assimiler le simple fait d’exprimer un désaccord juridique à une forme de désobéissance civile. Je ne vois aucune raison de faire ce raccourci.
Je rappelle que les faits incriminés se sont arrêtés en décembre 2016. Donc, parler de récidive me paraît excessif. D’autant que la loi Sapin a été promulguée à cette même période, ce qui pose une vraie question de rétroactivité, ou du moins de son application dans le temps. C’est cet aspect-là de la décision qui m’a profondément dérangé : l’exécution provisoire. Mais contrairement à d’autres, je n’ai jamais mis en cause les juges sur ce point, car ils n’ont fait qu’appliquer une loi qui rend cette exécution obligatoire, sauf exception motivée.
Aujourd’hui, le problème me semble d’ailleurs réglé, grâce au président de la cour d’appel. Marine Le Pen aura bien droit à un double degré de juridiction. Cela étant dit, je ne suis pas certain que le fait de repousser la décision à l’été 2026 soit un avantage pour le RN. En tant qu’observateur, plus que comme ancien responsable politique, j’ai été frappé par une chose : les déclarations de Marion Maréchal Le Pen, à la télévision, manifestant une solidarité presque débordante envers sa tante. Et là, je me suis rappelé qu’elle avait, au moment de la confrontation entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, fait preuve d’une très grande félonie. Alors, que s’est-il passé ? J’ai l’impression que Marine et Marion Le Pen partagent une vision commune : celle d’un RN « propriété de la famille ». Marion, sans doute, voit dans la fragilisation actuelle de sa tante l’occasion de faire valoir qu’elle, en tant que Le Pen, est plus légitime que l’usurpateur Bardella. L’un des enjeux de cette affaire, à l’intérieur même du RN, c’est ce conflit entre deux lignes : d’un côté, les dynastes, pour qui le RN est une affaire familiale ; de l’autre, Bardella, représentant malgré lui — avec une forme de gêne, de retenue presque troublante — d’une volonté de normalisation du parti. Jordan Bardella ne partage pas les positions économiques de Marine Le Pen, notamment sur le libéralisme. Nous assistons donc, au cœur même de l’extrême-droite, à une tension durable, dont je ne sais pas dans quel état le RN sortira.
Nicolas Baverez :
Andreï Vychinski, le procureur des procès de Moscou, disait : « la justice n’est pas là pour défendre l’individu contre l’État, elle est là pour défendre l’État contre les individus. » Cette logique, que l’on pensait révolue, réapparaît ici, et c’est ce qui est choquant dans cette affaire. Dans notre système, un témoin doit jurer de dire la vérité, mais un accusé, non. Il a le droit de choisir sa défense, de se taire, voire de prendre des libertés avec la vérité. C’est sa liberté, et c’est un fondement de l’État de droit. C’est pourquoi il est extrêmement choquant que le tribunal ait laissé entendre que, pour échapper à l’exécution provisoire, Marine Le Pen aurait dû avouer. Là, on entre dans une logique de procès de Moscou, et c’est inacceptable dans une démocratie. Cela va à l’encontre de la présomption d’innocence et du droit à une défense libre. Autre point choquant : la suppression de la règle de l’appel. Cela remet en cause des principes essentiels du procès équitable.
Marine Le Pen se retrouve piégée par le système qu’elle a elle-même défendu. Je rappelle qu’elle s’était prononcée pour l’inéligibilité à vie lors des débats sur la loi Sapin ... D’une manière plus générale, cette tendance à pénaliser la vie politique — comme on l’a fait avec la vie économique — devient absurde. On voit des parlementaires voter des lois en partant du principe que les juges ne les appliqueront jamais. Mais les juges, eux, sont là pour les appliquer, même quand ces lois sont mal conçues, disproportionnées, ou tout simplement déraisonnables.
Troisième point, plus profond : les effets à long terme. Le poison qui se diffuse aujourd’hui dans la démocratie est à la fois efficace et dangereux. Les conséquences immédiates sur l’élection présidentielle ont été largement débattues. Mais ce qu’on voit surtout, c’est que le fossé entre les citoyens, les élus, les magistrats et la justice se creuse un peu plus chaque jour. Et remettre les institutions en état de fonctionner correctement sera de plus en plus difficile.
Dernier point, plus inattendu : l’impact international, qui est sans précédent. Je ne me souviens pas d’une décision de justice française qui ait été à ce point commentée à l’étranger. Mais cet impact est ambigu. Trump, Musk, Poutine, Orbán ou Salvini, ne sont pas nécessairement de bonnes fées. Ce sont, pour beaucoup, des fées Carabosse.
Lucile Schmid :
Ne pas inscrire ce jugement dans un contexte politique serait paradoxal. Par exemple, dès l’ouverture du procès, Gérald Darmanin déclarait qu’il espérait que Marine Le Pen ne serait pas condamnée à l’exécution provisoire. Autrement dit, dès le départ, une partie de la classe politique a pris position, alors même que, je le rappelle, la norme voulait qu’on ne commente pas une décision de justice. Pourtant, dès l’origine, on a entendu des discours orientés, qui revenaient, d’une certaine manière, à dicter au juge la conduite à tenir. On voit bien que, sur les questions politiques, les rapports de force ont changé, y compris entre la justice et ce qu’on pourrait appeler « l’extérieur », jusqu’à des figures comme Elon Musk. L’ingérence dans les affaires françaises ne vient pas uniquement de l’intérieur. Elle est aussi internationale. Le contexte, aujourd’hui, est nouveau : à la fois interne et international. Et dans ce contexte, le fait que les juges assument un certain rapport de force me semble logique. On pourra toujours dire que cela ne correspond pas à l’idéal du droit, de l’ordre ou de la séparation des pouvoirs, mais on ne peut pas faire abstraction de ce nouveau cadre.
Le fait que Marine Le Pen se soit déclarée candidate à la présidentielle lui impose en quelque sorte un devoir d’exemplarité supplémentaire. Et je le comprends parfaitement. Ce n’est pas écrit noir sur blanc dans la décision, mais c’est une lecture qu’on peut en faire. À aucun moment, le jugement ne dit explicitement que Marine Le Pen aurait adopté une mauvaise ligne de défense. Ce sont davantage les commentaires médiatiques qui ont porté cette idée. Il faut donc faire attention à la confusion actuelle entre plusieurs univers : le monde médiatique, le monde politique, qui ne respecte plus la règle de non-ingérence dans les affaires judiciaires, et le monde juridique, dont le langage se trouve déformé dans l’espace public. Il faut y ajouter la faiblesse des forces démocratiques face aux forces de démocratie illibérale. Pour ma part, je considère que ce jugement est singulier, original, et bien motivé en droit. Et surtout, il introduit une idée importante : nous ne sommes plus dans une démocratie de confort, mais bien dans une démocratie de combat.
Nicolas Baverez :
Le devoir d’exemplarité des élus est typiquement quelque chose dont seuls les citoyens peuvent juger. Ce n’est inscrit nulle part dans le code pénal. Je veux bien qu’on invoque cette exigence, mais encore faut-il qu’on puisse en trouver la base légale, or elle n’existe pas. À partir de là, les magistrats vont au-delà de ce qu’ils devraient faire. Ils n’ont pas à juger l’exemplarité politique d’un élu. Leur rôle, c’est d’être la bouche de la loi, rien de plus, rien de moins.
Jean-Louis Bourlanges :
J’ai consulté pas mal de juristes dans cette affaire pour tenter de me faire une idée aussi juste que possible. Ce qui ressort de ces échanges, c’est que tout le monde s’accorde à dire que le code pénal français est devenu un véritable maquis, un enchevêtrement de contradictions et d’ajouts empiriques, accumulés au fil du temps sans réelle cohérence d’ensemble. Il faudrait clairement le toiletter, lui redonner de la lisibilité et une structure rationnelle.
Philippe Meyer :
Et on pourrait dire exactement la même chose du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de procédure civile, du code de procédure pénale… Tous ces textes souffrent du même mal. Il y a un travail de réfection, de nettoyage, de ravalement — on ne sait trop quel terme employer — qui est absolument colossal, et qui découle directement de la propension croissante des élus à empiler les textes, et du gouvernement à produire toujours plus d’arrêtés, de circulaires, etc.
Un de mes amis magistrats, qui avait été conseiller auprès de deux Premiers ministres successifs, m’a un jour résumé la situation ainsi : dans la pratique, la loi est inférieure au décret, le décret est inférieur à l’arrêté, et l’arrêté au coup de téléphone.